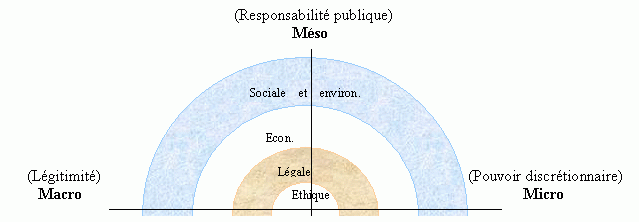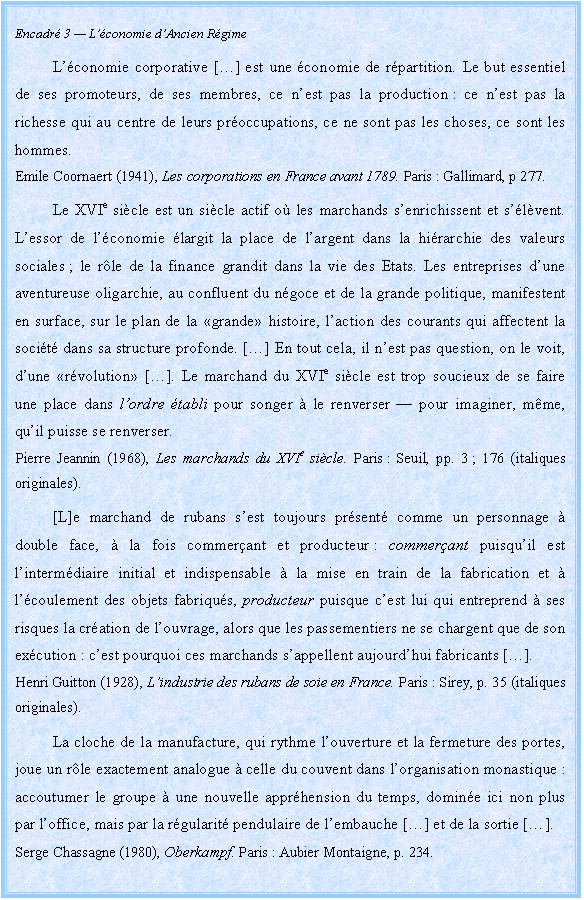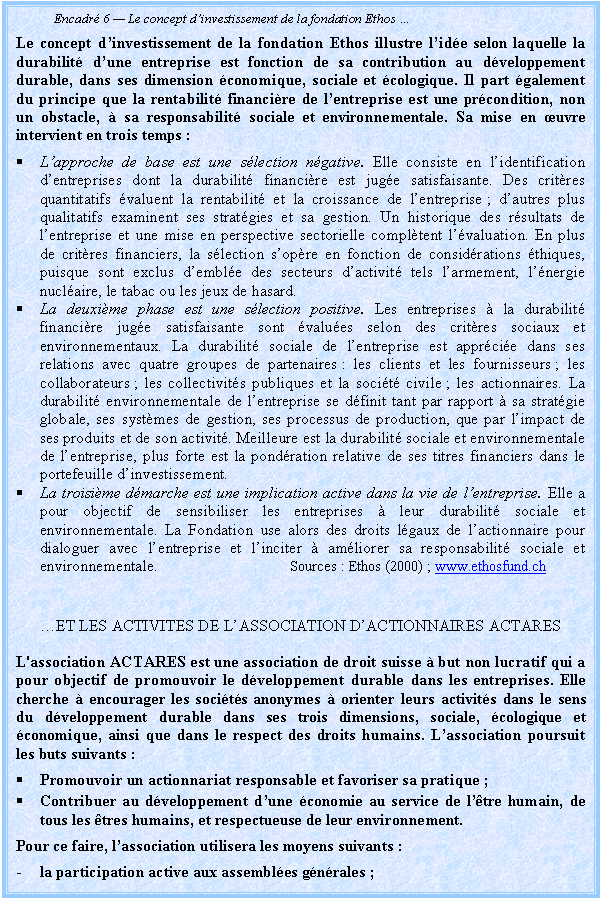[Précédent]
Introduction
Les temps contemporains vivent un paradoxe majeur. Alors que le système libéral d'économie de marché perd en 1989 son grand contradicteur socialiste suite à la chute du mur de Berlin, il affronte depuis lors une vive contestation interne. Les critiques sociales envers le libéralisme économique émanent en effet pour une bonne part des sociétés occidentales qui l'ont conçu et mis en oeuvre depuis plus de deux siècles. Si la contestation sociale est indissociable de l'histoire capitaliste, sa nature a récemment évolué. La protestation la plus virulente émane à présent moins des milieux syndicaux que de l'action plutôt hétéroclite de nombreux groupes de citoyens. Elle a pour cibles privilégiées l'Organisation internationale du commerce (OMC) et l'entreprise transnationale 1 , la première représentant à ses yeux l'instance ordonnatrice de la mondialisation et la seconde son vecteur privilégié. La contestation sociale prend un tour parfois tapageur et même violent, tel lors du Sommet de l'OMC à Seattle en décembre 1999. Elle revêt également la forme d'un activisme politique plus méthodique et ciblé qui dénonce le comportement de l'entreprise transnationale. En déficit de légitimité, celle-ci affirme sa citoyenneté, soit sa responsabilité sociale.
Les défis sociaux actuels sont typiques d'une période de mutation rapide. Ils doivent beaucoup à la mondialisation des marchés qui accroît l'instabilité de la vie économique et sociale. Si la mondialisation n'est pas nouvelle 2 , ses modalités et sa force le sont davantage. Son expression contemporaine se traduit par la libéralisation, la privatisation et la dérégulation des marchés nationaux. Elle s'appuie sur l'accélération du progrès technique, notamment par la diffusion des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). Celles-ci compriment le temps et l'espace 3 ; elles relativisent la notion de frontière politique et donnent naissance à une «nouvelle» économie.
La nouvelle économie a pour caractéristique centrale le transport instantané de données immatérielles par les réseaux numériques. Elle repose sur le développement depuis les années septante des NTIC, dont le worldwide web constitue la dernière strate. Les NTIC occasionnent l'essor exponentiel du commerce électronique. Elles intensifient les relations d'affaires grâce à des plates-formes commerciales virtuelles. Celles-ci concernent les relations d'affaires (business-to-business ou B2B) comme les liens avec la clientèle (business-to-consumer ou B2C). Le commerce électronique accroît la concurrence et la transparence, et par-là l'efficience des marchés. Il facilite l'acte d'achat, diversifie la palette de services et découvre une nouvelle clientèle. Le commerce électronique rapproche virtuellement le producteur du consommateur, donne à leur relation un caractère plus interactif et plus personnalisé par l'expression de la satisfaction et des goûts 4 . Il appauvrit par contre l'acte d'achat de son épaisseur sociale et contribue à la solitude interconnectée de l'individu contemporain.
La nouvelle économie et la libéralisation des marchés accélèrent les mutations structurelles de l'économie mondialisée. L'entreprise transnationale se remodèle constamment suivant une dynamique complexe de restructurations internes, de scissions, d'alliances stratégiques, de fusions-acquisitions et de délocalisations. Elle s'inspire tant du lévrier au travers de stratégies opérationnelles vouées à la flexibilité et à la compétitivité, que du mammouth dans sa recherche de croissance et de taille critique dans des marchés mondialisés. L'achat et la vente d'entreprises atteignent des montants faramineux 5 . Ce marché a pour théâtre essentiellement les économies de l'OCDE et celle des Etats-Unis en particulier, boudant les pays en développement. De telles restructurations ont des retombées économiques aléatoires ; les mariages d'entreprises connaissent par exemple un taux d'échec élevé. Elles occasionnent avec plus de certitude de lourds coûts sociaux dans les pays de l'OCDE. Elles semblent tirer parti des lacunes de la régulation internationale en matière sociale et environnementale. De quoi alimenter les critiques sociales à l'encontre d'une mondialisation emmenée sans vision ni état d'âme par l'entreprise transnationale.
La crise des idées
La dynamique contemporaine de mondialisation fait figure de test de vérité pour le libéralisme économique. Selon les théorisations libérales, le progrès technique et l'essor du libre-échange à l'échelle planétaire augurent de solides perspectives de croissance, et donc de développement économique et social pour le plus grand nombre. En fait, la mondialisation des marchés se traduit jusqu'à présent par de fortes disparités de taux de croissance entre les économies nationales 6 . Elle n'a ensuite pas d'incidence positive sur le développement économique et surtout social. Les inégalités socio-économiques se creusent entre les pays membres de l'OCDE et les pays en développement 7 . Elles s'élargissent également au niveau national, y compris parmi les pays les plus industrialisés d'Amérique du Nord et d'Europe. La précarisation et la marginalisation affectent les populations les plus vulnérables, guettent même certains segments des classes moyennes 8 . L'intégration des marchés mondiaux ne délivre pas ses promesses en matière sociale, d'où la vigueur des critiques formulées à l'encontre de ses fondations idéologiques et théoriques néolibérales.
Les années 1992-2000 représentent probablement un point d'inflexion dans l'histoire des idées de la deuxième moitié du XXe siècle. La période tempère l'euphorie libérale de la décennie quatre-vingts par le prise de conscience de l'imbrication des dimensions économique et sociale de la mondialisation, ainsi que de la nécessité d'une approche intégrée du développement. La libéralisation des échanges, la croissance économique ou l'investissement direct étranger ne garantissent ni l'emploi ni progrès social 9 . L'idée d'une croissance qualitative fait son chemin 10 . Le Sommet planète Terre de Rio rénove en 1992 le cadre de réflexion par l'adoption de la notion de développement durable. Le développement durable permet la satisfaction des besoins économiques présents sans compromettre celle des générations futures 11 . Il suppose donc une solidarité intra- et intergénérationnelle. Par la notion d'efficience, le développement durable questionne la dimension qualitative de la croissance : à quel coût économique, social et écologique est obtenue la production de richesse ? Il fonde la durabilité de la croissance économique sur sa concomitance avec le développement social et la protection de l'environnement. Les idées promues lors du Sommet de Rio sont trop ambitieuses dans leurs implications, trop idéalistes ou mal comprises pour s'imposer sans coup férir. Leur pertinence progresse néanmoins depuis lors, sinon dans les actes du moins dans les esprits.
Dès la conclusion en 1994 de l'Uruguay Round à Marrakech, la jeune Organisation mondiale du commerce (OMC) met en chantier de nouvelles libéralisations des échanges. Suite au Sommet de Singapour en 1996, plusieurs accords commerciaux multilatéraux sont conclus en matière de télécommunication et de technologie de l'information, de services bancaires et d'assurances. La libéralisation des marchés s'enraye par la suite. La crise financière puis économique qui frappe durement en 1997-1998 l'Asie du Sud-Est marque pour certains observateurs la fin d'un modèle asiatique de développement. Pour d'autres, la crise asiatique met à nu les lacunes du cadre régulatoire international de la vie économique, en particulier vis-à-vis des marchés financiers globaux. Une chose est sûre : ses conséquences économiques et sociales sont désastreuses pour des millions d'Asiatiques. L'abandon en 1997 des négociations menées sous l'égide de l'OCDE sur l'Accord multilatéral sur les investissements (AMI), ainsi que l'échec retentissant du Sommet de l'OMC à Seattle en décembre 1999 témoignent de sérieuses désaccords politiques ainsi que de vives résistances sociales quant à la poursuite de la mondialisation économique dans sa forme actuelle. En janvier 2000, les participants au Forum économique mondial de Davos parviennent à une conclusion similaire 12 : le multilatéralisme n'a pas progressé durant les ultimes années du millénaire, car il n'intègre pas assez les diverses sensibilités et priorités à son sujet. Une programmatique politique globale s'impose : « Nous devons mondialiser le progrès social 13 . »
La dimension sociale de la libéralisation des marchés se cristallise dans un premier temps autour de la question de la clause sociale. Au sein de l'OMC, le débat s'esquisse en 1994 à la Conférence de Marrakech et se précise à Singapour deux ans plus tard. Pour ses promoteurs, Etats-Unis et France en tête, l'insertion d'une clause sociale dans les traités commerciaux internationaux garantit une concurrence équitable par le respect de normes sociales universelles telles que définies par l'Organisation internationale du travail (OIT). La plupart des pays en développement dénoncent la clause sociale comme une barrière protectionniste déguisée 14 . Faute de consensus, l'OMC transmet l'épineux dossier à l'OIT qui, après des débats internes infructueux, le met en veilleuse.
Les récents grands fora internationaux explorent d'autres passerelles entre le progrès économique et social. Le Sommet mondial pour le développement social de Copenhague de 1995 est la première rencontre du genre sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Il appelle à la lutte contre l'extrême pauvreté et contre la précarisation sociale induite par la mondialisation. La création d'emploi et le développement humain sont reconnus comme des instruments de lutte contre la pauvreté, le chômage et la désintégration sociale. Tenus respectivement en juillet et septembre 2000, le Sommet social de Genève et le Sommet du Millenium tenu à New York réitèrent pour l'essentiel les constats et les objectifs énoncés à Copenhague. Dans une approche plus économique, le Groupe des sept (G7) et l'OCDE formulent un programme politique conciliant la compétitivité des économies nationales et la justice sociale. Lors de son Sommet économique et social tenu à Lisbonne en mars 2000, l'Union européenne décide de stimuler la création d'emploi par la libéralisation accrue des économies et par la réforme des régimes de protection sociale. En essence, les réflexions menées dans le cadre de ces divers fora internationaux identifient l'emploi -- son niveau quantitatif et qualitatif, ses conditions d'accès et de création -- comme une notion centrale en l'occurrence. On reconnaît à l'entreprise un rôle crucial dans le progrès technique, la création d'emploi et la croissance. La mondialisation réduit l'autonomie et l'efficacité des politiques keynésiennes qui ont nourri la prospérité des sociétés occidentales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
La multiplication des forums internationaux depuis 1995 ne prévient pas l'aggravation des inégalités sociales 15 . Les gains de productivité obtenus par les entreprises grâce notamment aux NTIC se traduisent par une croissance sans emploi dans les pays de l'OCDE. Sur un échelon géographique plus large, l'idée d'un temporaire déséquilibre dans la répartition sociale des bénéfices de la mondialisation paraît démentie par les faits. C'est dire que le phénomène procède également de facteurs structurels, telles l'inadéquation et l'insuffisance du cadre institutionnel et régulatoire de la vie économique internationale. La libéralisation et la croissance n'assurent ainsi pas le progrès économique et surtout social. Les politiques keynésiennes et néolibérales démontrent de sérieuses limites en matière sociale dans le contexte contemporain. Ceci suggère la rénovation des fondations idéologiques de la science et des politiques économiques.
La mise en exergue de l'entreprise et de sa contribution à l'emploi mettent à l'honneur les thèses de Joseph Schumpeter, longtemps dénigrées par l'orthodoxie néolibérale et keynésienne. L'économiste autrichien souligne le caractère dynamique et l'instabilité foncière du capitalisme, en raison notamment de l'innovation technique créée par l'entreprise. L'innovation exerce un effet de destruction créatrice sur son milieu d'émergence. Son impact destructeur intervient par l'usage de ressources naturelles, de biens intermédiaires et de compétences humaines. Son impact créateur s'observe dans le progrès technologique, la création de richesse et l'acquisition de nouvelles compétences. Les vagues ou grappes d'innovation nourrissent la dynamique capitaliste. Celle-ci suit une logique non pas linéaire, mais cyclique. Elle consiste en une alternance de phases de prospérité suivies de dépression. La croissance des phases de prospérité est due aux grappes d'innovation qui lancent le cycle ; elle s'essouffle lorsque ces techniques arrivent à maturité. Ainsi les chocs pétroliers des années septante closent la phase récessive d'un cycle économique initié au milieu du XXe siècle grâce à des innovations dans l'industrie pétrochimique, l'électronique et l'aéronautique. La théorie schumpétérienne des cycles économiques suggère aussi l'amorce depuis une dizaine d'années d'un nouveau cycle basé sur les NTIC, l'informatique et les biotechnologies 16 . L'économiste autrichien relève par ailleurs la spécificité des configurations institutionnelles qui accompagnent chaque cycle historique. Celles-ci se rejoignent toutefois dans leur objectif commun d'encadrement de la vie économique et de l'atténuation de ses effets sociaux perturbateurs. Dans ce contexte, l'entreprise assume une fonction d'innovation et de création de richesse en tirant parti de ses interdépendances avec son milieu social. Elle concilie ainsi sa fonction productive avec sa responsabilité sociale.
La gouvernance sociétale
La mondialisation des marchés tend à la fois à l'intégration et à l'anarchie. Elle renforce les liens d'interdépendance complexe entre les acteurs. Par son caractère inter- voire transnational, la mondialisation entraîne une reconfiguration de pouvoir entre les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile 17 . Elle affaiblit l'Etat national, érode sa souveraineté territoriale, réduit ses ressources ainsi que sa capacité d'action individuelle et collective. A l'échelon national, les politiques macro-économiques de type keynésien ne font plus recette, alors que l'action sociale publique est dépassée par l'ampleur des sollicitations. Sur le plan international, la mondialisation met le doigt sur les problèmes de coordination entre les Etats. En l'absence d'une autorité supranationale, les organisations intergouvernementales font preuve d'une capacité d'action limitée dans l'élaboration, et surtout dans l'application et le contrôle de règles universelles en matière économique, sociale et écologique. La conduite des affaires publiques s'effectue toujours plus au travers de multiples partenariats tissés entre les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile.
L'entreprise transnationale est un acteur qui croît en importance. Selon certains analystes, elle prendrait l'ascendant sur les gouvernements nationaux par l'intégration des forces de mondialisation financière, commerciale et industrielle 18 . A tout le moins, la privatisation, la dérégulation et la libéralisation des marchés lui offrent de nouvelles perspectives d'action 19 . Ses choix de production et d'investissement ont un impact significatif sur l'économie local et sur les mouvements internationaux de main-d'oeuvre. Son large recours aux NTIC contribue à la mondialisation des goûts, des idées et des pratiques d'affaires. Ses compétences techniques lui octroient un rôle prépondérant dans la régulation internationale de nouveaux domaines d'activités tel l'Internet 20 . La portée géographique, économique et sociale des activités de l'entreprise transnationale tout comme le volume de ses ressources et la variété de ses sources d'expertise font de celle-ci un acteur important des relations internationales contemporaines.
Les NTIC qui accompagnent la mondialisation stimulent la mise en réseau et l'activisme politique de la société civile internationalisée. L'éloignement géographique ne freine plus la constitution d'associations diverses et d'organisations non gouvernementales (ONG) au rayonnement international. Leur activisme politique exprime une forme de gouvernance civile 21 . Il s'exprime soit par l'arbitrage de la relation entre les gouvernements et les milieux d'affaires, soit par l'information du grand public. La légitimité politique de ces groupes sociaux est limitée par le caractère très ciblé, donc fragmentaire, de leur programmatique d'action. En revanche, le syndicalisme a perdu bien de son mordant depuis deux décennies dans les pays de l'OCDE, alors qu'il a rarement constitué une force sociale majeure dans les pays en développement. Sur un plan idéologique, l'action syndicale peine à se ressourcer depuis l'implosion de l'ex-bloc soviétique. Même la République populaire de Chine a effectué voici plus de deux décennies sa révolution culturelle pour entreprendre sa longue marche vers le libéralisme économique. L'action syndicale doit désormais composer avec l'érosion des solidarités collectives et avec l'individualisation des carrières. Le constat est particulièrement aigu dans le secteur tertiaire et dans les métiers liés à la nouvelle économie. En bref, l'opposition sociale à la grande entreprise paraît aujourd'hui plus exogène qu'endogène.
Le déficit régulatoire de la vie mondialisée en matière sociale et environnementale, ainsi que la modification des rapports entre les acteurs publics et privés posent une nouvelle équation de gouvernance sociétale, avec pour prémices le renforcement du rôle dévolu au secteur privé et à la société civile internationalisée. La gouvernance est l'ensemble des processus d'accommodement et de coopération entre des acteurs publics et privés. Elle inclut aussi bien la régulation formelle par des institutions et des régimes disposant du pouvoir de contrainte que des arrangements informels de corégulation ou d'autorégulation qui répondent aux intérêts des acteurs 22 . Dans son acception contemporaine, la gouvernance privilégie la corégulation par des mécanismes qui ne reposent exclusivement ni l'autorité souveraine de la puissance publique ni sur des sanctions fermes 23 . Elle est une réponse aux lacunes de la régulation hiérarchique centralisée 24 et aux limites de l'autorégulation. Elle se traduit par un ordre lâche, une «hétérarchie», -- moyen terme entre l'anarchie et la hiérarchie 25 . Une solution de gouvernance souligne les rapports mutuels d'autonomie et d'interdépendance des acteurs, établit des constellations d'intérêts et d'idéologies. Elle suppose une compatibilité, sinon une communauté minimale de valeurs, ainsi qu'une vision partagée sur la finalité et les modalités de l'action commune. Des mécanismes de dialogue et d'apprentissage des liens fonctionnels et des interdépendances réduisent les dysfonctionnements régulatoires. La faiblesse des sanctions opposables à une action dérogeant aux règles établies implique la responsabilité comportementale accrue de tous les acteurs, soit leur capacité d'autorégulation. La gouvernance rehausse l'importance de la transparence organisationnelle qui permet le contrôle externe de l'acteur par sa réputation.
Les incertitudes et les mouvances de la vie économique mondialisée appellent à une architecture régulatoire qui combine la régulation, la corégulation et l'autorégulation. La définition de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise privilégie pour l'heure diverses solutions informelles de corégulation et d'autorégulation. Ceci découle d'un constat historique d'échec. Dans la mouvance critique emmenée par l'école latino-américaine de la dependencia, les pays du Sud réclament avec insistance durant les années septante la formulation de normes internationales contraignantes applicables à l'entreprise transnationale. La tentative avorte, victime des clivages politiques Nord-Sud 26 qui enterrent également l'idée d'un nouvel Ordre économique international (NOEI) plus favorable aux pays du Sud. La période voit pourtant l'élaboration de plusieurs instruments internationaux non contraignants, dont deux conservent une pertinence contemporaine : les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, élaborés en 1976 et dont l'ultime révision remonte à fin juin 2000 ; la Déclaration tripartite de l'OIT concernant les entreprises multinationales et la politique sociale de 1977. Depuis lors, la régulation internationale y relative privilégie la corégulation et l'autorégulation. La citoyenneté de l'entreprise transnationale représente clairement une affirmation d'autorégulation comportementale face à un déficit régulatoire en matière sociale et environnementale.
La citoyenneté de l'entreprise
Cette étude a pour objet la «citoyenneté» de l'entreprise transnationale, soit en fait sa responsabilité sociale. Elle adopte pour prémices les perturbations sociales induites par la mondialisation économique, ainsi que le déficit de légitimité de cet acteur économique. Pour une partie de l'opinion publique, l'entreprise transnationale serait la principale bénéficiaire de la mondialisation sans assumer les responsabilités correspondantes, d'autant plus que se réduit la capacité d'action des collectivités publiques. Dans un tel contexte, l'entreprise transnationale ne serait-elle pas à même d'assumer une responsabilité sociale plus affirmée 27 ? Plusieurs fora internationaux le suggèrent. Le Sommet planète Terre de Rio en 1992 encourage la collaboration future de tous les acteurs sociaux, publics comme privés. Il définit la citoyenneté des acteurs collectifs privés, telles les entreprises ou les ONG, en termes de participation et de partenariat 28 . Le Sommet social de Copenhague évoque une gouvernance internationale tripartite gouvernements/secteur privé/société civile dans laquelle l'entreprise serait le moteur du développement social. Le message politique est réitéré lors du premier Forum ministériel environnemental global de l'ONU tenu en mai 2000 à Malmö, ainsi qu'à l'issue du Sommet social de Genève. L'appel le plus emblématique est le Pacte global (global compact), proposé par Kofi Annan aux milieux d'affaires lors du Forum économique de Davos en 1999. Le Secrétaire général des Nations Unies appelle de ses voeux les entreprises transnationales à démontrer leur citoyenneté globale par le respect et la promotion des normes universelles en matière de droits humains et sociaux ainsi que d'environnement 29 .
Le nouveau champ d'action de l'entreprise transnationale n'assure pas en effet à lui seul la cohérence d'ensemble 30 . Il suppose l'existence de règles universelles qui encadrent l'activité économique mondialisée et qui garantissent son bon fonctionnement 31 . Une telle régulation s'inscrit également dans l'intérêt des acteurs économiques en assurant une compétition plus équitable sur les marchés ainsi qu'une meilleure légitimité sociale de leurs activités. L'entreprise transnationale se doit également d'adapter ses modalités d'insertion sociale aux divers contextes locaux. Dans les mots d'un directeur exécutif de Shell :
« Increasingly, companies need to demonstrate a commitment to being both global citizens and local neighbours. Working with an overarching framework of widely accepted values and principles will be one of the keys to gaining broad acceptance of the benefits that international businesses, working in open, competitive markets, can bring 32 . »
Certaines grandes entreprises n'ont pas attendu l'appel de Kofi Annan pour affirmer leur citoyenneté vis-à-vis de leur milieu local. Ce thème se développe en effet dès les années quatre-vingts dans le monde anglo-saxon et nord-américain en particulier. Il intervient après une période caractérisée aux Etats-Unis et au Royaume-Uni par une drastique dérégulation économique et sociale. La relance économique est obtenue par le président américain Ronald Reagan et le Premier ministre britannique Margareth Thatcher à un coût social élevé. Les attentes sociales envers l'entreprise anglo-saxonne augmentent en conséquence ; celle-ci y répond par son affirmation citoyenne. Par sa citoyenneté, l'entreprise transnationale entend transcender les obligations comportementales légales et démontrer sa capacité d'initiative et sa responsabilité sociale. Elle dépasse la philanthropie par un engagement actif et direct en faveur de la régénération de la solidarité sociale. La citoyenneté de l'entreprise transnationale est globale par le respect de valeurs et principes universels en matière de dignité humaine et de protection de l'environnement naturel. Elle est locale ensuite par diverses initiatives sociales qui assurent son insertion dans son milieu opérationnel.
L'affirmation citoyenne de l'entreprise constitue-t-elle une manifestation authentique de sa responsabilité sociale ? Elle intervient paradoxalement au moment où l'intégration des marchés commerciaux et financiers accroît l'exigence de compétitivité des acteurs économiques, ce qui aurait plutôt tendance à évacuer les préoccupations sociales des stratégies managériales. Les restructurations internes, les fusions-acquisitions et les délocalisations pratiquées par la grande entreprise laissent en effet des cohortes de sans-emploi dans les pays de l'OCDE. La citoyenneté de l'entreprise pourrait dès lors ne représenter qu'un exercice de relations publiques pauvrement traduit en actes, destiné d'une part à prévenir une législation contraignante et d'autre part à réduire les critiques sociales. Les nombreux codes de conduite publiés récemment par le secteur privé étaie cette double hypothèse, vu leur contrôle externe lacunaire et leur substance pauvrement retranscrites en actes. Par son engagement citoyen, l'entreprise peut également instrumentaliser son environnement social. Celui-ci serait alors un vivier de ressources productives destiné à améliorer la compétitivité de l'entreprise et à soutenir chichement la motivation de ses collaborateurs. Le développement local ne serait alors pas assuré. En tous cas, la citoyenneté de l'entreprise questionne la délimitation des sphères publique et privée, et suggère par-là la possible interférence d'intérêts privés dans la définition des politiques publiques.
Le contour et le contenu de la citoyenneté ou de la responsabilité sociale de l'entreprise font l'objet de vives controverses. Celles-ci englobent le débat relatif à la gouvernance d'entreprise (corporate governance), qui oppose les perspectives analytiques de la valeur actionnariale (shareholder value) et de la valeur des partenaires de l'entreprise (stakeholder value). L'approche de la valeur actionnariale définit la responsabilité sociale de l'entreprise essentiellement dans les termes de ses obligations légales vis-à-vis de l'investisseur et du propriétaire. L'entreprise devrait alors maximiser ses bénéfices opérationnels. L'approche des partenaires d'entreprise préconise la prise en compte et le panachage des intérêts des divers groupes sociaux affectés par la vie de l'entreprise. L'objectif consiste dès lors en la création de valeur pour tous ces groupes sociaux.
La citoyenneté de l'entreprise recoupe les débats au sujet du new public management et des droits de l'actionnariat, avec pour enjeu l'efficience et la transparence opérationnelle des institutions publiques et privées vis-à-vis de la société civile : quel est le degré d'autonomie fonctionnelle nécessaire à la bonne marche d'une institution ? La citoyenneté de l'entreprise réactive en outre le vieux débat relatif à l'universalisme ou au relativisme des droits humains et sociaux. La mondialisation du progrès social suppose la respect de normes sociales fondamentales. Même si leur universalité est officiellement reconnue dans les enceintes internationales, leur respect est encore parfois sacrifié face à des considérations politico-économiques. Notre étude se borne à puiser quelques éléments de ces épineuses questions au gré des besoins de l'exposé.
L'argument
Notre thèse est la suivante. La citoyenneté de l'entreprise est une forme de responsabilité sociale si elle outrepasse une philanthropie cosmétique pour concerner également les activités productrices et le dialogue de l'entreprise avec les pouvoirs publics et la société civile. La philanthropie de l'entreprise ne saurait en effet se substituer à ses responsabilités sociales fondamentales qui comprennent, outre sa faculté de création de richesse, sa contribution au progrès technique, aux recettes fiscales et à l'emploi, sans omettre son souci de préservation des ressources naturelles. L'engagement citoyen authentique se traduit dans toutes les facettes de la vie de l'entreprise. Il suppose un certain effet distributif de la richesse produite sur l'ensemble des groupes sociaux affectés par la vie de l'entreprise. En bref, la citoyenneté authentique de l'entreprise représente à la fois une activité économique, un acte de gouvernance et une source de lien social. Il exprime la prise de responsabilité comportementale de cet acteur et son engagement solidaire vis-à-vis du corps social.
L'attention portée par l'entreprise à son ancrage social, au procès de création et de distribution de richesse, permet la réduction de son risque opérationnel. Elle autorise un authentique progrès économique et social, car « une économie prospère ne peut se développer que dans une société prospère 33 . » Une société prospère si son développement allie le changement à la stabilité, le progrès économique à la préservation de valeurs communes 34 . La viabilité de l'entreprise repose sur la durabilité du développement économique et social qu'elle nourrit. Cette communauté d'intérêt entre la société et l'entreprise relativise la prétendue incompatibilité entre l'objectif privé de compétitivité économique et l'objectif public de cohésion sociale. La résolution de ce dilemme constitue l'essence de l'entrepreneuriat et de la citoyenneté de l'entreprise.
Sur le plan des idées, la prétendue incompatibilité entre le développement économique et social résulte pour une bonne part de la séparation artificielle opérée entre l'économie politique et les autres sciences sociales, dont l'argumentaire sous-tend l'approche de la valeur actionnariale. Les répercussions pratiques d'une telle dissociation se lisent dans le manque de créativité des décideurs économiques dans la relation de l'entreprise avec son milieu. L'innovation peut être non seulement technique, mais également sociale.
L'engagement citoyen authentique de l'entreprise transnationale est un acte de gouvernance globale et locale qui respecte la prééminence du politique et qui complète l'action publique. Faute de quoi, la citoyenneté de l'entreprise équivaudrait à une stratégie d'infiltration du jeu politique destinée à prévenir une régulation formelle et contraignante. L'affirmation citoyenne de l'entreprise doit également se traduire en actes. Elle doit outrepasser une stratégie de relations publiques destinée à justifier chichement son pouvoir par quelques actions sociales fortement médiatisées, sans quoi elle rejoindrait certaines pratiques philanthropiques ambiguës des barons voleurs (robber barons) américains à la fin du XIXe siècle. Le parallèle historique n'est pas fortuit. Les deux initiatives du big business interviennent suite à une forte accélération de la concentration industrielle qui engendre un climat d'hostilité sociale envers la grande entreprise. De plus, les deux types d'initiatives sociales ont pour théâtre principal le monde anglo-saxon. Elles reflètent une conception anglo-saxonne du rôle social de cet acteur et s'appliquent imparfaitement dans d'autres contextes socioculturels.
A l'appui de cette thèse, l'histoire industrielle démontre la compatibilité du développement économique et social. Le capitalisme industriel réalise lors du second XIXe siècle la quadrature du cercle. Le régime paternaliste constitue une stratégie défensive de réduction du risque opérationnel qui éloigne le spectre de troubles sociaux. L'encadrement ouvrier et les oeuvres sociales procèdent d'un intérêt privé bien compris enrichi du sens du bien commun. Le paternalisme fidélise la main-d'oeuvre par l'élévation de sa condition matérielle et morale. Il prend charge d'âme et de corps, mais ne souffre d'aucune contestation. Certaines initiatives d'industriels inspirent la formulation ultérieure de politiques publiques ou, du moins, pallient leurs lacunes. Le succès du paternalisme se limite aux conditions sociopolitiques de son époque. La grande entreprise contemporaine doit inventer de nouvelles formes d'engagement social qui témoignent de sa responsabilité publique et de son insertion sociale. Sa citoyenneté constitue une possible réponse à ce défi, aux conditions énoncées ci-dessus.
Questions de méthode
Le parallèle historique esquissé ci-dessus entre la citoyenneté de l'entreprise et la philanthropie des barons voleurs suggère la récurrence de certains problèmes et questionnements au cours de l'histoire capitaliste. La présente étude réserve donc une place de choix à l'analyse historique. L'histoire de la responsabilité sociale de l'entreprise depuis les premiers balbutiements capitalistes jusqu'à nos jours reste à écrire. Le tableau historique brossé ici n'a aucune prétention d'exhaustivité, tant la thématique est vaste dans ses implications, protéiforme dans ses manifestations synchroniques et diachroniques. La mise en perspective historique dégage tout de même de troublantes similitudes entre des périodes distinctes, telle la fin des XIXe et XXe siècles. Elle retrace des évolutions nettes, due notamment aux accélérations du progrès technique.
Les outils conceptuels et théoriques qui relient l'activité productive de l'entreprise à sa responsabilité sociale sont lacunaires. L'économie politique propose la croissance économique pour articulation entre le développement économique et social. Ce lien est simpliste et démenti par l'histoire du capitalisme. La science économique s'est peu attachée à comprendre la fonction productive de l'entreprise et les motivations entrepreneuriales. Elle a encore moins démontré comment l'activité économique privée pouvait être politique dans ses implications sociales. Les sciences de la gestion synthétisent souvent des apports pluridisciplinaires pour présenter des analyses fouillées dans leurs aspects techniques, mais peu étoffées par rapport à notre problématique. L'analyse sociologique et politologique de l'entreprise est plus féconde. Elle considère les divers groupes sociaux concernés par la vie de l'entreprise pour étudier leur interaction. Cette analyse ne s'attarde guère en revanche sur les implications économiques d'une conceptualisation élargie de l'entreprise.
Notre perspective est résolument interdisciplinaire, privilégiant l'approche sociologique. Elle positionne l'entreprise dans un entrelacs de relations économiques, sociales et politiques. Le réseau dont fait partie l'entreprise est à la fois un outil managérial et une forme de gouvernance. Le réseau facilite l'activité productive par la réduction du risque à entreprendre. Il la discipline par un cadre conventionnel souple, basé sur l'autonomie et l'interdépendance des acteurs, qui assure une répartition équitable de ses bénéfices. Le réseau plus ou moins formalisé permet la conciliation des visées productives de l'entrepreneuriat et les impératifs sociaux d'une vie en société. Il ne se traduit pas forcément par la péjoration de la performance économique de l'entreprise. Mieux, il en assure la durabilité. Le réseau représente ainsi une clé de lecture précieuse de la responsabilité sociale de l'entreprise au travers de son affirmation citoyenne.
La citoyenneté de l'entreprise fait l'objet d'une quadruple mise en perspective. Sur un plan conceptuel, la notion est rattachée à la responsabilité sociale de l'entreprise. Elle est également évaluée à l'aune de l'histoire capitaliste, puis reliée théoriquement à l'entrepreneuriat. Enfin sa mise en oeuvre est observée dans divers contextes socioculturels. La dissertation s'articule en trois volets. La première partie considère la notion de citoyenneté de l'entreprise. La deuxième partie retrace l'évolution de la responsabilité sociale de l'entreprise depuis les temps préindustriels jusqu'à nos jours. La troisième partie théorise la responsabilité sociale de l'entreprise pour aborder ensuite son engagement citoyen. La citoyenneté de l'entreprise est mise en perspective interculturelle par l'examen de son retentissement au Japon et en Suisse.
I. L'entreprise, acteur social durable
-- REMARQUES LIMINAIRES
L'affirmation citoyenne de l'entreprise constitue-t-elle réellement une manifestation de sa responsabilité sociale ? L'introduction a relevé certaines ambiguïtés relatives à la citoyenneté de l'entreprise et à son contexte d'émergence. Cette partie conceptuelle se propose de définir précisément les deux notions, de souligner leurs recoupements et leurs traits spécifiques. La citoyenneté de l'entreprise s'adresse en priorité à la communauté locale. Elle se limite souvent à un programme philanthropique plus ou moins étoffé et cohérent, destiné à rehausser l'image de marque et la motivation des collaborateurs.
L'affirmation citoyenne de l'entreprise porte à équivoque. Les pratiques qu'elle couvre se limitent souvent à des initiatives philanthropiques vis-à-vis de la communauté locale. La citoyenneté de l'entreprise reflète une conception anglo-saxonne du rôle social de l'entreprise, laquelle ne répond pas forcément aux attentes sociales dans d'autres contextes culturels. Il serait plus judicieux que cet acteur évoque sa responsabilité sociale, notion plus large qui reflète mieux l'action d'entreprendre et qui fonde la véritable insertion sociale locale de l'entreprise. La responsabilité se fonde sur l'interdépendance des individus vivant en société et sur l'imbrication de l'économique et du social. La responsabilité sociale de l'entreprise suppose l'écoute et l'analyse attentive de l'environnement afin de mieux tirer parti de ses ressources, mais aussi de minimiser les perturbations sociales liés à son activité. Le bilan ainsi tiré est susceptible de variations socioculturelles. Si l'engagement citoyen de l'entreprise respecte ce postulat, il rejoint sa responsabilité sociale.
L'activité de l'entreprise n'est pas nécessairement gage de développement de son milieu social. Pour l'illustrer, il convient de distinguer la croissance du développement. La croissance est un phénomène quantitatif, mesuré usuellement par les indicateurs du produit intérieur brut (PIB) et du produit national brut (PNB), et qui traduit une augmentation soutenue de la production et du niveau de vie. Le développement est en revanche un phénomène plus ample d'évolution qualitative des structures économiques, sociales, techniques et institutionnelles 35 . Il implique donc l'évolution des modes de vie et de pensée. Dans sa dimension économique, le développement suppose la transformation des dimensions caractéristiques de la vie économique : le niveau technique, les structures productives, les barrières aux échanges commerciaux et aux flux de capitaux. S'y rattachent également des facteurs sociopolitiques, telles la démographie, la propension à la consommation, la distribution des revenus et la qualité fonctionnelle des institutions.
Quant au développement social, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) le définit comme l'élargissement des choix relatifs aux activités et aspirations humaines, élargissement créé par l'expansion des capacités de l'individu plutôt que de ses choix de consommation 36 . Les ramifications du concept sont multiples, d'ordre écologique, démographique, politique, social, culturel et écologique. Le PNUD retient pour indicateurs de son indice de développement humain (IDH) l'espérance de vie, l'accès à l'éducation et à un niveau de vie décent. À quoi on peut ajouter notamment le respect des droits humains et sociaux fondamentaux, l'accès à la santé et à la protection sociale, la justice sociale et la préservation de l'identité culturelle et du milieu naturel. Plus d'un indicateur de l'IDH pourrait également caractériser le développement économique, ce qui démontre l'imbrication de ces deux dimensions.
La croissance est une condition nécessaire, mais non suffisante, du développement économique et social. Autrement dit, la croissance stimule le développement à condition que ses retombées permettent l'évolution correspondante des structures sociales 37 . La considération de l'impact social de l'entreprise le démontre. L'entreprise stimule la croissance grâce à sa faculté d'innovation et à sa fonction productive. En revanche, les retombées de ses activités sur le développement social sont plus inégales et incertaines. La mondialisation accroît la compétition entre les gouvernements hôtes, afin d'attirer les entreprises transnationales sur leur territoire et par-là soutenir la croissance nationale. La tendance à la dérégulation compétitive de la vie économique est susceptible de compromettre le développement social, ce qu'exemplifient les zones spéciales d'exportation de certains pays en développement. Autant dire que l'activité d'une entreprise transnationale n'est pas nécessairement synonyme d'un véritable développement de son environnement social.
Le capitalisme a permis une élévation formidable du volume productif et du niveau de vie des sociétés modernes. Le progrès technique n'a toutefois pas ce caractère libérateur prêté par l'école néoclassique 38 . La croissance économique ne résout pas les problèmes sociaux, mais en renouvelle les termes 39 . Elle participe au développement social sans le garantir. Les temps contemporains réinventent la richesse et la pauvreté, réinterprètent la capacité et la responsabilité des acteurs sociaux. Dans ce contexte, la question des inégalités sociales est abordée dans la perspective plus ample de la continuité entre l'action individuelle et collective 40 .
Le développement d'une société est fonction de la qualité de l'insertion -- soit de la responsabilité -- sociale de l'entreprise. L'insertion ou la responsabilité sociale de l'entreprise englobent son lien de citoyenneté avec la communauté locale et ne se manifestent pas forcément ou en priorité par des initiatives philanthropiques. Elle suppose le respect, outre de l'investisseur, par exemple du consommateur et du collaborateur au travers respectivement de produits et de relations professionnelles de qualité. Ainsi intervient la création de richesse pour l'ensemble des partenaires de l'entreprise. La création de richesse est la valeur ajoutée de l'activité de l'entreprise, au sens large qui inclut la valorisation des ressources tangibles et intangibles d'une société dans ses dimensions économique, sociale et écologique. Outre le profit dégagé par les activités de l'entreprise et la plus-value boursière, la création de richesse comprend notamment le revenu du collaborateur, l'impôt versé aux collectivités publiques, ainsi que sa contribution au revenu national, au progrès technique, au développement humain et social de son environnement. La création de richesse implique enfin l'usage responsable des ressources naturelles. La considération conjointe de ces facteurs économiques, sociaux et écologiques permet le développement durable de l'entreprise et de son milieu.
Aucune entreprise n'est conçue pour vivre éternellement. Cependant, l'idée de durabilité est une composante essentielle de l'entrepreneuriat. Dans sa définition minimale, la durabilité s'exprime par le souci de survie. La condition sine qua non de survie pour l'entreprise est la réalisation d'un profit. Celui-ci permet l'investissement dans le renouvellement de l'infrastructure productive, laquelle fonde la compétitivité future de l'entreprise et par suite la réalisation d'un profit futur. La durabilité de l'entreprise dépend de beaucoup d'autres facteurs, dont la stratégie entrepreneuriale, le secteur d'activité, la reconnaissance sociale de l'utilité de ses produits et de légitimité de sa dimension institutionnelle. L'entreprise socialement responsable a un intérêt direct dans un développement durable de son milieu, afin d'assurer sa propre durabilité d'acteur social. Car il n'est pas de divorce entre l'économie et le social qui soit viable à terme. Dans l'expression authentique de sa citoyenneté, l'entreprise est un acteur social durable d'un développement durable.
1. Quelle citoyenneté pour l'entreprise ?
La citoyenneté de l'entreprise. L'expression déconcerte de prime abord. La citoyenneté est un attribut individuel alors que la société par actions se compose le plus souvent d'un collectif d'individus regroupés en un artefact juridique de personne morale. L'entreprise se voudrait-elle une démocratie de collaborateurs citoyens ? Sa logique interne n'est pourtant pas démocratique, mais hiérarchique. Par son affirmation citoyenne, l'entreprise aspire-t-elle à sa participation plus active et plus ouverte au débat politique ? Là n'est pas assurément sa fonction sociale première. La citoyenneté de l'entreprise transnationale est plus absconse encore : quel est le souverain politique d'une société commerciale opérant à l'échelle globale ? La littérature n'explore guère ces clairs-obscurs sémantiques. Les documents publiés par les entreprises exposent dans des termes aussi laudateurs que rhétoriques leurs principes directeurs et leurs accomplissements 41 . Parmi les rares monographies consacrées à la citoyenneté de l'entreprise, plusieurs sont d'émanation patronale et se rattachent ainsi à la littérature primaire 42 . Quant aux réflexions critiques 43 , elles sont très abruptes et parfois contradictoires dans leurs conclusions. De telles divergences d'appréciation résultent pour une bonne part du flou conceptuel qui entache cette notion 44 . Enfin la citoyenneté de l'entreprise a pour origine sociohistorique le monde anglo-saxon 45 . La littérature, essentiellement anglo-saxonne elle aussi, ne s'interroge guère sur la mise en oeuvre du concept dans d'autres contextes culturels.
Ces considérations appellent à une réflexion conceptuelle approfondie de la citoyenneté de l'entreprise afin de mieux cerner sa substance. Trois types de définitions se dégagent de la littérature. D'abord une citoyenneté conçue en interne de l'entreprise, laquelle formerait une sorte de communauté sociopolitique relativement autonome vis-à-vis de son environnement sociétal. Deuxièmement, une définition focalisée sur l'interaction de l'entreprise avec son environnement social. Enfin une acception large, mais imprécise de la citoyenneté de l'entreprise qui omet dans l'analyse la distinction des niveaux interne et externe de sa structure organisationnelle. Dans les deux derniers cas de figure, l'entreprise reconnaîtrait, voire revendiquerait, un rôle générique plus affirmé dans la vie de la cité. Aucune des deux interprétations ne nous suggère le comment et le pourquoi de la citoyenneté de l'entreprise.
Hormis sa définition à partir de sources et d'études critiques, la thématique peut s'appréhender d'une troisième manière, plus longue et ardue, plus juste et fine également. L'étude approfondie des concepts d'entreprise et de citoyenneté semble la plus appropriée pour dégager précisément la substance de leur interrelation. Précisons que la réflexion prend pour cadre le système capitaliste, défini comme un ordre social et un système de production économique caractérisé par la propriété individuelle des moyens de production et par la compétition entre acteurs économiques au travers des mécanismes de marché.
A. L'entreprise
Cerner par une seule définition la nature complexe de l'entreprise transnationale contemporaine ressemblerait au tâtonnement tactile de l'aveugle face à un éléphant. Au contact de la trompe du pachyderme, l'aveugle croit reconnaître un serpent, assimile ensuite la patte de l'animal à un arbre, avant de confondre le flanc de l'éléphant avec un mur 46 . Une réalité complexe s'appréhende donc mieux par le choix d'une variété de perspectives analytiques. Dans une remarquable synthèse de théories des organisations 47 , Gareth Morgan présente un kaléidoscope analytique dont chaque prisme est constitué d'une métaphore. L'entreprise s'appréhende tour à tour, comme une machine bureaucratique, un organisme lié à son environnement, un cerveau qui assimile l'information, un phénomène culturel distinct, un système politique, une prison psychique pour ses membres, un flux d'éléments tangibles et intangibles en perpétuelle transformation, et enfin un outil de domination. Trois concepts paraissent essentiels pour aborder la problématique de l'entreprise citoyenne : l'organisation, l'institution ainsi que le produit sociohistorique et socioculturel, concepts dont l'étude est précédée d'une analyse sémantique du terme «entreprise».
1° Etude sémantique
L'entreprise désigne le produit de l'acte d'entreprendre, l'entrepreneur son auteur. Entreprendre, littéralement « prendre entre », désigne une action d'intermédiation et de bouleversement d'une chaîne d'interactions sociales dans le but d'en tirer un bénéfice. Dans le vocabulaire schumpétérien, le bouleversement social induit par la vie de l'entreprise s'appelle la destruction créatrice. Entreprendre détruit certains arrangements sociaux et en crée de nouveaux. Le bénéfice pour l'auteur de l'opération est le profit. Secondement, entreprendre dans le sens de « prendre parmi » exprime un choix face à une ou plusieurs alternatives. Ce choix s'effectue rationnellement selon un ordre de préférences défini par l'entrepreneur en fonction de ses projets et des contraintes contextuelles. Le bouleversement de l'ordre social et le choix rationnel sous contrainte sont ainsi indissociables de l'entreprise.
Dans sa plus simple généralité, l'entreprise recouvre la tendance qui porte à l'action, l'élan non encore accompli. Le mot évoque aussi une action, une réalisation en cours. Ces deux acceptions -- l'idée et l'action -- sont autant de conditions nécessaires à la réalisation d'un dessein. L'idée «entreprise» recèle ainsi dans le mental de son auteur l'existence d'un projet et la volonté de le mettre en oeuvre. Quant à l'action «entreprise», elle trouve sa concrétisation par la modification objective du contexte de ladite action. L'action «entreprise» trouve sa plénitude sémantique dans la concrétisation d'une idée. Sa finalité, la constitution d'un nouveau cadre objectif, est tout entière orientée vers l'avenir. Son caractère est essentiellement transitif : du présent au futur, de l'existant au projeté. L'idée et l'action «entreprise» sont des vecteurs d'une réalité à l'autre 48 .
L'entrepreneuriat a pour postulat la relative insatisfaction de son auteur face à la situation initiale. Au plus obscur de l'idée d'entreprise sommeille une frustration, le goût du défi ou l'appât du gain qui s'accompagnent d'une capacité supposée de modification et d'amélioration de la réalité. L'innovation n'est pas recherchée per se, mais comme l'instrument de modification d'une situation donnée. Elle ne se conçoit moins par rapport à l'idée ou l'action «entreprise» que dans les incidences attendues de sa réalisation. Les réalités initiales et finales diffèrent en premier lieu selon la nature du projet entrepreneurial. L'entreprise recouvre une grande diversité de projets humains, diversité à la fois synchronique et diachronique. Ainsi entre les XIIIe et XVIe siècles, l'entreprise désigne le plus souvent une menée aventureuse, voire guerrière. Le terme évolue ensuite vers une plus riche polysémie à dominante économique : l'entreprise d'argent devient la modalité principale du terme. Au XVIIIe siècle, l'entreprise d'argent désigne l'action de mener à bien une affaire commerciale ou financière déterminée, en vue de la réalisation d'un profit 49 . Cette définition de l'entreprise d'argent contient tous les éléments principaux de son acception économique contemporaine : cohérence du projet et de l'action, mise en équation d'éléments plus ou moins hétérogènes, profit comme fruit de l'action. L'entreprise résulte d'un calcul effectué dans un contexte opérationnel caractérisé par le risque et dont le profit est la récompense. Le calcul de l'entrepreneur est rationalisant parce qu'il vise la réduction du risque encouru. Les situations initiale et finale sont néanmoins deux arrangements distincts. L'action de l'entrepreneur ne consiste pas en un bouleversement d'un ordre pour profiter du chaos ainsi créé. L'entrepreneuriat est la création d'un désordre en vue d'un ordre nouveau, perçu par son auteur comme plus favorable.
La rationalité qui préside à la naissance de l'entreprise est entachée de sévères limites. L'anthropologie, la psychologie et la sociologie démontrent la pluralité, la complexité et les limites des raisonnements humains, battant en brèche l'idée d'une rationalité individuelle unique, univoque, constante et omniprésente 50 . L'entrepreneur n'a pas la capacité d'infléchir totalement l'évolution de son cadre de vie dans le sens de ses vues. Sa rationalité est à rechercher dans ses plans, pas dans le fruit de ses actions. Son choix présent se fait sur la base d'une information lacunaire, car par extrapolation d'une situation future, hypothétique par essence. Le caractère apparemment judicieux du choix présent ne présage en rien de la qualité de ses conséquences futures. En somme, le choix le plus rationnel en apparence est indissociable de l'incertitude, à commencer par celle d'avoir opté pour la meilleure option. L'entreprise implique le renoncement à au moins une potentialité, et peut comporter des conséquences futures irréversibles. Choisir est ainsi une entreprise risquée. L'entreprise naît d'une prise de risque. Celle-ci est mesurée toutefois, car l'entrepreneur dispose d'un antidote à la prise de risque : la création ou le maintien de la confiance. La confiance peut être orientée vers lui-même ; elle concerne alors par exemple ses facultés d'anticipation, de création, d'appréciation ou de travail. La confiance peut en outre concerner son milieu social. Dans ce cas, la stratégie de l'entrepreneur consiste à raffermir ses relations sociales malmenées par son activité, à rassurer son milieu sur l'utilité sociale de son action perturbatrice. L'entreprise se situe ainsi à l'intersection de la prise de risque et de la création de confiance 51 .
Outre la mise en relation d'hommes et d'objets, l'entreprise apprivoise les notions d'espace et de temps. Telle un enclos, l'entreprise naît de l'appropriation et de la délimitation d'un espace. Telle une charrue de labour, elle est l'outil de la modification rationnelle du caractère dudit espace. Par ailleurs, l'entreprise érige l'espace en valeur. Valeur tangible d'une part, estimable dans son caractère concret : bâtiments, coûts de transport de marchandises entre différentes unités de production, par exemple. Valeur intangible d'autre part, inestimable dans ses potentialités. Dans l'espace de l'entreprise gravitent des biens et des compétences humaines dont l'interaction mutuelle est porteuse d'innovations. Le temps est une autre valeur que l'entreprise fait fructifier. « Le temps, c'est de l'argent ! », affirme la sagesse populaire pour souligner à la fois son inexorable fuite et les gains découlant de sa gestion rationnelle. L'entreprise est bien la mise en oeuvre rationnelle du temps. Plus subtilement, le facteur temps transcende l'idée de profit pour toucher à l'essence de l'entreprise. Au fil du temps, l'entreprise est transitive par sa faculté de remodelage de son milieu. Elle est aussi transitoire, évoluant dans sa forme organisationnelle, meurt même. Portée vers une réalité différente, l'entreprise affirme son caractère transitif et transitoire. Si son espérance de vie est limitée, l'entreprise n'aspire pas moins généralement à durer. Elle considère alors son utilité organisationnelle et sa légitimité institutionnelle.
2° L'organisation
L'entreprise privée est un acteur économique par sa fonction de production de biens et services. Sa structure organisationnelle résulte de la mise en oeuvre et de la coordination de facteurs de production, d'actifs tangibles et intangibles, que la science économique désigne synthétiquement par les agrégats de capital et travail. L'entreprise met en équivalence des matières premières, du capital, de la force de travail, des connaissances, du temps et de l'espace. La quantification et la substitution mutuelle de ces facteurs hétérogènes s'effectue par l'étalon de la valeur monétaire 52 . L'entreprise permet la constitution de valeur par le principe d'accumulation du capital. Contrairement à l'association à but non lucratif, l'entreprise commerciale se doit de dégager un profit de ses activités ; sa survie même en dépend. Cette plus-value résulte grosso modo de la soustraction de la valeur de ses coûts de production à celle de son chiffre d'affaires. L'entreprise commerciale marque la réunion de compétences humaines autour de l'idée centrale de production et de profit. Elle commence par l'humain et par son idée d'entreprendre. Par l'usage de matières premières de produits intermédiaires et grâce à son savoir-faire, l'entrepreneur crée un nouveau bien ou service. Une fois le produit terminé, il faut le vendre. Tout ceci dépasse rapidement les compétences et la force de travail d'un seul homme. Dans sa généralité, l'entreprise est donc un collectif d'individus, une action collective organisée dans laquelle l'autonomie individuelle est plus ou moins respectée 53 .
Une organisation implique des principes de collection et de coordination des facteurs de production, des schémas d'organisation du travail et de systématisation des procédures. Pas d'entreprise sans organisation, en somme, mais une multiplicité de formes organisationnelles, adaptées aux buts et moyens spécifiques de l'entreprise. La structure organisationnelle tente de répondre au mieux à un triple souci de rationalité, c'est-à-dire d'adéquation entre les moyens et les buts fixés, d'efficacité, donc de capacité d'atteindre les objectifs posés, et enfin d'efficience -- soit de l'usage minimal de ressources en vue de la production d'un effet maximal. A partir d'un postulat de rationalité des acteurs, la modalité majeure de l'interaction sociale d'une entreprise serait ainsi la coopération. Celle-ci ne s'accomplit pas sans peine.
L'entreprise est un microcosme dont la vie est chargée, comme tout groupement humain, d'un potentiel de coopération et de discorde 54 . Dans sa réalité organisationnelle, l'entreprise tente en effet de résoudre le problème de l'action collective. Cette réponse est imparfaite par nature, car les interactions sociales y sont entachées d'incompréhension et d'indifférence, de nécessité et pragmatisme, d'asymétries de pouvoir et de compétences, de violence morale ou même physique. L'entreprise a en effet la relation salariale pour logique sociale centrale et la hiérarchie comme principe ordonnateur. De plus, l'entreprise fait l'objet d'attentes variées de la part de ses membres ou de son environnement. Sa logique fonctionnelle est irradiée de rationalités multiples et fluctuantes. Les aspirations de certains individus ou groupes sociaux diffèrent potentiellement de celles de l'organisation 55 . Nier cette réalité équivaudrait à postuler faussement des individus clones dont la personnalité, le milieu social, les compétences, le vécu socioprofessionnel et les aspirations seraient identiques.
L'organisation est profondément tributaire de son environnement sociétal pour sa survie. Sa naissance et son essor impliquent l'identification d'attentes ou de besoins sociaux, exprimés ou latents. L'environnement de l'entreprise lui fournit ensuite des ressources matérielles et immatérielles indispensables à sa fonction de production. La disponibilité limitée des ressources, l'évolution des goûts de consommation et des techniques ou encore le jeu de la concurrence économique remettent sans cesse en question la viabilité de l'organisation. La relation de l'entreprise avec son environnement n'est toutefois pas que pure dépendance. L'entreprise jouit d'une certaine autonomie d'action, qui découle de sa faculté de choix dont elle use à tout moment. L'autonomie de l'organisation est précaire, car sans cesse soumise aux contraintes évolutives de son milieu. « Ce n'est pas une autonomie par défaut, mais une autonomie par conquête 56 . »
La tendance à l'isomorphisme de l'organisation témoigne à la fois de ses efforts rationalisants et de sa dépendance vis-à-vis de son environnement 57 . Soumises à des contraintes opérationnelles similaires et animées d'un même esprit de rationalité, les entreprises ont tendance à développer des solutions organisationnelles convergentes. Les organisations tentent de faciliter leurs interactions mutuelles par une mise en compatibilité qui assure leur survie et leur développement communs 58 . La logique d'isomorphisme trouve cependant ses limites lorsque les organisations partagent le même objectif fonctionnel, dans quel cas elles entrent en concurrence directe. Face à ses concurrentes, l'entreprise est tiraillée entre les contraintes dialectiques de compatibilité et de différenciation.
Dans une logique de compétition économique, la spécificité de l'organisation devient partie intégrante de son avantage comparatif. La spécificité de l'organisation découle de la difficile et complexe articulation de l'interne et de l'externe, de la laborieuse conciliation des impératifs de production et des nécessités de marché. Le facteur humain joue un rôle prépondérant, au sein comme en dehors de la firme. L'enjeu de survie et de prospérité de l'entreprise réside dans sa capacité à mobiliser des ressources physiques et humaines et à coordonner des efforts collectifs par la mise en compatibilité des divers intérêts des individus et des groupes 59 . Pour la viabilité de l'entreprise, le patron, l'employé, le fournisseur et le consommateur doivent partager un consensus minimal sur son existence et son fonctionnement. Quelles que soient ses modalités organisationnelles, l'entreprise fédère des compétences et des intérêts variés autour d'un projet commun, basé sur une communauté de valeurs que la culture d'entreprise cristallise et renforce. Cette faculté fédératrice, l'entreprise la doit à sa dimension institutionnelle.
Un projet d'entreprise suppose de la part de ses adhérents un apprentissage relationnel mutuel. Cette stabilisation comportementale s'effectue grâce à des normes et des procédures. La spécificité de l'organisation résulte d'une alchimie génératrice de comportements individuels, potentiellement différents dans leur contribution au projet collectif de ce qu'ils seraient s'ils intervenaient isolément ou dans un autre contexte organisationnel 60 . Autrement formulé, une entreprise est un système social qui dépasse et transcende la somme de ses parties. L'apprentissage intervient aussi dans la relation de l'organisation avec son milieu social. L'entreprise est donc le lieu d'un ardu apprentissage collectif 61 .
3° L'institution
La fonction institutionnelle de l'entreprise consiste dans l'identification des attentes sociétales, implicites et explicites, formulées à son égard, ainsi que dans la mise en oeuvre d'une forme de réponse politique à ces attentes 62 . L'institution sociale est un corps régulateur des rapports sociaux ; elle définit parmi les individus un système de rôles et participe pleinement à l'architecture sociale 63 . Elle arbitre les conflits plutôt qu'elle ne les supprime. La vertu première de la dynamique institutionnelle n'a toutefois pas trait à un irrésistible et mystérieux pouvoir d'arbitrage. Elle tient plutôt en la mise en compatibilité d'attentes et de projets hétérogènes formulés par des groupes sociaux de force inégale 64 . Historiquement, les institutions politiques sont nées de l'interaction de divers groupes sociaux qui développent par des procédures et des structures organisationnelles des solutions à leurs différends 65 .
L'institution confère à l'organisation son caractère politique, sa substance sociale, son dynamisme ainsi que ses spécifications culturelles, historiques et symboliques. L'institution gère politiquement les intérêts de ses membres que sa réalité organisationnelle met en relation. Le contenu socioculturel de son activité se définit principalement par le système légal et juridique dans lequel elle s'insère. L'institution relativise et met en perspective historique et culturelle la multiplicité des solutions organisationnelles. Au fonctionnalisme plutôt statique de l'organisation, l'institution ajoute la dynamique des relations sociales qui se nouent en elle comme en dehors d'elle autour des représentations, des normes et des valeurs 66 . L'institution en tant que structure d'organisation sociale est un système normatif, récipiendaire et productrice de valeurs, de normes et de pratiques socialement sanctionnées. L'institution génère du sens. Au niveau macrosocial, le sens se rattache à la fonction sociétale et à la légitimité de l'institution. Sur le plan microsocial, il transparaît notamment au travers du sentiment d'appartenance, voire d'identification de l'individu au groupe social dont il est membre. L'institution tisse en son sein et autour d'elle un réseau symbolique, lui aussi socialement sanctionné, qui contient une part d'imaginaire 67 .
L'institutionnalisation des diverses formes d'action collective d'une société intervient par leur structuration et leur systématisation. Les institutions ainsi créées conditionnent les modalités du lieu et du moment de la vie sociale. La modernité occidentale des XIXe et XXe siècles consacre la prééminence institutionnelle de l'Etat. L'entreprise commerciale paraît avoir pris le relais. Elle joue un rôle de premier plan dans le formidable essor des réseaux et des échanges socio-économiques qui caractérisent l'industrialisation des sociétés occidentales 68 . Certaines entreprises commerciales ont ainsi crû considérablement en taille et en incidence sociale. Elles étaient autrefois un maillon dans une chaîne de production économique, maillon dont la vivacité dépendait essentiellement de sa capacité de coordination des ressources productives. Elle n'exerçaient qu'une influence réduite sur leur environnement. Dans sa forme contemporaine, la grande entreprise concentre des ressources considérables par l'intégration accrue de ses processus de fabrication ainsi que par l'augmentation du nombre de ses unités productives. Même si la grande entreprise tend parfois à limiter ses échanges marchands par une stratégie d'intégration verticale du procès productif, elle multiplie et diversifie ses interactions sociales en raison du caractère multi- ou transnational de ses opérations. Outre l'impact de sa fonction productive, l'entreprise influence le progrès technique, le niveau d'emploi, les modes de vie et les normes juridiques. Elle contribue à l'homogénéisation et à la différenciation culturelles. Il est peu d'aspects de la vie d'un individu au XXe siècle qui ne soient, directement ou indirectement, liés à l'existence de la grande entreprise 69 .
Le phénomène économique a également gagné en importance au fil des siècles, à tel point que l'entreprise dans son acception abstraite a également accédé au statut d'institution. En effet, l'essor de la vie économique depuis le XVIIIe siècle s'est accompagné de changements sociaux majeurs au sein des sociétés modernes occidentales. La dynamique a notamment permis une élévation sans précédent du niveau de vie des populations. Plus négativement, les deux siècles d'activité économique des sociétés industrielles modernes ont largement usé des ressources naturelles -- en particulier de combustibles fossiles -- de la planète. L'entreprise, dans la réalité organisationnelle de ses grandes unités comme dans son acception abstraite, est désormais une « affaire de société 70 . » Institution sociale centrale de la modernité 71 , l'entreprise moderne génère logiquement d'importantes attentes sociales à son égard.
L'institution simultanément stimule et castre l'action. Anthony Giddens estime que la définition relativement stable de règles et de ressources au sein de l'institution à la fois facilite l'action individuelle et collective et la canalise au sein des structures existantes 72 . L'institution conjugue ainsi habilitation (liberté) et contrainte (discipline) 73 . Elle socialise, met en compatibilité, facilite l'apprentissage plutôt qu'elle n'uniformise 74 . D'elle naissent des amitiés, inimitiés, de la solidarité et de l'exclusion, un sentiment identitaire ou de rejet. Elle sécurise et protège ses membres par la garantie matérielle qu'elle offre, alors qu'elle les contraint et les discipline par ses règles et principes fonctionnels. En ses murs sont négociés salaires, conditions de travail, qualifications professionnelles, gestion de l'espace et du temps. L'entreprise édicte ses propres règlements, lois et procédures. Elle crée des professions techniques ou sociales telles que vérificateur interne, comptable ou responsable en ressources humaines. Elle met en oeuvre des politiques d'embauche, de communication, de gestion des hommes et des biens. Ces pratiques sont institutionnalisées tantôt au sein de l'entreprise, tantôt en collaboration avec d'autres institutions tels les pouvoirs publics.
 Encadré 1 : L'institutionnalisation de l'entreprise
Encadré 1 : L'institutionnalisation de l'entreprise
Institution, l'entreprise se met en scène, découvre son histoire, s'invente des mythes, des rites et des tabous, soigne son image. Nourrissant la mémoire collective et une «culture» spécifique, les mythes sont de grands projets rassembleurs qui tirent leur force de l'histoire pour mieux vivre le présent et penser l'avenir. L'entreprise institue des rites d'initiation ou d'accomplissement qui solennisent l'appartenance au groupe. Elle identifie des tabous qui sont autant de gardiens du temple de l'imaginaire collectif. Elle érige des personnalités en modèles et en figures emblématiques 75 . La capacité de l'entreprise d'infléchir les comportements individuels au profit des menées collectives résulte à la fois d'une pure logique hiérarchique et d'un processus d'apprentissage mutuel. L'entreprise cousine l'école par l'apprentissage collectif, la famille par le sentiment identitaire.
Acteur économique, l'entreprise est une institution sociopolitique aux spécificités historiques et culturelles. Les valeurs et les normes sociales du moment et du lieu déterminent les diverses attentes et sensibilités quant à la fonction et la forme de l'entreprise. Dans ce contexte, les caractéristiques organisationnelles constitueraient l'élément invariant et universel, alors que les valeurs culturelles spécifieraient l'entreprise en un lieu et en un temps donnés 76 . La dimension institutionnelle de l'entreprise se distingue de plus par sa propriété de rémanence. La capacité d'influence de l'entreprise sur les valeurs et les normes sociales de son milieu sociétal se prolonge au-delà du déclin et de la disparition de sa réalité organisationnelle. La rémanence de l'entreprise se concrétise par deux biais. Elle contribue à l'élaboration de normes sociales et législatives qui survivront potentiellement à ses diverses formes organisationnelles. Elle influence les représentations collectives et abstraites qui ne s'éteignent pas avec la disparition d'une entreprise, d'une forme organisationnelle ou d'un produit.
Une organisation recherche généralement sa survie et sa pérennité. Le défi peut se formuler en termes d'utilité sociale, c'est-à-dire d'adéquation fonctionnelle par rapport aux attentes sociales. Dans sa dimension organisationnelle, une entreprise est généralement viable si sa production est utile à la société 77 . Elle l'est également si elle est capable d'efficience productive et d'adaptation à l'évolution de son milieu opérationnel. S'y ajoute le souci de légitimité qu'entretient toute institution. La légitimité a un sens étymologique de fondé en droit et ou en justice 78 . Elle est la perception généralisée ou le postulat que les actions d'une entité sont désirables ou appropriées au sein d'un système de valeurs, de croyances et de définitions 79 . La notion dépasse donc ici la simple autoperception par l'entreprise de l'utilité de son activité pour revêtir plus largement l'acception fonctionnelle et morale de bien public désirable 80 . Elle comporte ainsi une évaluation fonctionnelle de l'utile et du superflu, une appréciation morale du convenable et de l'inacceptable.
* * *
L'entreprise moderne est une institution complexe dont l'efficience et le dynamisme se décodent à travers l'évolution de ses formes organisationnelles 81 . Organisation, l'entreprise institutionnalise peu à peu ses relations sociales et ses procédures internes, ses relations avec son environnement, écrit son histoire propre. Institution, l'entreprise devient une idée abstraite et singulière, concrétisée à travers ses multiples formes organisationnelles. L'organisation est mortelle, alors que l'institution est plus pérenne 82 . C'est donc principalement au travers de sa dimension institutionnelle que l'entreprise atteint son objectif de durabilité. Des tensions peuvent ainsi surgir, telle la difficile conciliation de la logique d'efficacité qui habite l'organisation et le souci d'équité et de légitimité que cultive l'institution.
A problème complexe, réponses plurielles. La variété fonctionnelle de l'entreprise procède principalement des différences de valeurs et de normes sociales qui l'habitent et qui l'entourent. Les valeurs sont des conceptions du désiré ou du préférable, alors que les normes représentent les instruments légitimés pour atteindre les buts valorisés 83 . Les valeurs ne sont guère directement observables. Elles sont des constructions hypothétiques qui transparaissent dans le discours ou l'attitude 84 . Quant aux normes, elles sont plus explicites et visibles dans le comportement individuel et collectif. Leur valeur est absolue dans l'expression de l'idéal moral ultime d'une société. Elle est relative au vu du respect inégal des normes dans les pratiques sociales 85 .
La valorisation sociale de l'activité économique pendant l'Antiquité grecque était infiniment moindre que dans les sociétés occidentales contemporaines. De façon similaire, les attentes sociales envers la libre entreprise exprimées de nos jours aux Etats-Unis, au Japon et en Suisse ne sont pas uniformes. Il n'est pas un capitalisme, mais des variantes de capitalisme. La forme et la fonction de l'entreprise ne dépendent pas uniquement et abstraitement d'un certain niveau technique. L'entreprise est à la fois un produit sociohistorique et socioculturel, reflet des valeurs et des normes prédominantes dans une société à un moment spécifique de son histoire.
B. La citoyenneté
La citoyenneté marque l'appartenance de l'individu à un groupe politique 86 . Par la définition de droits et de devoirs, elle met en relation l'individu et le groupe, l'autonomie et la mutualité, la liberté et l'égalité. La citoyenneté témoigne de la faculté de l'individu à participer activement à divers projets collectifs. Sous ses auspices s'élaborent certaines formes de solidarité collective. La citoyenneté crée un espace public défini comme « l'institution des intervalles qui relient sans intégrer 87 ». Cette agora permet l'insertion politique, sociale et économique de l'individu dans la société civile. La citoyenneté nourrit chez l'individu son identité, la teinte de moralité, la colore de passions. Mais l'espace civique est hétérogène. Les individus y affirment leurs affinités comme leurs différences, et y établissent de multiples points d'ancrage.
La citoyenneté comporte un quintuple référentiel -- juridique, politique, social, moral et symbolique. La citoyenneté est d'abord une notion juridique. Elle insiste sur l'appartenance du sujet de droit à la communauté. Détenteur de droits et de libertés de nature civile et politique, le citoyen assume également diverses obligations, elles aussi définies par le débat démocratique. La citoyenneté est ensuite un principe de légitimité politique. Il se réfère à la participation de l'individu au débat démocratique. De la participation au jeu politique découlent les principes d'égalité et de codécision du citoyen qui jouit des droits civiques attachés à la nationalité et des libertés publiques 88 . La citoyenneté est encore la source du lien social. L'égalité politique et juridique du citoyen se traduit par la reconnaissance de sa dignité d'homme 89 . La citoyenneté fait alors appel à la logique solidaire qui unit toute collectivité sociale. Sous l'angle moral, la citoyenneté complète la réglementation légale du comportement individuel ou groupal. Par des valeurs et des normes communes, elle régit la responsabilité individuelle et collective lorsque celle-ci n'est pas définie par la loi. Enfin le symbolisme de la citoyenneté évoque un dénominateur culturel commun et s'observe au travers de la volonté, explicite ou implicite, de vivre ensemble 90 .
L'idée force de la citoyenneté -- l'appartenance à la Nation comme source de sentiment identitaire chez l'individu -- est fortement connotée de symbolisme. En réalité, la Nation n'est pas forcément un référentiel identitaire de l'individu, du moins pas le seul. L'adhésion du citoyen à la communauté nationale peut être pragmatique, partielle et ambiguë. Le citoyen peut lui préférer un cadre identitaire plus restreint, tel que la famille, le groupe d'amis, l'entreprise, la région géographique ou la communauté linguistique. De même, l'indépendance de jugement ou la responsabilité qui caractériseraient le citoyen démontrent d'évidentes limitations en pratique. De façon similaire, la mise en oeuvre du triptyque républicain liberté - égalité - fraternité souffre de criardes imperfections. Ces principes valent bien davantage par l'idéal citoyen qu'ils véhiculent. En somme, le symbolisme de la citoyenneté nourrit son caractère idéal-typique.
La substance de la citoyenneté a considérablement fluctué depuis sa première formulation durant l'Antiquité. L'étymologie du terme est latine (civis), alors que le «politique» nous vient du grec, où il signifie notamment « activité attendue des citoyens 91 . » Au Moyen Age, le terme se rattache au droit de cité, qui marque l'appartenance politique à une Ville libre. L'analyse des conceptions antique, médiévale et moderne de la citoyenneté occidentale permet l'identification des éléments susceptibles de concerner l'entreprise.
1° La citoyenneté à travers l'histoire
L'invention du politique, au sens d'un domaine autonome de la vie sociale, est à créditer à la Grèce antique des VIe au IVe siècles avant notre ère. Dans sa Politique 92 , Aristote, définit la polis comme la communauté des citoyens, distincte du reste du corps social -- la société civile --, et plus encore des peuples non organisés en société politique. Corps intermédiaire entre l'individu et l'Etat, la polis a pour finalité le bien-être des citoyens et représente la seule source de légitimité politique et judiciaire. Elle cultive entre ses membres un esprit d'égalité politique qui fait d'elle la première forme historique d'organisation démocratique. Jalouse de ses prérogatives, la république athénienne se veut exclusive. La polis aristotélicienne est une communauté définie selon des critères géographiques, ethniques et sociaux. La citoyenneté est la marque élitiste d'hommes libres, propriétaires et riches 93 . Tout à la vie de la polis, le citoyen athénien n'a rien d'un homo economicus. Il dédaigne les activités manuelles et commerciales qui ne sont que des moyens de subsistance, alors que l'idéal philosophique grec est épris de finalité et d'élévation morale 94 . Conséquemment, ces tâches indignes du citoyen sont partiellement dévolues aux esclaves 95 .
La Rome antique accouche de la conception juridique de la citoyenneté. La notion désigne désormais une catégorie administrative composée de sujets de droit, dont l'interaction est gouvernée par la loi. De par son élargissement de principe aux étrangers, la citoyenneté romaine ensemence la portée universaliste moderne du concept 96 . Le sens politique de la citoyenneté développé par les Grecs s'en trouve affaibli. La citoyenneté n'est plus cet attribut politique d'un corps intermédiaire de privilégiés, car son caractère exclusif s'est émoussé ; le jeu politique n'arbitre plus directement les relations entre citoyens.
Sous l'Ancien Régime français, la citoyenneté s'enrichit d'un contenu économique par deux biais. Tout d'abord, la Cité-Etat médiévale attribue l'attribut citoyen au bourgeois commerçant dans le cadre restreint de sa juridiction. La citoyenneté est un signe d'appartenance politique auquel sont attachés des privilèges économiques qui concurrencent les titres nobiliaires. Le bourgeois citoyen peut ainsi mieux peser de son poids économique le long combat de résistance de la Ville libre contre le mouvement centripète exigé par le pouvoir monarchique. En vain puisque dans la France de la fin du XVIIIe siècle, le droit de cité ne représente plus qu'une source d'inégalité sociale que le jeune Etat moderne s'applique à abolir 97 . Deuxièmement, la citoyenneté devient durant les XVIIe et XVIIIe siècles un instrument économique d'affirmation politique. Le philosophe des Lumières, le petit peuple sans doute aussi, rêvent d'une société politiquement et économiquement plus égalitaire. Quant à la petite bourgeoisie entrepreneuriale, ses accomplissements économiques souffrent de l'étouffoir absolutiste et des privilèges aristocratiques : la citoyenneté promise par l'Etat moderne représente pour elle la revendication politique propice à l'expression de ses ambitions économiques.
Les révolutions française et américaine cristallisent la conception moderne et classique de la citoyenneté 98 . L'individu s'en remet à sa raison pour guider ses rapports sociaux, délaissant la morale religieuse. L'affranchissement de l'individu vis-à-vis de l'autorité politique abolit le rapport de sujétion envers le pouvoir monarchique. L'individu exige sa plus grande participation à la vie politique par la définition de ses droits politiques. Enfin l'égalité politique des citoyens qui confère à la notion un caractère universel. La citoyenneté moderne s'exprime dans la nouvelle organisation politique qui relie l'Etat à la Nation. Elle transpose les principes politiques de liberté et d'égalité dans le domaine économique : la liberté d'entreprendre du citoyen lui permet de contribuer à une société plus égalitaire 99 . Le caractère fraternel et symbolique de la citoyenneté se décode au travers du lien civique, lequel représente dans l'espace public l'archétype du lien social. La citoyenneté aspire alors à devenir « une qualité abstraite qui rejette dans l'ombre les inégalités concrètes de statut social et de compétence politique 100 . »
* * *
Au bilan, la citoyenneté démocratique moderne naît en trois phases. A grands traits, le XVIIIe siècle représente la période formatrice des droits civils et de l'Etat de droit. Le XIXe siècle enfante les droits politiques et la démocratie libérale. Enfin au XXe siècle apparaissent les droits sociaux et l'Etat-providence 101 . Les temps prémodernes forgent les droits civils du citoyen. L'individu revendique une autonomie d'action dans la vie économique face à la puissance publique. Les révolutions américaine et française inaugurent la deuxième phase historique du développement de la citoyenneté par l'affermissement de sa dimension politique. Le citoyen aspire désormais à participer plus directement au jeu démocratique et à jouir d'une large autonomie d'action dans le domaine économique. Au XXe siècle enfin, la citoyenneté acquiert sa dimension sociale. Elle tente de reproduire l'égalité civile et politique du citoyen dans la vie sociale. Les débats démocratiques concernent l'étendue des droits sociaux du citoyen avec pour enjeu la réduction des inégalités sociales.
2° Théorisations et valeurs citoyennes
Une fois mise en lumière la superposition historique des différentes composantes de la citoyenneté, il reste à expliciter les attributs du statut de citoyen et les valeurs comportementales rattachés au concept. Si elle fonde la liberté individuelle moderne, la citoyenneté grecque marque surtout une volonté politique de conservatisme social 102 . Dans une fameuse oraison funèbre rapportée par Thucydide 103 , Périclès définit les attributs du citoyen : l'égalité face à la loi, l'égalité d'expression devant l'assemblée ; la liberté privée moyennant le respect de la loi, la liberté publique par la participation obligatoire à la vie politique 104 . L'homme politique athénien dégage ainsi trois valeurs symboliques associées à la citoyenneté démocratique, soit l'implication politique active, l'amour de la patrie et la fraternité solidaire entre les citoyens (philanthropie) 105 .
Tout à son souci de concevoir un Etat moderne, la philosophie politique des Lumières conçoit en revanche la citoyenneté comme la pierre de voûte d'une nouvelle architecture sociale. Elle tente de concilier l'aspiration libertaire et égalitaire de l'individu avec la nécessité d'un Etat dépositaire de la puissance publique. Les théorisations libérale et républicaine proposent chacune à leur manière la transcendance de l'intérêt particulier du citoyen. La conception libérale de la citoyenneté suggère un pacte social basé sur la confiance (trust), tel que théorisé notamment par John Locke à travers ses Deux Traités 106 . Afin de transcender les intérêts particuliers, la conception républicaine de la citoyenneté compte sur la soumission plus entière et plus formelle à la volonté générale, ce que formule Jean-Jacques Rousseau dans son Contrat social 107 . La citoyenneté républicaine insiste sur le dépassement des intérêts particuliers en faveur du bien commun, ainsi que sur la participation égalitaire aux affaires de la cité 108 . Le vieux débat entre les conceptions libérale et républicaine de la citoyenneté démocratique perdure aujourd'hui au travers des courants théoriques libéral (liberal-individualist) et «communautariste» (communitarian). John Rawls et son Political Liberalism exemplifient la première tendance, The New Golden Rule d'Amitai Etzioni la seconde.
La théorisation libérale distingue nettement les sphères publique et privée de la vie sociale. La citoyenneté est un statut qui n'induit guère d'obligation ou d'allégeance à la communauté. L'unique obligation morale du bon citoyen est le respect de ses concitoyens tel que défini par la loi. Le juste est donc préféré au bien. La notion de bien est appréciée individuellement, si bien que la vertu du citoyen découle de son droit d'accéder à l'espace public et de poursuivre, de manière autonome et libre, sa conception du bien 109 . La distinction entre les sphères publique et privée justifie la neutralité des institutions ; celles-ci ont pour premier objet la protection des droits individuels et la garantie de leurs libertés 110 . Elles préservent l'autonomie de l'individu, sa faculté critique, et la définition de ses objectifs personnels. La neutralité des institutions est purement fonctionnelle, adressée aux seuls processus 111 . En conséquence, les objectifs et les résultats des activités institutionnelles peuvent refléter les intérêts d'une minorité sociale.
La théorisation communautariste opère une distinction lâche entre les sphères privée et publique d'une société. La citoyenneté implique la participation politique active de l'individu. La sphère publique cimente la communauté par les liens de solidarité qui s'y nouent. Le jeu politique moralise l'individu par la vertu civique. Le droit est ainsi indissociable du devoir, comme la liberté de la responsabilité. Cette double imbrication crée chez le citoyen des constantes comportementales qui confèrent à l'ordre civil toute sa stabilité 112 . Le citoyen subordonne ses intérêts privés aux menées collectives. Les institutions ne sont pas neutres, car produites par la culture et de l'histoire des sociétés dans lesquelles elles s'enchâssent. Elles supposent ainsi la définition du bien commun et de vertus civiques pour y parvenir. Une telle définition fonctionnelle des institutions n'est pas seulement souhaitable, mais nécessaire, car la viabilité institutionnelle est tributaire de normes comportementales et de vertus morales 113 .
Les deux courants théoriques de la citoyenneté présentent plusieurs faiblesses. Les citoyens contemporains sont moins unis par la métaphore d'un contrat politique que par leur participation à la vie socio-économique. L'enjeu collectif contemporain se pose aujourd'hui en termes de redistribution des richesses au nom de valeurs communes 114 . Ensuite la citoyenneté libérale pose le respect de la loi comme la garantie d'un comportement social adéquat. Sans responsabilisation individuuelle, le garde-fou légal n'assure ni l'ordre moral ni l'harmonie sociale. La citoyenneté communautariste assortit plus clairement le respect de la loi de considérations morales. Cependant le degré effectif de participation du citoyen à la chose publique n'est pas aisé à trouver en pratique. Faible comme dans le cas français, la participation politique directe du citoyen se limite souvent à l'expression parfois violente de doléances socio-économiques. Forte comme dans la démocratie helvétique, l'implication du citoyen est parfois abusive et contrecarre alors le jeu institutionnel. Ceci posé, les théorisations libérale et communautariste de la citoyenneté s'accordent sur une idée maîtresse. En adhérant à un projet de société le citoyen accepte une certaine limitation de ses libertés, ce qui lui permet de tirer parti des droits qui lui sont reconnus. Le citoyen jouit dans la sphère publique d'un droit d'initiative et de participation pour autant qu'il serve également ou du moins ne desserve pas la réalisation de visées collectives. La légitimité de l'exercice des droits individuels est ainsi conditionnelle et soumise périodiquement à réexamen.
* * *
Reste à définir les caractéristiques foncières du comportement citoyen. Dans son Ethique à Nicomaque 115 , Aristote identifie la justice et l'amitié comme les deux concepts clé du fonctionnement harmonieux de la polis. L'amitié revêt dans le contexte politique le sens de concorde, soit de l'accord entre les citoyens sur leurs buts communs. La justice est une vertu au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire un moyen terme entre l'excès et la déficience -- en l'occurrence entre le légalisme et l'injustice. Rawls définit quant à lui la société démocratique et libérale comme un juste (fair) système of coopération dans le temps et entre les générations. La justice (fairness) requiert la tolérance. Les citoyens facilitent leur coopération mutuelle grâce à deux facultés morales principales : la capacité d'appréciation du juste et du bien 116 . Enfin Etzioni préconise la pondération des libertés individuelles au sein d'un ordre social consensuel et évolutif, basé sur l'adhésion volontaire des individus. L'autonomie du citoyen est dès lors socialement construite ; le comportement individuel se déduit des valeurs et des convictions personnelles, lesquelles sont reconnues et partagées à des degrés divers par le reste de la collectivité 117 .
La qualité première du citoyen face à ses pairs serait pour Aristote la modération, selon Rawls la justice, la tolérance et le bon sens, alors qu'Etzioni penche pour la morale individuelle éclairée par le sens du bien commun. Les trois formulations suggèrent l'idée d'un individu citoyen responsable de ses actes, apte à éclairer son intérêt propre par les considérations morales de solidarité, de tolérance, de dignité et de justice. Vis-à-vis de la puissance publique, les qualités citoyennes essentielles seraient la soumission à la puissance publique, la participation loyale au débat démocratique ainsi que le respect de ses décisions 118 . Quant au cadre institutionnel d'exercice des vertus citoyennes, il cultive dans les sociétés occidentales modernes les valeurs fortes de liberté et de dignité individuelles, de pluralisme démocratique, de règle de droit et de justice sociale 119 .
Il est difficile de préciser davantage le comportement et les qualités du citoyen, car la notion est en crise et en pleine mutation. Participation effective du citoyen à la vie politique, équilibre entre les droits et les devoirs individuels, équilibre encore entre l'autonomie du citoyen et la cohésion sociale, intégration politique des migrants, nouvelles formes de solidarité institutionnelle sont autant de défis effectifs posés à la citoyenneté contemporaine. Les dynamiques régionales d'unification politique et économique enfièvrent même certains esprits quant à la pertinence d'une citoyenneté post-nationale, par exemple à l'échelon européen 120 . Pour ceux-ci, la superposition des notions de citoyenneté et de nation est plus historique que logique ; elle serait surtout anachronique. Quoi qu'il en soit, la référence citoyenne est en vogue. Preuve en est son apposition à toutes sortes d'entités collectives, telle l'entreprise.
C. La citoyenneté de l'entreprise
L'implacable logique marchande paraît aujourd'hui laminer l'idéal philosophique citoyen. Au XVIIIe siècle, la doctrine libérale n'envisage pourtant pas un tel divorce. Elle esquisse une société moderne dans laquelle le productivisme et la citoyenneté concourent à l'égale dignité de chacun 121 . Le projet libéral formule alors une véritable économie politique. Ardent promoteur du libre marché dans sa Richesse des nations, Adam Smith se fait par sa Théorie des sentiments moraux l'apologue de la citoyenneté en tant que source d'éthique individuelle :
« Man, according to the Stoics, ought to regard himself, not as something separated and detached, but as a citizen of the world, a member of the vast commonwealth of nature. To the interest of this great community, he ought at all times to be willing that his own little interest should be sacrificed. Whatever concerns himself, ought to affect him no more than whatever concerns any other equally important part of this immense system. We should view ourselves, not in the light in which our own selfish passsions are apt to place us, but in the light in which any other citizen of the world view us. [...]He is not a citizen who is not disposed to respect the laws and to obey the civil magistrate ; and he is certainly not a good citizen who does not wish to promote, by every means in his power, the welfare of the whole society of his fellow-citizens 122 . »
Sous l'influence de l'éthique stoïcienne qui prône l'harmonie de l'homme avec la nature, Smith définit comme qualités premières du citoyen son comportement solidaire fondé sur son sentiment d'appartenance à la collectivité et son sens du bien commun. Ses vues sont ainsi très similaires à celles d'Aristote, de Rawls et d'Etzioni. Smith enrichit le tableau d'une touche supplémentaire : le «bon» citoyen est disposé à faire davantage que respecter la loi ; il est capable d'initiatives philanthropiques. Le philosophe écossais estime en effet que la sympathie pour autrui (la solidarité) et le regard de l'autre (la vanité ou le désir de reconnaissance) influencent profondément l'action humaine 123 . Smith ne décèle pas de contradiction majeure entre son oeuvre philosophique et économique. Selon lui, les sphères économique et sociale sont régies par des principes distincts, l'égoïsme pour la première et l'altruisme pour la seconde. Séduit par l'efficacité économique du marché, l'économiste philosophe n'envisage pourtant pas son extension à l'entièreté de la vie sociale 124 . L'étanchéité entre la vie économique et la vie sociale n'est pas totale non plus, car l'homo economicus est capable d'une solidarité pragmatique. A n'en point douter, le capitalisme moderne a suivi un cours non envisagé par Adam Smith. Ses vues se situent pourtant en point de mire de l'affirmation citoyenne de l'entreprise contemporaine.
L'acception juridique de la citoyenneté insiste sur l'appartenance du sujet de droit à la communauté. A cet égard, l'entreprise transnationale ne peut revendiquer stricto sensu une quelconque citoyenneté. L'attribut citoyen est réservé à l'individu jouissant de sa capacité civique. Dans sa forme juridique de société par actions, l'entreprise est le plus souvent un collectif d'individus dont l'unité n'existe qu'au travers de sa qualité de personne morale -- fiction légale imaginée pour réduire le risque financier encouru par l'investisseur. L'entreprise commerciale est soumise au régime juridique du droit des sociétés, distinct du droit civil qui concerne la personne physique. L'affirmation citoyenne de l'entreprise est ainsi d'ordre métaphorique. La métaphore n'est pas sans substance cependant. Elle redéfinit les binômes droits/devoirs et libertés/responsabilités de l'entreprise et des individus qui la composent en renforçant leur second terme. La liberté d'action est tempérée par la conscience de ses limites légales et morales. En bref, la citoyenneté de l'entreprise tend vers la théorisation communautariste du comportement social.
Dans sa dimension politique, la citoyenneté est un principe de légitimité politique. L'entreprise est pourtant tout sauf une démocratie. Ses schémas organisationnels et ses principes fonctionnels s'accommodent mal de principes démocratiques telle la représentation politique du citoyen. La démocratie industrielle reste un mythe, en dépit d'un certain pouvoir de co-décision attribué au travailleur dans le capitalisme rhénan et d'une tendance contemporaine à l'aplatissement des hiérarchies 125 . L'affirmation citoyenne de l'entreprise fait plutôt référence à sa fonction institutionnelle et publique 126 . Par une allusion à un pacte social, elle reconnaît son enchâssement social, subissant l'influence de son milieu comme concourant à son évolution 127 . En mal de légitimité politique, l'entreprise énonce son ethos politico-économique : soumission à la puissance publique, observance des dispositions légales, participation loyale au débat démocratique et respect de la dignité humaine 128 .
Un tel manifeste est entaché d'une ambiguïté fondamentale. L'entreprise vise-t-elle à épauler ou à supplanter la puissance publique ? L'affirmation citoyenne de l'entreprise transnationale intervient alors que la mondialisation économique dont elle nourrit le dynamisme mine la souveraineté politique de l'Etat-nation, Etat dont la gouverne économique et la générosité sociale se sont déjà amenuisées dans le dernier quart de siècle. D'aucuns dénoncent dès lors dans le discours citoyen de l'entreprise l'aveu public de ses ambitions politiques autrefois souterraines 129 . Plus sobrement, l'ambition citoyenne de l'entreprise appelle à une nouvelle délimitation des sphères privée et publique 130 . Enfin l'engagement public de l'entreprise est dicté par des considérations moins morales qu'économiques : un acteur économique ne peut être compétitif si son milieu opérationnel ne l'est pas. L'extension de la logique marchande à la sphère publique n'est pas sans équivoque pour la réalisation du bien commun 131 .
La citoyenneté est encore la source du lien social. Elle reporte dans la vie sociale l'égalité politique et juridique du citoyen et fait appel à la logique solidaire qui unit toute collectivité sociale. Si elle se dénie tout rôle de bouc émissaire, l'entreprise ambitionne par sa citoyenneté au raffermissement du lien social que son activité économique contribue à distendre. En interne, l'entreprise promeut l'esprit de corps. Vis-à-vis du reste du corps social, ses diverses actions philanthropiques visent en principe à renforcer la cohésion sociale. Par sa citoyenneté, l'entreprise contemporaine occidentale se présente ainsi comme dépositaire et productrice de valeurs telles que l'intégrité, la solidarité, la confiance, la tolérance et la non-discrimination. Dans le monde anglo-saxon contemporain, elle se pose en tant que pôle central de régénération des relations sociales face au déclin de la famille et de l'Etat. D'aucuns estiment cette ambition institutionnelle de l'entreprise incompatible avec sa fonction productive 132 . D'autres y voient l'instrumentalisation du le lien social 133 . En tout état de cause, l'entreprise ne précise guère grâce à sa citoyenneté sa responsabilité éventuelle dans la redistribution sociale des richesses qu'elle crée par son activité productive.
Sous l'angle moral, la citoyenneté complète la réglementation légale du comportement individuel ou groupal. Elle régit par des valeurs et des normes communes la responsabilité individuelle et collective lorsque celle-ci n'est pas définie par la loi. Ni fondamentalement individualiste ni éminemment altruiste, le comportement citoyen procède d'un intérêt personnel bien compris, éclairé et élargi par la conscience de l'intérêt public. Par sa citoyenneté, l'entreprise entend dès lors dépasser les requis légaux en matière environnementale et sociale au travers de diverses initiatives à vocation philanthropique. On peut relativiser à double titre le caractère moral des actions citoyennes. En matière réglementaire, l'entreprise revendique généralement un niveau minimal de dispositions contraignantes qu'elle assortit de quelques initiatives de son crû. Par ailleurs, le caractère volontaire des actions citoyennes est sujet à caution, car celles-ci résultent souvent de pressions sociales exercées sur l'entreprise.
Enfin le symbolisme de la citoyenneté évoque un dénominateur culturel commun et s'observe au travers de la volonté, explicite ou implicite, de vivre ensemble. La citoyenneté comporte des droits et des obligations comportementales. La citoyenneté de l'entreprise se réfère ainsi à sa qualité d'acteur social membre d'une communauté et titulaire de prérogatives et de responsabilités. Elle revendique l'autonomie du citoyen responsable publiquement de ses actes 134 . Elle affirme son intégrité comportementale et son sens du bien comme par la compatibilité de son ethos d'action avec les valeurs sociales 135 .
Par son affirmation citoyenne, l'entreprise fait allusion à la symbolique du contrat social qui l'unit à la société. L'entreprise est en effet régie par deux types de charte. L'une est formelle et écrite : la loi reconnaît à la société par actions certains droits et prérogatives pour faciliter ses activités, mais établit sa responsabilité vis-à-vis de ses propriétaires et autres partenaires. La seconde charte est informelle et tacite : comme toute institution, l'entreprise dépend pour sa légitimité de sa capacité à satisfaire les attentes sociales exprimées à son égard, entre autres la couverture des besoins économiques de la société 136 . Un pacte social vise au dépassement des multiples clivages d'une société démocratique sur la base de dispositifs légaux enrichies de considérations morales. L'allusion symbolique au contrat social ne formule rien de moins qu'une nouvelle équation de gouvernance. A l'instar du contrat social, la gouvernance régule l'interaction sociale non seulement par la loi, maiségalement par le contrat, la bonne foi et la réputation. Les deux notions évoquent l'exercice partagé du pouvoir démocratique par le dépassement des clivages sociaux grâce à des normes légales et morales. Toutes deux redéfinissent, non sans équivoque, la frontière des sphères publique et privée. Avec quelle légitimité l'entreprise s'affiche-t-elle sur l'agora ?
Le capitalisme occidental module ses réponses à ce difficile questionnement. Au XVIIIe siècle, Adam Smith définit le pacte social passé entre l'entreprise et la société : liberté d'entreprendre contre progrès économique et social. Si le gouvernement « laisse faire », l'entreprise améliore grâce à la division du travail sa contribution à la richesse des nations 137 . Le contrat social smithien postule ainsi l'automaticité du lien entre le progrès économique et social. Au début du XXe siècle, le compromis fordiste amende un peu ce bel optimisme. Il reconnaît le mal nécessaire d'une gouverne étatique et lie plus explicitement le progrès économique et social. La paix sociale est garantie si l'augmentation de la productivité se reflète dans la rémunération du travail 138 .
La fin de la croissance dorée de la période 1945-1975 dénonce le compromis fordiste. L'Etat keynésien et providence n'est plus. L'augmentation de productivité du travail ne se traduit qu'imparfaitement dans les grilles salariales. L'activité économique draine des ressources considérables et aggrave les disparités socio-économiques. La perception publique actuelle de la grande entreprise est plutôt sombre. D'aucuns estiment qu'elle use de ses prérogatives sans exercer ses responsabilités. Elle accumule inconsidérément le pouvoir et en dispose de façon irresponsable au mépris du bien commun. Ses rigidités hiérarchiques ne favorisent guère l'épanouissement du travailleur citoyen. En bref, on la tolère plus qu'on ne l'apprécie. De son côté, l'entreprise se sent incomprise car prisonnière de la logique compétitive marchande. En somme entre en désuétude le contrat social qui a fait le lit de la croissance économique d'après guerre et même de l'ère moderne. Ceci appelle à la définition d'un nouveau contrat social entre l'entreprise et la société dont Jane Nelson exprime la teneur générique :
« Probably more than at any time in history, the business community -- especially in OECD countries -- is being called upon to play a more proactive role in reconciling the drive for economic growth, material prosperity and technological progress, with the need for social equity, ecological sustainability and a renewed sense of humanity 139 . »
Le nouveau contrat social appelle fondamentalement à un développement durable. Il lie plus directement le progrès économique et social par la modération des disruptions induites par l'activité économique. L'entreprise a permis une formidable accélération du progrès technique ainsi qu'une élévation inouïe du niveau de vie des sociétés modernes. Elle est appelée désormais à mieux concilier sa fonction productive avec un souci d'humanité, de justice sociale et de conscience écologique 140 . Par rapport au compromis fordiste, ce pacte social redéfinit la configuration d'acteurs. Il réduit la houlette étatique au profit de l'entreprise et affermit la gouvernance civile 141 . Autre élément nouveau, ce pacte est à géométrie variable afin d'harmoniser le global et le local. La mondialisation économique appelle à des normes universelles, mais le rôle social de l'entreprise reste sujet à de sensibles différences culturelles.
* * *
Au bilan, la citoyenneté de l'entreprise exprime son souci d'ancrage dans la vie des sociétés dans lesquelles elle opère. Elle témoigne de son sens d'appartenance sociale ainsi que des droits et des responsabilités qui en découlent. L'entreprise a droit foncièrement à un traitement par les communautés hôtes qui soit conforme aux dispositions légales 142 . Quant à ses responsabilités, elles sont à notre sens économiques par la création de richesses, environnementales par l'usage mesuré des ressources naturelles, sociales par la modération des effets disruptifs de son activité productive sur la vie des sociétés et morales par le dépassement des requis légaux. Au-delà de l'obligation légale s'étend le domaine de l'initiative discrétionnaire du citoyen, fruit de ses convictions et de ses intérêts personnels ou résultante des pressions de ses concitoyens. Si la citoyenneté de l'entreprise s'adresse principalement à son environnement social, la crédibilité de son affirmation suppose le respect des citoyens qui la composent. La considération exclusive de l'un ou de l'autre de ces deux versants en ferait respectivement une opération de relations publiques ou une stratégie de valorisation des ressources humaines. D'où notre définition : Par sa citoyenneté, l'entreprise s'engage à un comportement intègre qui assure le développement économique et social pour ses collaborateurs comme pour son milieu opérationnel. L'entreprise entend ainsi démontrer par diverses initiatives son utilité organisationnelle et sa légitimité institutionnelle, et par-là son ancrage social.
Pourquoi ce choix de la notion de citoyenneté comme symbole de responsabilité sociale de l'entreprise contemporaine ? La métaphore n'est pas gratuite. La citoyenneté représente une valeur fondamentale de la modernité, le pendant politique du libéralisme économique. L'affirmation citoyenne de l'entreprise contemporaine réitère la demande expresse de la doctrine libérale des XVIIe et XVIIIe siècles : la liberté contre la responsabilité, l'autonomie contre la faculté de jugement et le sens de la mesure. Des premiers balbutiements du capitalisme jusqu'à nos jours, le rapport de force entre l'entreprise et la puissance publique s'est toutefois considérablement modifié. D'un timide plaidoyer en faveur de la liberté d'entreprendre, la revendication citoyenne sonne désormais comme une justification de la puissance et de l'influence de l'entreprise. Le contexte le requiert. La double dynamique de régionalisation et de mondialisation économiques soumet à rude épreuve les structures sociales. Aux fins de sa propre légitimité, l'entreprise citoyenne tente de concilier les impératifs compétitifs posés par les marchés mondiaux avec la nécessaire coopération avec les communautés locales qui l'accueillent. La devise opérationnelle du groupe helvético-suédois ABB résume bien le défi : To be local worldwide.
Trois autres considérations expliquent le choix par l'entreprise de la référence citoyenne. Premièrement, la notion est assez universelle pour être connue de tous, suffisamment idéalisée sur le plan théorique pour rencontrer l'assentiment social général, assez élastique dans ses mises en oeuvre pour que son emprunt par l'entreprise n'offusque trop. Secondement, la citoyenneté est une valeur fondatrice de la modernité. Valeur traditionnelle, la citoyenneté assoit le succès de l'entreprise par l'évocation symbolique d'une stabilité sociale qui est précisément malmenée par son activité productive. Troisièmement, la citoyenneté représente le référentiel moral par excellence forgé par la modernité occidentale, dont une des caractéristiques majeures est la laïcisation du pouvoir politique. Aux fins de légitimisation, le pouvoir politique moderne du XVIIIe siècle moralise son symbole, la citoyenneté, au même titre que le pouvoir féodal assurait sa légitimité par la référence aux valeurs et préceptes chrétiens. Par la référence à une valeur fortement institutionnalisée et profondément morale comme la citoyenneté, l'entreprise vise à présenter implicitement un compte-rendu de ses activités qui rendrait superflue toute investigation publique de sa conduite 143 . « Dans cette période d'incertitude, la politique au sens d'une éthique de la responsabilité reprend toutes ses lettres de noblesse 144 . »
L'affirmation citoyenne de l'entreprise entretient des clairs-obscurs qui desservent plutôt sa crédibilité. La notion de citoyenneté est éminemment individuelle. Son emprunt métaphorique par l'entreprise suppose une culture interne ouverte et fondée sur l'expression et le dialogue des collaborateurs quand bien même existerait une identité collective affirmée. La vie interne de l'entreprise est souvent bien éloignée de cet idéal. La citoyenneté de l'entreprise pose directement la question de son droit partagé à l'exercice de la souveraineté, soit son implication directe dans le jeu politique. Institution centrale de la vie économique, l'entreprise ne peut prétendre à influencer directement le jeu démocratique. Pourquoi l'entreprise n'affirmerait-elle pas simplement sa responsabilité sociale ? Sans doute cette dernière notion est-elle trop négativement connotée -- la responsabilité au sens de l'imputation d'un dommage -- pour servir de blason vertueux à l'entreprise 145 . Afin de réduire les équivoques ci-dessus, l'expression « citoyenneté de l'entreprise » est préférée ci-après à celle d'« entreprise citoyenne » 146 .
2. La responsabilité sociale de l'entreprise
L'entreprise privée est un acteur social à vocation économique qui interagit sur son milieu naturel, économique et social. La dimension institutionnelle de l'entreprise facilite son interaction avec des groupes sociaux plus ou moins formellement organisés et fonde le caractère moral de son activité productive. L'entreprise fait partie d'une configuration d'acteurs sociaux qui contribuent significativement à l'évolution des sociétés par leur faculté d'innovation et au travers de leur interaction. Ces acteurs sont nantis de droits et de libertés, mais aussi assignés à des obligations et des responsabilités comportementales. La responsabilité sociale de l'entreprise exprime sa capacité d'acteur social. L'entreprise responsable conjugue liberté et discipline. Elle promeut par un comportement intègre le développement durable des sociétés, dans ses dimensions écologique, économique et sociale. Sa responsabilité sociale s'exprime dans tous les modes d'interaction avec son milieu social. L'entreprise use de sa liberté d'action pour tirer plein parti des ressources tangibles et intangibles de la société. Elle est un acteur social durable par la considération tant de la création que de la répartition des richesses produites par son activité. Elle fait ainsi preuve de son utilité organisationnelle et de sa légitimité institutionnelle -- de sa citoyenneté.
A. L'entreprise et son milieu
Toute perspective analytique reconnaît à sa manière le lien fonctionnel de l'entreprise avec son milieu social. Juridiquement, la société par actions est une fiction légale dont les droits et les privilèges servent les intérêts de ses actionnaires pour mieux assurer la satisfaction des besoins économiques de la société. En termes politiques, la grande entreprise est une institution sociale qui fédère diverses compétences humaines en vue de l'accomplissement de tâches à composante publique. Dans le vocabulaire économique, l'entreprise se voudrait une unité rationnellement organisée dont la production répond à la demande du consommateur 147 . Une bonne part de la littérature économique adopte une perspective structuralo-fonctionnaliste qui fait de l'environnement de l'entreprise soit un milieu opératoire neutre, soit un facteur limitatif de l'extension de ses structures organisationnelles, soit encore un contexte auquel elle s'adapte pour survivre 148 . Cette perspective analytique est insatisfaisante à maints égards. Elle ne rend pas compte de la variété et de la complexité des liens qui unissent l'entreprise à son environnement. Elle n'explique guère le changement social induit par l'activité économique.
1° L'interaction de l'entreprise avec son milieu
La microéconomie néoclassique conçoit l'entreprise comme un agent économique au comportement limpide de rationalité : la maximisation du profit par la combinaison de facteurs de production et sous la contrainte de son niveau technologique. L'entreprise est une organisation hermétique et opaque qui combine mécaniquement capital et travail. L'incidence organisationnelle de la psychologie humaine et des dynamiques groupales y est occultée. L'entreprise néoclassique est un système fonctionnel harmonieusement intégré et dirigé vers l'accomplissement des buts partagés par ses membres. Sans épaisseur sociale, l'entreprise est un point abstrait relié à son milieu par un rapport marchand 149 .
L'entreprise néoclassique ne jouit guère d'un statut d'acteur économique. Quelle que soit sa taille, elle est un élément périphérique d'un modèle macro-économique d'équilibre général. Ses fonctions économiques, la transformation des facteurs en produits et l'optimisation de la combinaison productive, dépendent essentiellement de la structure de marché. L'analyse néoclassique néglige l'étude du niveau méso-économique -- l'origine des modifications de l'environnement opérationnel de l'entreprise, les dynamiques sectorielles, locales ou régionales. La perspective néoclassique conceptualise l'interaction de l'entreprise avec son environnement dans les seuls termes de rapports de marché. De nature compétitive, cette interaction entre firmes concurrentes serait néanmoins régie harmonieusement par la libre concurrence. C'est occulter la réalité des rapports de force, en termes économiques les distorsions de la libre concurrence, qui sous-tendent par exemple la position monopolistique d'une firme sur un marché. Une telle simplification omet encore l'interaction de l'entreprise avec d'autres institutions ou avec la société civile. L'analyse néoclassique ignore enfin que le rêve fait partie intégrante de la vie économique. Par son large recours au symbolisme, le marketing reconnaît la richesse de l'imaginaire social dont le fonctionnement est infiniment plus complexe que la mécanique binaire de stimuli/réponses qui régirait les rapports de marché.
La théorie néoclassique ne s'est intéressée que récemment à la dimension institutionnelle de l'entreprise, laquelle confère par des variables psychosociales un caractère politique à cet acteur économique 150 . Cette omission est logique. Depuis Adam Smith, l'économie politique classique et néoclassique recherche un ordre «naturel» aux phénomènes économiques, ordre qui l'aurait rapproché des sciences exactes telle la physique 151 . L'économie politique a négligé l'étude psychosociale de l'humain dont le comportement trop fantasque s'insère mal dans son cadre épistémologique. La théorisation économique de l'humain est dès lors singulièrement réductrice. L'homo economicus serait «naturellement» orienté vers la maximisation du profit. L'harmonie prévaudrait dans la coordination des intérêts individuels au sein de l'entreprise 152 . Lorsque les intérêts de l'acteur se reflètent mal dans les résultats de son action, l'étude des causes de ce décalage paraît pourtant essentielle 153 , ce qu'entreprend la perspective institutionnelle.
L'analyse institutionnelle met en exergue la difficile mais nécessaire coopération qui s'opère dans l'entreprise entre les individus dont les divergences sont contrebalancées par une relative communauté d'intérêts. L'approche marxiste ne retient que les éléments de discorde en peignant une histoire dialectique de l'entreprise industrielle moderne opposant la bourgeoisie capitaliste au prolétariat. L'entreprise marxiste est l'épicentre d'un rapport social conflictuel qui transporte la société d'un stade à l'autre de son évolution historique. Le fonctionnement d'une société à un moment donné de son histoire s'articule autour d'une configuration particulière de rapports sociaux (le mode de production) dont la forme historique dépend en premier lieu du type d'interaction sociale (le rapport de production) dans la vie économique. La lecture marxiste de l'entreprise n'y laisse guère de place pour une communauté de valeurs, même minimale. Le rapport de production est un rapport de force : il est exploitation et aliénation éhontées du prolétariat. L'entreprise marxiste est une institution sociale qui oppose en deux camps les individus concernés par son existence. Elle systématise l'aliénation du prolétariat et reproduit ce rapport social inégal hors de ses propres murs. Elle conditionne l'évolution sociale sans subir d'influence de son milieu. Face à la formidable capacité de structuration sociale de l'entreprise, l'Etat et l'Eglise ne sont que des institutions de superstructure. L'action de l'entrepreneur capitaliste vise ainsi à la domination de l'homme et de la Nature 154 .
L'approche marxiste reconnaît à l'entreprise son potentiel institutionnel, mais l'envisage sous son angle le plus sombre. On peine pourtant à concevoir l'entreprise comme l'instrument par excellence de l'exploitation des classes sociales les plus défavorisées. La misère existe sans l'entreprise ; des salariés peuvent posséder des parts de son capital social. Il manque encore à cette lecture institutionnelle de l'entreprise sa caractéristique identitaire. En effet, la forme et les buts d'une entreprise ne reflètent en réalité jamais totalement les seules vues de ses propriétaires. L'entreprise a bien une identité propre qui transcende à bien des égards celle de ses propriétaires. L'analyse marxiste surdimensionne enfin la capacité de l'entreprise dans la structuration des rapports sociaux. L'étude des rapports sociaux au sein de l'entreprise n'offre pas une grille de lecture exhaustive des structures sociales. L'analyse marxiste noircit manifestement le trait.
L'entreprise ne naît pas ex nihilo. Elle n'a rien non plus d'un système fermé. Dès sa naissance, elle s'inscrit dans son contexte sociétal. La firme est ouverte à son environnement avec lequel elle procède à des échanges réciproques. L'entreprise tire de son environnement social une partie de ses éléments constitutifs et dépend des besoins sociaux exprimés ou latents pour sa survie. Par l'incidence de ses activités sur son milieu, elle participe activement à l'évolution des sociétés. Production de biens et services, innovation technologique, création ou suppression d'emploi, usage de ressources naturelles sont autant de vecteurs de sa capacité de remodelage social. L'entreprise n'est pas non plus ce microcosme social qui définirait en ses murs des rapports sociaux reproduits à l'infini dans le corps social. L'entreprise est un acteur social à vocation économique en interaction avec son environnement.
Comme toute institution, l'entreprise réceptionne des attentes sociales, feint de les ignorer, tente d'y répondre ou d'influencer leur formulation. Elle tire sa force et sa légitimité de la régulation des interactions sociales qu'elle abrite ainsi que de la qualité et de la densité de ses rapports tissés avec d'autres institutions sociales ou associations diverses 155 . Au travers de ce double processus d'interaction sociale, l'entreprise exprime à la fois ses traits distinctifs et son interdépendance institutionnelle. L'interaction n'implique ni la symbiose ni l'osmose, mais la perméabilité ; elle préserve comme relativise la notion de frontière. La perméabilité de celle qui sépare l'entreprise de son milieu est inégale. La distinction est plus claire pour un produit quittant l'enceinte de l'usine que vis-à-vis des rôles sociaux multiples assumés par un employé dans son milieu social 156 .
L'interaction de l'entreprise avec son milieu est multidimensionnelle -- physique, économique, sociale, politique et culturelle. La science économique avance généralement une typologie en deux volets, le marché des produits et celui des facteurs de production. La firme s'approvisionne dans le premier en matières premières et en biens intermédiaires, tout comme elle y écoule sa production. Dans le second, elle trouve des biens d'équipement et du savoir-faire technologique, de la force de travail et des compétences humaines. La citoyenneté de l'entreprise citoyenne suggère une typologie tripartite : l'environnement naturel, soit le milieu et les ressources physiques ; l'environnement économique qui comprend les marchés de produits et des facteurs ainsi que les connaissances techniques. Enfin l'environnement sociopolitique comprend d'une part les institutions et les associations de la société civile, d'autre part les attitudes socioculturelles envers l'entreprise 157 .
Dans la théorisation du réseau social proposée par Norbert Elias, la société est à l'image d'un filet réticulaire au maillage plus ou moins fin. Chaque fil participe à la constitution de l'ensemble tout en conservant une vie, une fonction et une identité propres. On ne saurait comprendre la fonction du fil sans considérer le filet. L'action et la fonction individuelles possèdent une unité et une cohérence intrinsèques, mais s'inscrivent au sein d'une configuration d'acteurs à l'interdépendance assez étroite. La forme exacte de cette configuration est spécifique à un contexte social donné, car elle résulte du jeu compétitif et coopératif des acteurs 158 . La théorisation du sociologue allemand décrit judicieusement l'interaction de l'entreprise avec son milieu. Elle suggère la mise en compatibilité des dimensions organisationnelle et institutionnelle de l'entreprise, de son but productif avec son rôle social. Elle pose l'interdépendance des acteurs et pondère leurs inévitables rapports de force par de possibles stratégies coopératives. L'idée de configuration spécifique d'acteurs concorde enfin avec une vue dynamique et culturellement spécifique du lien de l'entreprise avec son milieu.
2° L'entreprise et l'évolution sociale
Le dynamisme représente indubitablement le caractère le plus saillant du système capitaliste. Il résulte tant de l'activité de l'entreprise que de l'évolution structurelle de son milieu. Dans ce dernier cas, le comportement de l'entreprise est respectivement adaptatif s'il comporte une faible capacité d'anticipation ou d'autonomie d'action et réactif si l'entreprise subit passivement l'évolution de son milieu. Alternativement, l'entreprise concourt activement à la dynamique capitaliste, et ce à double titre. La logique compétitive de l'économie de marché l'incite constamment à l'innovation et à sa démarcation par rapport à la concurrence. L'activité de l'entreprise exerce en outre un remodelage constant de son milieu. Les deux perspectives ci-dessus se fondent un processus itératif lorsque l'interaction de l'entreprise et de son environnement est appréhendée sous forme séquentielle. Face à ses compétiteurs et aux diverses demandes et attentes sociales, le comportement de la firme est alors stratégique.
La théorisation néoclassique de l'évolution capitaliste est de type structurel. Le comportement type de l'entreprise est réactif, voire adaptatif. L'humain a certes une inclination marquée pour un comportement réactif, tout comme les organisations sont prônes à l'inertie du fait de la lourdeur de leurs structures ou par aversion du changement. L'analyse néoclassique laisse orphelins de nombreux phénomènes pourtant impulsés par l'entreprise et qui ne répondent pas forcément à une démarche rationnelle, telles que l'innovation technologique et organisationnelle ou une pollution industrielle. Où déceler dans cette perspective la dynamique du capitalisme ? Quant à la perspective marxiste, elle pèche par l'excès inverse. L'entreprise et les rapports sociaux qui s'y nouent impulseraient une mutation par paliers du système capitaliste. C'est accorder trop d'honneur à l'action entrepreneuriale au détriment de l'évolution sociale structurelle.
Les sociétés contemporaines sont tout en mouvances. L'entreprise évolue dans ses formes organisationnelles sous l'action conjuguée de facteurs internes (innovation technique, lutte de pouvoir intestine) et externes (structure de marché, cadre légal ou pression sociale). L'entreprise contribue en outre à l'évolution des structures sociales notamment par sa capacité d'innovation. L'innovation scientifique et technique impulsé par la vie économique constitue un facteur majeur d'évolution des sociétés occidentales modernes 159 . La capacité d'innovation représente du reste pour l'entreprise son meilleur viatique, aujourd'hui plus qu'hier. L'accroissement de la concurrence et l'accélération de l'obsolescence technique des produits accroissent cette exigence d'innovation. La grande entreprise contemporaine tire sa force non plus de la personnalité et des ressources de son concepteur ni de la domination de son environnement sociopolitique, mais de la valeur créatrice de son système fonctionnel 160 . Certaines innovations technologiques ont précisément pour but de s'affranchir de la dépendance vis-à-vis du milieu naturel tout en créant de nouveaux débouchés économiques : ainsi les colorants ou autres matières synthétiques développées par l'industrie chimique dès le XIXe siècle ou actuellement les organismes génétiquement modifiés (OGM) commercialisés par l'industrie agro-alimentaire.
L'innovation technique influe sur son cadre social d'émergence. Elle le déstabilise même 161 . L'innovation implique une forme de destruction, que ce soit par l'usage de matières premières ou de biens intermédiaires, la consommation d'énergie, la modification des processus productifs et des habitudes de consommation, sans exclure un risque de pollution environnementale ou d'accidents de travail. L'innovation comporte également en soi des potentialités créatrices, en premier lieu au travers de la production de biens et services, mais aussi par le développement de compétences humaines. L'action de l'entreprise sur les structures sociales correspond bien à l'idée d'une destruction créatrice, telle que théorisée par Joseph Schumpeter 162 .
Les temps contemporains démontrent à loisir l'effet déstabilisateur du progrès technique. La fulgurante diffusion des NTIC modifie non seulement le mode de communication de l'information ; elle en rénove la production, la recherche et le stockage. Les NTIC sont le vecteur d'émergence de la nouvelle économie. Le large recours à l'Internet représente le dénominateur commun des nouveaux champs d'activité qu'elle défriche et les professions qu'elle invente. La nouvelle économie rénove l'idée d'entreprendre par les faibles infrastructures physiques (locaux, matériel) qu'elle nécessite. A tort ou à raison, ses perspectives de croissance séduisent plus d'un investisseur et nourrissent l'instabilité chronique des marchés financiers. Dans sa dimension destructrice, l'émergence de la nouvelle économie signifie la désuétude de secteurs d'activité, de modèles productifs, de combinaisons techniques, de biens et de services. Elle pèse sur les modes de vie, de pensée et d'agir. L'entreprise est un protagoniste essentiel de cette dynamique destructrice et créatrice, sommée d'incorporer les nouvelles technologies afin d'assurer sa compétitivité future. Ainsi s'explique la rapide intégration de la nouvelle économie au sein de l'économie traditionnelle.
Les potentialités innovatrices de l'entreprise ne s'adressent pas aux seuls domaines technique ou scientifique, mais également organisationnel et social. L'entreprise peut innover dans ses structures par la modification de son organigramme ou dans ses relations de partenariat ou de concurrence avec d'autres acteurs sociaux. Dans une configuration d'acteurs, la faculté d'innovation de l'entreprise peut appeler à la redéfinition des interdépendances institutionnelles. Le développement par l'entreprise d'une innovation technique ou organisationnelle peut l'amener à en adoucir les effets sociaux perturbateurs grâce à une innovation sociale. Celle-ci concernerait aussi bien l'organisation sociale de la production que ses liens d'affaires, ses relations avec la communauté locale ou les pouvoirs publics. L'hypothèse énoncée en introduction selon laquelle l'affirmation citoyenne de l'entreprise constituerait stratégie de réduction du risque opérationnel rejoint ce dernier cas de figure.
Indépendamment de son degré de technicité, une innovation développée par une entreprise possède un caractère éminemment social. Elle est le fruit d'un processus social complexe reliant des individus et des groupes sociaux 163 . L'innovation contribue à l'évolution institutionnelle. L'individu est impliqué, parfois involontairement et inconsciemment, dans le renouvellement institutionnel. Sa capacité d'influence est toutefois inégale. Le changement institutionnel est lent, graduellement reflété dans l'évolution des identités, des valeurs, des équilibres de pouvoir et des stratégies des acteurs 164 . La mise en oeuvre de l'innovation à travers divers espaces culturels se traduit par des configurations institutionnelles dont la forme tient compte du contexte de l'action individuelle et collective 165 . « L'institution est en effet organiquement dépendante de la tonalité sociale où elle se situe 166 . »
Toute institution dispose d'un pouvoir délégué conditionnellement par la société, ce qu'exprime la notion de légitimité 167 . L'évaluation de la légitimité d'une institution s'effectue selon un référentiel normatif et suppose une forme de sanction sociale. Dans la perspective fonctionnaliste de Talcott Parsons, l'entreprise est légitime si son existence et ses activités sont congruentes avec les buts et les valeurs de son système social 168 . Une institution entre en déréliction si elle est perçue comme illégitime par ses membres ou par son environnement social. Le système d'évaluation et de sanction qui sous-tend la notion de légitimité se fonde sur des valeurs et des normes historiquement et culturellement différenciées. A tout moment de son histoire, une société détermine un registre explicite et implicite des actions attendues et superflues, permises et défendues, ainsi que les circonstances et les modes de justification qui fondent la légitimité institutionnelle. De même, différentes formulations de la justification coexistent simultanément à travers les cultures 169 . La légitimité institutionnelle n'est ainsi pas acquise une fois pour toute ; elle est négociée en un processus dynamique. L'entreprise entretient sa légitimité par la considération des normes et des attentes sociales tout en influençant leur évolution et leur formulation 170 . Du point du vue managérial, la légitimité est une ressource opérationnelle susceptible de manipulation stratégique à des fins d'image 171 .
L'entreprise dispose d'une certaine capacité d'influence de la perception publique de sa propre image. Cette influence est parfois directe, comme au travers de manoeuvres de lobbying ou de participation aux débats démocratiques. L'influence est plus souvent indirecte et latente, via des stratégies de marketing social soigneusement élaborées. Elle présente des limites cependant. Toute manipulation grossière serait rapidement évidente aux yeux du public. D'autre part l'entreprise est part de la société et évolue à ce titre avec elle. Il est trois dimensions du milieu social vis-à-vis desquelles l'entreprise n'a qu'une influence limitée : l'évolution des institutions, des valeurs socioculturelles et des équilibres de pouvoir 172 . La triple dynamique redéfinit sans cesse les termes de la gouvernance sociétale. Institutions, valeurs et équilibres de pouvoir évoluent en un compromis institutionnalisé dont dépend la stabilité dynamique de la société. L'équation de gouvernance redéfinit également l'utilité organisationnelle et la légitimité institutionnelle de l'entreprise. Les attentes sociales et les besoins économiques exprimés vis-à-vis de l'entreprise sont modulables dans le temps et l'espace. A cet égard, l'invariant intemporel et interculturel réside dans la faculté à réceptionner et concilier les différents intérêts sociaux. C'est grâce à sa dimension institutionnelle que l'entreprise devient un acteur social durable d'un développement durable.
* * *
Au bilan, l'entreprise contribue directement à l'évolution sociale par sa fonction productive de création de richesse ainsi que par sa faculté institutionnelle de conditionnement du comportement humain. L'économie politique conçoit l'innovation dans des termes essentiellement techniques et à des fins de démarcation par rapport à la concurrence. L'acception de la notion d'innovation est ici élargie pour y inclure de nouvelles combinaisons organisationnelles et sociales. L'innovation organisationnelle et sociale comporte également pour but économique la création d'un avantage comparatif pour l'entreprise. Elle peut aussi viser à la valorisation du potentiel émotionnel et relationnel de ses membres ou à exercer et légitimer son pouvoir. L'innovation est ainsi moins un processus de gestion du progrès technique qu'un outil politique et un mode de gouvernance 173 . Dans son souci de justifier son pouvoir économique et de combler un déficit de légitimité, la grande entreprise affirme aujourd'hui sa citoyenneté. La démarche citoyenne de l'entreprise stimule sa faculté d'innovation organisationnelle et surtout sociale. Elle modifie sans uniformiser les diverses configurations institutionnelles qui l'accueillent.
B. La responsabilité sociale de l'entreprise
« Responsibility is both etymologically and philosophically a social concept. It means, litterally, 'answerability'. It is an idea born on the assumption that people live in communities and that they answer to each other 174 . »
La notion de responsabilité comporte deux sens distincts. Elle désigne d'abord l'ethos qui guide l'action (responsible), puis l'action de rendre compte (accountable) à ceux qui sont concernés par le produit de l'action 175 . Pour l'entreprise, l'expression de sa responsabilité exprime la dimension humaine des affaires, sa contribution à la cohésion sociale malmenée par les pressions compétitives du marché 176 . La responsabilité représente le versant contraignant des libertés et des obligations de l'entreprise. Elle ne s'identifie ainsi pas à la citoyenneté de l'entreprise qui, par la considération des droits et des devoirs de l'acteur économique 177 , est mieux capturée par la notion d'utilité sociale.
La responsabilité se réfère souvent à des devoirs ou des obligations liées à un statut, une fonction ou un rôle social. Une fonction relie des moyens à un but et définit une utilité. La fonction première de l'entreprise est la création nette de richesse. Son utilité varie selon le groupe social considéré. Pour l'investisseur, elle se définit plutôt en termes de profit et de dividende. L'employé valorise entre autres la sécurité d'emploi, les conditions de travail et le niveau salarial. Les pouvoirs publics considèrent parmi leurs critères les rentrées fiscales, le niveau d'emploi et la stimulation de l'activité économique locale. Ces diverses modalités d'utilité sociale de l'entreprise sont potentiellement contradictoires et complémentaires. L'entrepreneur tire parti des complémentarités des diverses attentes sociales 178 . Son activité crée ainsi une plus-value économique et contribue à l'équilibre dynamique de la société.
1° La responsabilité sociale
La responsabilité de l'entreprise s'appréhende selon trois niveaux d'analyse, sociétal, organisationnel et individuel 179 . A chacun de ces niveaux correspond un principe moral distinct. Au niveau sociétal, le principe de légitimité s'adresse aux relations institutionnelles entre la firme et la société. Sur le plan organisationnel, le principe de responsabilité publique concerne les activités productives et philanthropiques de l'entreprise. Au niveau individuel, le principe de pouvoir discrétionnaire du manager se réfère à sa capacité décisionnelle d'acteur moral 180 . La responsabilité sociale de l'entreprise est le plus souvent étudiée et invoquée en pratique dans les termes de sa relation avec son environnement opérationnel 181 . L'étude de la citoyenneté de l'entreprise nous suggère pourtant de considérer ces trois niveaux d'analyse.
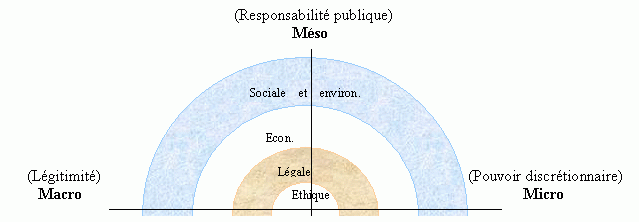 Fig. 1 : Typologie et niveaux d'analyse de la responsabilité de l'entreprise (Responsabilité publique)
Fig. 1 : Typologie et niveaux d'analyse de la responsabilité de l'entreprise (Responsabilité publique)
Si l'idée d'une responsabilité sociale de l'entreprise est largement acquise, sa nature et son spectre donnent lieu à d'âpres débats. Pour certains, la substance de la responsabilité sociale de l'entreprise est définie par les dispositions légales en vigueur. L'approche juridique considère essentiellement le problème de l'imputation des conséquences d'une action selon le principe que le sujet de droit est responsable de ses actes et tenu de réparer les dommages qui en découlent 182 . En conséquence, le droit régit les principales incidences sociales directes de l'activité économique comme la santé et la sécurité au travail, ainsi que certains de ses effets connexes même non intentionnels et socialement indésirables telle une pollution. En revanche, la loi règle de façon imparfaite le champ de la responsabilité d'une personne morale que représente une société commerciale. Elle démontre également ses limites dans l'évaluation des chaînes de causalité parfois complexes qui se traduisent par des externalités négatives, comme le recours à la main-d'oeuvre enfantine par un sous-traitant.
Face à de telles limitations, de nombreuses voix parmi la société civile appellent à l'idée d'une responsabilité morale de l'entreprise qui déborde du champ thématique couvert par le législateur et outrepasse le respect des minimas légaux 183 . Cette vision est cohérente avec la citoyenneté de l'entreprise telle que définie dans le chapitre précédent. Outre les droits de l'homme et du travailleur, la protection de l'environnement, la responsabilité sociale et la citoyenneté de l'entreprise incluent dès lors des thèmes comme l'engagement social (community involvement), les relations d'affaires, le transfert de technologie ou le soutien à l'entrepreneuriat 184 .
« A corporation is an ingenious device for obtaining individual profit without individual responsability 185 . »
Cette définition provocatrice de la société par actions suggère la fiction juridique de personne morale qui consacre son existence légale. La notion de personne morale n'est pas récente. Le droit romain antique reconnaît en effet au sujet de droit une existence qui n'a pas forcément de pendant biologique. Le sujet de droit peut être aussi bien un être humain qu'une collectivité 186 . Cette conception juridique antique inspire le statut de personne morale dont jouit aujourd'hui la société par actions. L'étymologie de la corporation est du reste latine (corpus), suggérant une vision organique de sa nature et par-là son statut juridique de personne morale. En droit anglo-saxon, la corporation est ainsi un collectif d'individus habilité à agir en un seul nom 187 . La société par actions dispose parfois d'un autre privilège, celui de la responsabilité limitée -- artifice juridique imaginé au XIXe siècle pour éviter que l'entrepreneur ne perde à la fois son capital et son pécule personnel en cas de faillite 188 . Dans les deux cas, la responsabilité assumée par l'investisseur en cas de faillite ou de grave dommage environnemental est restreinte, d'où la réflexion ci-dessus.
Du distinguo entre personne morale et physique découle le problème juridique de l'ancrage de la responsabilité vis-à-vis du collectif d'individus que représente une société commerciale. La responsabilité collective d'une telle entité est-elle envisageable si aucune responsabilité individuelle n'est formellement établie 189 ? Les tenants de l'individualisme méthodologique répondent par la négative. Ils estiment qu'un individu ne peut être tenu pour responsable d'actes qu'il n'a pas personnellement commis 190 . Ceci exonérerait par exemple l'investisseur d'une responsabilité individuelle à l'égard de l'entreprise. Pour sa part, le manager peut invoquer sa qualité d'agent par rapport au principal, soit le propriétaire ou l'investisseur. L'établissement d'une responsabilité individuelle ou collective au sein d'une société commerciale est une tâche décidément bien ardue, d'autant plus que s'accroît le caractère transnational, complexe et évolutif de ses activités et que se réduit la fidélité de l'investisseur à son égard. Aussi certains auteurs estiment-ils que l'entreprise jouit d'une identité métaphysique et logique propre qui transcende la somme de ses membres. Elle peut ainsi être tenue pour juridiquement responsable de situations sociales trop complexes pour l'établissement de responsabilité individuelle 191 . La controverse comporte une forte teneur normative. La nature et l'étendue de la responsabilité des individus et des collectifs dépendent en effet de la vision objective et subjective que l'on a du monde 192 . Bornons à relever que les sévères limitations d'une approche légaliste de la responsabilité sociale de l'entreprise plaide en faveur de la responsabilisation morale des acteurs.
Si la science juridique ne précise guère la notion de responsabilité sociale de l'entreprise, la philosophie morale s'avère plus féconde. Celle-ci distingue la responsabilité imputation de la responsabilité capacité 193 . Dans sa dimension juridique, la responsabilité est conçue en termes d'imputation. Elle concerne la relation entre l'auteur d'une action et un fait, souvent dommageable à autrui. La responsabilité juridique porte un jugement sur l'effet social d'une action. Dans sa dimension morale, la responsabilité considère la relation entre l'auteur de l'action et celui qui la subit. Elle s'exerce vis-à-vis d'une personne ou d'un collectif, et non par rapport à une action. La responsabilité morale exprime la capacité de l'agent à prendre compte des besoins et des souhaits de son milieu social.
La distinction entre la responsabilité imputation et la responsabilité capacité se reflète dans les versants respectivement négatif et positif de la liberté 194 . La liberté négative est l'absence d'entraves extérieure aux actes et aux libertés de l'acteur ; son abus entraîne la question de l'imputation d'un dommage, et par-là la définition des limites de la liberté individuelle. La liberté positive est ce que l'humain peut accomplir en tant qu'être autonome et responsable ; elle implique une responsabilité en termes de capacité. La philosophie moderne et le droit ont privilégié la dimension négative de la notion de liberté. Les deux versants de la liberté sont pourtant étroitement reliés, car l'action individuelle se situe toujours dans un cadre social. Selon Amartya Sen,
« [l]a notion de responsabilité sociale se fonde sur la reconnaissance du fait que la vie des individus en société entraîne des interdépendances, ce qui implique des obligations réciproques liées aux relations économiques, politiques et sociales qu'ils entretiennent mutuellement 195 . »
La liberté est une responsabilité sociale négociée et scellée par un pacte légal et moral. Elle représente certes une valeur sociale absolue, mais aussi un produit social dont la substance évolue dans le temps et l'espace.
La citoyenneté de l'entreprise se réfère à la notion de responsabilité moins dans le sens juridique d'imputation d'un dommage que dans son acception morale de souci du vulnérable et de capacité d'action de l'acteur 196 . L'entreprise est légalement responsable de ses actes. Elle est également moralement tenue d'assurer que son activité profite à ses partenaires dans les limites de ses capacités. La citoyenneté de l'entreprise conjugue ainsi intimement la liberté et la conscience, la liberté d'entreprendre à la responsabilité vis-à-vis d'autrui. La responsabilité sociale rapportée aux interdépendances sociales amène à s'intéresser aux groupes sociaux affectés par l'action. La fonction productive de l'entreprise produit une plus-value de richesse. Les principes démocratiques d'équité et de justice sociale suggèrent que les divers groupes sociaux impliqués directement ou indirectement dans la vie d'une entreprise bénéficient dans des modalités et à des degrés divers de cette plus-value. La responsabilité sociale de l'entreprise amène alors à l'examen de l'utilité de son activité vis-à-vis des différents groupes sociaux concernés par son existence.
2° L'utilité sociale
La stratégie de maximisation du profit questionne en outre le caractère moral de l'activité économique. Dans un minimalisme moral, Friedman évoque pour « règles du jeu » le non-recours à la tromperie ou à la fraude. La citoyenneté de l'entreprise prend plus largement pour base morale la notion de justesse (fairness). Pour son acceptation sociale et sa légitimité, le profit devrait être «juste» 197 . L'argument peut paraître élusif et spécieux : comment définir le niveau du juste profit et comment le distinguer de l'usure ? Le juste profit est un élément du contrat social passé tacitement entre l'entreprise et la société, contrat qui pondère les dimensions destructrice et créatrice de l'activité économique. Sa définition est fonction du temps et du lieu, du moment historique et de la culture. Elle reflète la valorisation sociale de l'entrepreneuriat et sa rémunération. L'attitude sociale à l'égard du profit peut être teintée d'admiration et d'envie, de jalousie voire de réprobation. L'acceptation sociale du profit est nécessaire à la stimulation de l'esprit d'entreprise et de l'innovation 198 . Du reste, la motivation à entreprendre n'est pas exclusivement, ni même principalement, guidée par la recherche du profit. Le goût du défi et de la créativité sont des facteurs prépondérants en l'espèce 199 . La recherche du profit n'est qu'une des composantes du succès économique de l'entreprise 200 . Le juste profit comporte quelques invariants dont François Michelin nous dévoile la teneur :
« La rétribution juste est celle qui permet à l'entreprise et aux hommes de grandir. Le pouvoir d'achat du personnel est une clef dans la santé économique d'un pays. Quant à la rémunération des actionnaires, mal comprise souvent en France, elle est essentielle pour créer et maintenir le dynamisme entrepreneurial sans lequel il ne se crée ni emplois ni richesse 201 . »
Le juste profit de l'activité économique résulte d'une création nette de valeur par l'entreprise pour l'ensemble de ses partenaires. La valeur s'entend dans une acception large incluant les ressources économiques, sociales et écologiques d'une société. Le partenaire ou la partie prenante de l'entreprise (stakeholder) se définit comme un groupe social ou un individu qui influence ou est influencé par l'activité de l'entreprise 202 . Il est partie prenante de l'entreprise, tant par sa faculté de création de valeur pour l'entreprise que sa participation à la prise de risque qu'implique l'exercice des affaires 203 .
| Tabl. 1 : Les partenaires de l'entreprise |
| |
Partenaires de l'entreprise |
Leur apport |
Responsabilité de l'entreprise |
| Interne |
Propriétaire, actionnaire et créditeur
Direction opérationnelle (manager)
Collaborateurs |
Biens et capitaux
Compétences, leadership, intégrité
Compétences, force de travail, intégrité |
Plus-value opérationnelle et boursière
Ethique décisionnelle, respect et consultation du collaborateur
Sécurité, santé, niveau de vie, développement humain et social |
| Externe |
Acheteur et consommateur
Relations d'affaires (fournisseur, sous-traitant, revendeur, franchisé, concurrent)
Communauté locale
Pouvoirs publics
Environnement naturel |
Achat de biens et services finaux
Achat de biens et services intermédiaires, savoir-faire
Ressources écon. Et humaines, légitimité
Infrastructure physi-que, institutionnelle et régulatoire, légitimité
Ressources naturelles |
Satisfaction des besoins et des attentes sociales, qualité et sécurité des produits
Stimulation de la vie économique et respect de règles d'éthique économique
Stimulation de la vie socio-économique et respect des valeurs culturelles locales
Saine participation au débat politique
Usage responsable des ressources |
| |
Catégorie résiduelle |
|
|
Le partenaire de l'entreprise peut contribuer à sa fonction productive par des capitaux, des biens ou des compétences. Sa contribution peut être également intangible comme le soutien à la légitimité institutionnelle de l'entreprise. Les partenaires internes de l'entreprise sont les détenteurs des actifs tangibles (propriétaires) et intangibles (actionnaires, créditeurs) ; la direction exécutive (membres du conseil d'administration, manager et cadres supérieurs) ; les collaborateurs (y compris sous leur forme collective de syndicats). Les partenaires externes de l'entreprise sont les consommateurs et les acheteurs ; les relations d'affaires (sous-traitants, franchisés, revendeurs et fournisseurs) ; la communauté locale (pouvoirs publics et société civile et générations futures) ; les pouvoirs publics nationaux, les organisations internationales et le grand public 204 .
Comme évoqué plus haut, la notion de profit reflète mal l'usage pour sa réalisation de biens publics et d'actifs intangibles. La création nette de valeur par l'entreprise s'observe par sa contribution au développement durable, soit par la mise en relation entre d'une part son usage de ressources physiques, financières et humaines et d'autre part sa contribution au progrès économique et social. L'environnement de l'entreprise comporte trois dimensions : physique, économique, et sociopolitique. Ces trois types d'environnement capitalisent les ressources d'une société. Celle-ci se diffracte en cinq formes de capital, naturel, physique, économique, humain et social 205 .
| Tabl. 2 : L'entreprise et les ressources sociales |
| Environnement |
Définition de l'environnement |
Forme de capital |
Définition du capital |
| Physique |
Milieu naturel
Partenaire d'affaires |
Naturel
Physique |
Ressources naturelles
Infrastructure productive et biens intermédiaires |
| Economique |
Investisseur, consommateur |
Economique |
Capitalisation boursière, biens et services finaux |
| Sociopolitique |
Institutions, société civile |
Humain
Social |
Savoir-faire, technologie
Savoir-être, confiance |
Par son activité, l'entreprise peut augmenter toutes ces formes de capital, celui physique mis à part. Elle produit des biens et services, contribue par des investissements en recherche et développement (R&D) au progrès technique. L'entreprise peut augmenter le niveau de capital humain d'une société par ses politiques de personnel -- embauche, formation, salaires -- et influencer par sa culture interne la moralité de ses collaborateurs. L'entreprise peut enfin accroître le capital social, soit « la capacité de travailler ensemble, à des fins communes au sein des groupes et des organisations qui forment la société civile 206 . » Ces deux dernières formes de capital sont moins connues et méritent approfondissement.
Le capital humain se réfère foncièrement au savoir-faire et aux compétences de l'humain. Il fait partie des actifs intangibles ou du capital immatériel de l'entreprise et de la société 207 . Il a pour modalités principales les connaissances de base, la formation professionnelle, l'intégration, la créativité, la motivation et la rémunération du collaborateur. Le capital humain comprend également la capacité émotionnelle de l'individu, soit la faculté de détecter, de comprendre et d'user de ses propres émotions ainsi que celles d'autrui. En dépit de son idéal rationnel, l'entreprise est également guidée dans sa vie organisationnelle par le sentiment et l'émotion. La politique de ressources humaines valorise l'intelligence rationnelle et les qualifications techniques. Ces qualités sont de faible recours dans l'interaction sociale ainsi que face à des périodes de mutation organisationnelle et d'incertitude. La capacité émotionnelle intervient alors, car elle affecte la réceptivité à une idée nouvelle, la mobilisation autour d'un projet commun ainsi que l'apprentissage de nouvelles pratiques 208 . Une politique éclairée de personnel tient compte aussi de cette capacité.
La valorisation du capital humain par l'entreprise contemporaine est ambiguë. Elle tendrait à augmenter au vu des efforts déployés par certaines entreprises pour fidéliser leur main-d'oeuvre très qualifiée. De même, les mutations rapides des marchés et des techniques assouplissent aujourd'hui les schémas organisationnels ainsi que la définition des qualifications et des compétences. Le savoir-faire accumulé par le collaborateur lors de sa formation ou grâce à son expérience professionnelle exigent leur adaptation au contexte opérationnel spécifique à l'entreprise considérée. Le contenu technique toujours plus élevé du travail se conjugue désormais avec la polyvalence. Les connaissances, les compétences et la créativité de l'humain devient primordiale dans la capacité d'innovation de l'entreprise 209 .
Cette valorisation se déprécie au vu de la précarisation de l'emploi, ainsi qu'à la réduction de la formation complémentaire et continue. Le savoir-faire humain est ainsi loué à bon compte et valorisé au maximum. Vu ainsi, l'entreprise entendrait avant tout bénéficier des connaissances et des compétences du collaborateur que participer directement à leur formation. Dans cette perspective, les pratiques de lobbying et de philanthropie représenteraient pour les milieux d'affaires des instruments très efficients en vue d'infléchir les programmes éducationnels et scientifiques, publics comme privés, dans le sens de leurs intérêts. S'il paraît hasardeux d'établir souverainement l'importance relative actuelle des deux tendances, il est possible d'énoncer une conclusion en deux points. Il est une certitude : l'édification d'une société de la connaissance qui valorise grandement le capital humain. Demeure une incertitude, à savoir le degré d'implication active de l'entreprise dans ce processus.
Quant au capital social, il concerne les liens interpersonnels qui affectent positivement l'efficience d'une économie. Ses solidarités interpersonnelles pallient l'absence ou les lacunes des institutions politiques et économiques. Le capital social constitue en outre la fondation directe du bien-être social au travers de la structuration du tissu social. Le concept a ainsi pour modalités la faculté de coordination et le niveau de confiance interpersonnelles, le degré de coopération entre des entreprises, l'efficience du marché du travail, la valorisation de la formation continue, la perception publique de l'entreprise, la qualité de ses relations avec les pouvoirs publics ou encore l'efficience de l'infrastructure physique et institutionnelle 210 . Forme de capital social, la confiance contribue aussi à la création de richesse 211 . Elle est une forme de solidarité et de sociabilité spontanée fondée sur des attentes comportementales régulières et des valeurs partagées 212 . Socialement construite, la confiance nécessite un horizon temporel étendu. Elle a pour propriété particulière que son usage n'entraîne par la déplétion des ressources disponibles : faire confiance à quelqu'un l'incite à faire de même et inversement 213 . Par son accent sur la compétence et la responsabilité, la confiance s'avère particulièrement utile pour assurer la coordination et le contrôle en situation de forte incertitude et de complexité 214 . Dans le contexte de l'entreprise, la confiance peut émerger d'une stratégie de réduction du risque opérationnel, au travers par exemple de participations croisées entre sociétés 215 .
Actifs intangibles, le capital humain et le capital social posent des problèmes de définition et de mesure. Leur mise en oeuvre appelle à la modification des techniques managériales et comptables 216 . L'impact favorable du capital humain et social sur la création de richesse paraît établi sur le plan scientifique. Tout porte à croire que l'entreprise contemporaine n'ait pas encore pris pleine conscience des potentialités économiques des gisements de capital humain et social 217 . La forte volatilité des marchés financiers, la compétition économique exacerbée, les restructurations drastiques des organigrammes sont des facteurs défavorables à l'investissement dans les compétences humaines et au maintien d'un climat de confiance propice au développement économique 218 . Réduite à l'idée simpliste d'un coût, la dimension sociale de l'activité économique serait une excroissance dont l'arasement autoriserait tous espoirs de croissance. Le social est pourtant partie de la solution, non du problème. Oublier ce truisme reviendrait à ne retenir que la première moitié de l'enseignement de Schumpeter : l'innovation serait alors destructrice et seulement destructrice.
Les notions de capital humain et social sont au coeur de l'entrepreneuriat et de la citoyenneté de l'entreprise. Sen nous rappelle que la liberté d'entreprendre constitue une responsabilité sociale dont la teneur est négociée avec la société. La citoyenneté de l'entreprise lie étroitement la liberté de l'acte à la conscience de ses conséquences. Elle revendique une marge de manoeuvre suffisante à l'expression de sa créativité, de ses capacités et de ses compétences. Elle implique un accord de confiance réciproque entre l'entreprise et la société, basée sur la conviction de l'utilité sociale et de la moralité de son acte. La citoyenneté de l'entreprise affirme une responsabilité sociale créatrice qui tire parti des diverses richesses sociales avec le souci de leur valeur et de leur pérennité. La responsabilité sociale appose la création de richesse à la minimisation de ses conséquences sociales négatives. Elle nourrit la création de capital économique, humain et social, concilie création et distribution de richesse. Dans les mots d'un entrepreneur de Suisse romande :
« La responsabilité sociale est selon moi porteuses de création d'emploi, d'une capacité à pouvoir réaliser le souhait d'un groupe d'individus, d'exemplarité et de communication de valeurs. C'est aussi démontrer qu'il est possible d'intégrer des paramètres apparemment aussi contradictoires tel que profit et dépenses sociales 219 . »
Dans l'expression de sa responsabilité sociale, l'entreprise assume deux lignes fonctionnelles. Organisation, elle répond aux besoins économiques de la société par la création de richesse et recherche son optimum fonctionnel par les principes de rationalité, d'efficacité et d'efficience. Institution, elle met en compatibilité les diverses attentes sociales et contribue à l'équilibre dynamique de la société 220 . Stabilité, cohésion et évolution sont les trois composantes essentielles d'un tel équilibre ; celles-ci représentent le but primordial de toute entité sociale, le gage de sa propre viabilité et de sa légitimité. L'utilité de l'organisation se mesure dans sa capacité à répondre aux besoins sociaux, dans un rapport socialement accepté entre usage et création de ressources. Tel qu'illustré par la figure en page suivante, la légitimité de l'institution implique la congruence entre les normes et valeurs associées à ses activités productives -- les valeurs entrepreneuriales -- celles reconnues par cette société.
Le double objectif posé à l'entreprise de la satisfaction de besoins économiques de la société et de contribution à l'équilibre dynamique de la société pose plusieurs défis. Tout d'abord, l'optimum fonctionnel interne passe par l'édification d'une culture d'entreprise. Cette culture est constituée de valeurs et de normes qui évoluent au gré des changements techniques, des objectifs et des méthodes de gestion et des aspirations des collaborateurs. La compatibilité de ce processus avec l'évolution des valeurs sociétales n'est pas acquise. Dès lors, l'entreprise risque de devenir un microcosme dont l'autonomie s'inscrirait en porte-à-faux des valeurs sociales du moment 221 . Par ailleurs, l'entreprise dispose hors de ses propres murs d'un puissant pouvoir de transformation sociale. Les biens et services qu'elle produit modifient le niveau de vie, les structures et les habitudes sociales. L'impact social de l'entreprise comporte des éléments socialement valorisés comme la création de richesse, mais également des perturbations sociales parfois amèrement ressenties. A cet égard, le défi majeur de l'entreprise consiste à assurer sa fonction productive tout en minimisant et légitimant les disruptions sociales induites par son activité. Ce faisant, elle assure son utilité organisationnelle et sa légitimité institutionnelle, et par suite sa propre durabilité. Elle garantit à son auteur sa liberté d'action, sa légitimité sur le plan macrosocial, sa responsabilité publique au niveau organisationnel et son pouvoir discrétionnaire. Telle est l'essence de l'entrepreneuriat. Telle est aussi la logique sous-jacente à la citoyenneté de l'entreprise.
 Fig. 2 : L'utilité et la légitimité sociales de l'entreprise
Fig. 2 : L'utilité et la légitimité sociales de l'entreprise
L'action entrepreneuriale minimise son risque opérationnel par la prise en compte des besoins et des intérêts latents ou exprimés des divers groupes sociaux qu'elle affecte. Le risque opérationnel de l'entreprise est de nature sociale puisqu'il s'adresse à la satisfaction de ses divers partenaires. Il est également économique, car la qualité de l'environnement opérationnel de l'entreprise influe notablement sur ses performances 222 . L'action entrepreneuriale est ainsi une stratégie de mise en compatibilité et en complémentarité des besoins et des attentes sociales. Elle concilie la création et la distribution de richesse et implique le panachage des intérêts en jeu. Entreprise difficile, mais n'est-elle pas le lot quotidien de tout citoyen ? Il est trois stratégies de réduction du risque opérationnel : en amont, en aval ou en marge de l'activité productive.
En amont de l'action productive, l'entreprise incorpore autant que possible les besoins et des attentes sociales dans la définition de ses objectifs et des moyens pour les atteindre. Telle est notre conception de l'activité entrepreneuriale.
En aval de l'action productive, l'entreprise cherche à réduire ex post les perturbations sociales induites par son activité. Elle développe des initiatives au profit des groupes sociaux défavorisés par ses activités principales. Tel est le principe de la philanthropie.
En marge de l'action productive, l'entreprise tente d'influence favorablement la perception publique de son activité par un travail de relations publiques et de motivation du personnel sans réduire les disruptions sociales provoquées par son activité productive.
La citoyenneté de l'entreprise peut se rattacher en pratique aux trois stratégies. Dans son expression la plus authentique, la citoyenneté de l'entreprise minimise le risque opérationnel, ce qui la rattacherait au premier type. Elle comporte ensuite des modalités de nature philanthropique. Enfin l'ample publicité dont elle fait l'objet conforte l'idée d'une politique de relations publiques et de gestion de ressources humaines. Retenons pour l'instant les trois notions fondamentales qui structurent l'engagement citoyen de l'entreprise 223 . Au vu de l'importance des ressources et des compétences qu'elle mobilise, la grande entreprise manifeste sa responsabilité à l'égard de ses partenaires par la qualité intrinsèque de ses actions (responsibility) ainsi que par un compte-rendu (accountability) de ses activités et de leur impact social. Ensuite le partenaire de l'entreprise jouit d'un droit à l'information, car il est concerné par l'existence et la vie de l'organisation. La firme est alors invitée à une certaine transparence quant à ses objectifs et ses procédures, ses résultats opérationnels et leur incidence sociale. Enfin la responsabilité sociale de l'entreprise suppose un dialogue effectif (inclusivity) avec ses partenaires afin d'assurer sa légitimité sociale.
Liberté d'entreprise contre intégrité, transparence et dialogue. La substance du pacte citoyen de l'entreprise est moins incohérente ou révolutionnaire qu'il n'y paraissait de prime abord. Il exprime peut-être avec des mots nouveaux et une visibilité inédite les stratégies de certains entrepreneurs d'antan. Dans son étude historique du développement économique des sociétés occidentales, Alain Peyrefitte énonce une hypothèse qui pourrait être la nôtre :
« Notre hypothèse est que le ressort du développement réside en définitive dans la confiance accordée à l'initiative personnelle, à la liberté exploratrice et inventive -- à une liberté qui connaît ses contreparties, ses devoirs, ses limites, bref sa responsabilité, c'est-à-dire sa capacité de répondre d'elle-même 224 . »
L'hypothèse lie les notions de développement et de responsabilité sociale de l'entrepreneur. Suivant Schumpeter, chaque cycle d'affaires présente des spécificités auquel l'entrepreneur répond par des solutions techniques et organisationnelles propres. Nous émettons l'hypothèse complémentaire que dans l'expression de sa responsabilité sociale, l'entrepreneur imagine également de nouveaux modes d'ancrage social de l'entreprise. Son innovation est alors non seulement technique ou organisationnelle, mais sociale. L'entrepreneur définit de nouveaux modes d'organisation sociale du travail, de nouveaux rapport de l'entreprise avec son milieu social, afin d'adoucir les perturbations sociales découlant de son activité destructrice et créatrice.
II. Du citoyen entrepreneur à la citoyenneté de l'entreprise
-- REMARQUES LIMINAIRES
Du citoyen entrepreneur à la citoyenneté de l'entreprise. Parmi les constantes de l'évolution capitaliste figure la dimension politique de l'acte d'entreprendre. Cette facette de la vie économique est tantôt implicitement tantôt explicitement assumée ou revendiquée par l'entrepreneur et l'entreprise, mais jamais foncièrement démentie concrètement. Les libéralismes politique et économique s'affirment dans les faits comme dans les idées durant le dernier quart du XVIIIe siècle. Ils représentent le soubassement idéologique de la transition des sociétés occidentales vers la modernité. La citoyenneté démocratique exprime un droit de parole et d'action qui se concrétise notamment au travers de la liberté d'entreprendre. L'individu est citoyen et peut se faire entrepreneur. Dans une définition générique, l'entrepreneur recherche et identifie des opportunités d'affaires et de profit, rassemble les moyens productifs nécessaires, initie et dirige l'activité économique, assure enfin l'écoulement de sa production. Son action nourrit le formidable essor de l'activité économique tout au long de la modernité occidentale. Le rapport de la citoyenneté et de l'entrepreneuriat démontre durant l'ère moderne à la fois une constance et une évolution d'importance. Pour invariant historique, l'attribut citoyen fonde aux yeux du public le sens de la responsabilité sociale de son détenteur. Dans son évolution historique, la citoyenneté appuie d'abord l'individu dans sa revendication d'une liberté accrue à entreprendre. Elle est aujourd'hui davantage une démarche de légitimation sociale de la puissance de la grande entreprise. En bref, la relation de la citoyenneté et de la vie économique a glissé en un peu plus de deux siècles de l'expression d'une liberté autonomie à celle d'une liberté capacité.
Une telle évolution interpelle. L'identification de ses déterminants et de ses modalités exactes suggère l'analyse attentive de la responsabilité sociale de l'entreprise, des temps préindustriels à nos jours. Il serait en effet vain de traquer des références explicites à la citoyenneté de l'entreprise tout au long de l'histoire capitaliste. La notion exprime en effet une forme anglo-saxonne et contemporaine de la responsabilité sociale de l'entreprise. Une telle étude historique facilite l'analyse des enjeux contemporains liés à l'acte d'entreprendre et à la vie économique en général. Il permet de distinguer les éléments nouveaux et anciens de cette thématique. Enfin, il met en lumière les diverses formes sociohistoriques de responsabilité sociale de l'entreprise, leurs forces et leurs faiblesses respectives, ainsi que les solutions institutionnelles propres à les stimuler.
Cette étude n'ambitionne pas de retracer l'histoire sociale du capitalisme. Un tel objectif exigerait en effet la considération de cinq lignes d'analyse : les rapports Homme-Nature (environnement, urbanisme) ; les conditions de vie sociale (qualité de vie, conditions de travail, impact sur la famille ouvrière) ; les inégalités sociales (constitution et modification de strates sociales) ; l'organisation technique et sociale de l'entreprise ; les politiques publiques en matière économique et sociale 225 . Selon notre définition, la citoyenneté de l'entreprise suggère l'examen des seules initiatives -- actions non formellement requises par la législation en vigueur -- de l'entreprise en matière sociale. Ceci posé, l'analyse n'exclut pas complètement des références rapides aux thèmes susmentionnés. Les initiatives sociales de l'entreprise s'adressent aux partenaires tant internes qu'externes -- en priorité à la main-d'oeuvre et à la communauté locale. La responsabilité sociale de l'entreprise se manifeste avant tout vis-à-vis du partenaire le plus impliqué dans la vie organisationnelle, soit la main-d'oeuvre. Le rapport à la communauté locale ne vient qu'ensuite. Ceci suggère l'adoption comme fils rouges de l'analyse : (a) l'évolution organisationnelle (l'organisation technique du travail) ; (b) les conditions de travail et l'incidence sociale de l'entreprise sur son milieu social (l'organisation sociale du travail) ; (c) les mesures préemptives ou correctives de l'entreprise quant à son impact social interne et externe (sa responsabilité sociale). L'approche adoptée ci-après reflète avant tout les préoccupations sociales et environnementales de l'époque considérée, sans analyser en détail leurs lacunes. Ainsi, des aspects cruciaux de la responsabilité sociale de l'entreprise contemporaine comme la protection des consommateurs ou de l'environnement ne sont pas perçus comme tels aux XVIIIe et XIXe siècles.
Le parcours historique débute en 1776, date fondatrice de la modernité occidentale. Le philosophe écossais des Lumières Adam Ferguson le pressent en 1767 dans son Essai sur l'histoire de la société civile 226 , premier ouvrage dédié à l'idée de société civile. En France, un édit de Turgot établit en 1776 met hors-la-loi les organisations de métiers, dont le conservatisme se fait toujours plus pesant et anachronique. La même année, l'éclatement de la Révolution américaine consacre le triomphe politique de la pensée libérale, alors que la parution de la Richesse des nations d'Adam Smith en affirme les principes économiques. A la même époque, l'Anglais James Watt perfectionne la machine à vapeur et contribue à l'essor de la première industrialisation.
La périodisation historique prend pour lignes de césure l'innovation technique. Non pas tant que le facteur technique serait exogène à la vie économique et sociale, comme le postule faussement l'analyse microéconomique néoclassique. La périodisation prend pour point de départ l'accélération du progrès technique et examine ses incidences sociales. Historiquement, les trois «révolutions» techniques de l'histoire capitaliste suscitent tôt ou tard de nouveaux modes productifs, de nouvelles formes organisationnelles, de nouvelles techniques d'encadrement des hommes, et enfin de nouvelles incidences sociales. Le troisième chapitre considère l'activité économique prémoderne jusqu'à la première industrialisation anglaise du dernier quart du XVIIIe siècle. Le quatrième chapitre couvre la centaine d'années qui sépare la première de la deuxième industrialisation. Enfin le cinquième chapitre débute au dernier quart du XIXe siècle et parcourt tout le XXe siècle. Il marque une césure au milieu des années septante, à la fois pour marquer la fin d'une ère économique dorée et pour signifier les rapides tertiarisation et mondialisation de l'économie. Ce dernier quart de siècle prépare l'émergence du discours citoyen de la grande entreprise.
Si l'étude historique ne néglige pas la macrostructure économique, sociale et politique, elle privilégie en toute logique la microanalyse. L'entreprise est l'unité d'analyse, alors que la considération de son milieu porte parfois le niveau d'analyse au plan mésosocial. Quant aux modes productifs caractéristiques de chaque époque considérée, leurs spécificités sont relatives. Elles expriment une tendance lourde ou pour le moins significative, ce qui n'exclut pas leur chevauchement mutuel à d'autres périodes de l'histoire. Enfin dans un souci de concision, le parcours historique privilégie l'histoire du capitalisme occidental. L'Europe continentale est représentée essentiellement par la France, le monde anglo-saxon par l'Angleterre puis dès 1800 le Royaume-Uni, ainsi que par les Etats-Unis d'Amérique. Cet occidentalo-centrisme est amendé par l'étude du capitalisme japonais dans le cinquième et surtout neuvième chapitre. Ce dernier étudie également le cas helvétique.
3. Le regime preindustriel
Le régime préindustriel puise ses racines dans l'activité économique du Moyen Age et s'épanouit à la fin du XVIIIe siècle. Sans négliger l'étude des dynamiques de fond, cette étude se concentre sur les dernières décennies de cette période transitoire caractériée en Europe occidentale par le crépuscule de l'Ancien Régime français et par les premiers frémissements de l'industrialisation anglaise. L'économie préindustrielle suggère par certains traits la structure productive du XIXe siècle. L'époque ne transforme toutefois pas radicalement l'économie médiévale fortement régulée par l'ordre corporatif en une économie industrielle acquise à la libre entreprise. La dynamique de proto-industrialisation connaît d'importantes variations géographiques ainsi que des phases d'accélération, de ralentissement et même de renversement de tendance. Elle n'a pas pour corollaire obligé l'industrialisation du XIXe siècle 227 .
L'économie préindustrielle est encore largement agricole et rurale, artisanale dans sa forme productive, mais déjà acquise à l'échange commercial. En milieu urbain, l'organisation des métiers règle une partie de la production et la vente, aux côtés de l'artisan libre et du marchand-fabricant. La concurrence développée par ce dernier vis-à-vis de corporations est surtout indirecte. Devant l'emprise des corporations en milieu urbain et pour abaisser ses coûts de production, le marchand-fabricant imagine un système décentralisé qui tire habilement parti de la complémentarité entre la ville et la campagne. Il vend ensuite sa production dans les foires locales ou l'exporte loin à la ronde. Plus rarement, l'entrepreneur concentre sa main-d'oeuvre en s'inspirant en France de la manufacture royale. Quant au grand banquier ou commerçant, il réalise des affaires fort lucratives qui ne représentent pas pour autant une authentique activité entrepreneuriale.
Que motive bien cet ancêtre de l'homo faber qu'est l'entrepreneur du XVIIIe siècle ? Le gain, bien sûr, mais il y a plus. La philosophie des Lumières associe le travail libre et la libre entreprise à l'identité de citoyen. « Rousseau explique que c'est l'indépendance, la vertu que donne le travail qui est à la base des principes fondamentaux de la société, à savoir la propriété, la liberté et l'égalité 228 . » L'activité entrepreneuriale briserait les carcans sociaux moyenâgeux et les pesanteurs de la Nature. Tel est bien l'objectif premier des fondateurs de l'économie politique, Adam Smith en tête. Un nouveau corpus de valeurs semble nécessaire, car l'activité économique n'a toujours pas gagné ses lettres de noblesse depuis Platon, Aristote et Cicéron 229 . Jusqu'à la Réforme, la doctrine judéo-chrétienne condamne sans appel l'accumulation de richesse et la quête du profit 230 , démarche amorale et même immorale alors que la soumission à l'Eglise suffit au salut 231 . Au Ve siècle, Saint Augustin prolonge la dichotomie antique entre les activités intellectuelles et manuelles, ainsi que la nette prédilection pour le savoir abstrait. L'éthique catholique se reflète dans la division sociale : à l'aristocrate les disciplines de l'esprit, à la plèbe la peine physique. L'ordre social est immuable, car d'essence divine. La famille représente l'unité sociale constitutive et l'autorité patriarcale son garant.
Selon Max Weber, la Réforme et l'ethos calviniste en particulier produisent un terreau plus fécond à l'esprit d'entreprise. Le réformateur Jean Calvin (1509-1564) réconcilie l'activité économique avec le salut de l'âme. L'homme n'a pas à éprouver de fierté de sa fortune ou de honte de sa pauvreté, car la richesse est un don du Créateur, un signe de la grâce divine. Le travail libre poursuit la création du Divin et accomplit sa volonté. L'accumulation de richesses se justifie moralement si elle sert l'intérêt collectif. L'entrepreneur calviniste se doit de redistribuer aux plus nécessiteux le superflu de sa fortune 232 . Le calvinisme résout le dilemme moyenâgeux entre le salut spirituel et le bien-être matériel procuré par l'activité lucrative, le conflit entre l'éthique et le profit. Il justifie moralement l'activité temporelle : accomplir les devoirs que l'existence assigne à l'individu. Calvin invente un capitalisme pieux, relève en substance Weber dans son Ethique protestante 233 .
La thèse de Weber est des plus controversées. Les très catholiques Venise, Florence, Cologne ou Augsbourg connaissent une intense activité économique avant la Réforme de 1520. En vertu de la raison d'Etat, le pouvoir financier, politique et religieux du début du XVIe siècle n'hésitent pas à célébrer leurs noces : Les Fugger sont les banquiers de la papauté ; Laurent de Médicis marie sa fille au fils d'un souverain pontife. Le catholicisme n'a pas complètement verrouillé la dynamique précapitaliste, du moins dans sa strate supérieure. En fait, l'activité économique se réhabilite discrètement et patiemment durant le Moyen Age. Un subtil mais essentiel glissement de valeurs s'amorce dès la première moitié (le premier) du VIe siècle grâce à Saint Benoît de Nursie (~480-547), fondateur de l'ordre bénédictin. Sa règle monastique Orare et laborare réconcilie la foi et l'intellect avec l'activité manuelle. Sur un plan technique, le Moyen Age est riche en inventions techniques aux applications agricoles ou guerrières. Les sciences expérimentales se développent également dès le XIIIe siècle. Le Moyen Age n'est ainsi pas frappé de l'obscurantisme technique et culturel qu'on lui a longtemps prêté 234 . La capillarité sociale de l'ordre social moyenâgeux reste pourtant faible, l'accumulation de richesse plutôt mal considérée par l'Eglise chrétienne.
Weber se défend bien d'une thèse culturaliste monocausale 235 .Plutôt qu'un lien de causalité directe, le sociologue suggère une affinité entre l'éthique protestante et l'émergence d'une idéologie qui autorise l'engagement moral dans le capitalisme 236 -- l'esprit du capitalisme. Par sa légitimation de l'activité économique, le calvinisme aurait favorisé la dynamique entrepreneuriale. Thèse plausible mais irréfutable tant elle explore un lien complexe. La doctrine calviniste est indubitablement favorable à l'esprit d'entreprise. Elle s'accointe avec l'esprit du capitalisme par la mise en concordance entre d'une part l'autoréalisation et la liberté d'action individuelles, d'autre part la justification morale de l'activité économique orientée vers le bien commun 237 . En revanche, Weber se fourvoie dans l'analyse de l'influence directe de Calvin sur la dynamique entrepreneuriale. Le sociologue allemand déduit faussement de l'étude des milieux puritains, piétistes et méthodistes anglais du XVIIIe siècle la doctrine calviniste prônée par le réformateur près de deux siècles auparavant. Si ces doctrines réformées se réfèrent effectivement à l'ethos calviniste, elles en dénaturent considérablement la substance. Cette confusion induit par exemple le sociologue à ériger faussement en vertus calvinistes l'ascèse dans le travail ou le sens de l'épargne qui facilitent l'accumulation capitaliste 238 . En bref, la doctrine économique de Calvin ne saurait être appréciée à l'aune de l'évolution ultérieure du capitalisme.
Les premiers frémissements capitalistes du XVIIIe siècle ont pour cadre institutionnel le mercantilisme, dont le colbertisme français exprime au mieux l'esprit dirigiste et nationaliste. Jean-Baptiste Colbert encourage et coordonne systématiquement l'industrie et l'entrepreneuriat grâce aux manufactures royales. Il tente à la fois de domestiquer les turbulentes organisations de métier et de contrecarrer leur conservatisme technique 239 . Sa politique à leur égard oscille entre le souci monarchique de l'unification et le relatif laisser-faire 240 . À la fin du XVIIIe siècle toutefois, le colbertisme a mauvaise presse, en décalage notoire avec le libéralisme promu notamment par L'Encyclopédie d'Alembert et de Diderot ainsi que par les physiocrates comme Quesnay 241 . La France n'est pas le premier pays à s'enticher d'idées libérales. L'avènement dans l'Angleterre du XVIIe siècle d'une monarchie constitutionnelle permet en effet l'éclosion précoce de la pensée libérale dont John Locke formule le volet politique et Adam Smith le pendant économique. La bourgeoisie anglaise s'associe aux mutations politiques pour asseoir sa liberté d'entreprendre. En revanche, la monarchie absolutiste française se raidit plutôt face à la pression sociale jusqu'au feu révolutionnaire de 1789. La bourgeoisie française rallie alors plutôt les rangs jacobins, ce qui lui permet d'imposer par la suite son libéralisme 242 .
La première industrialisation se manifeste en premier dans l'économie anglaise dès le dernier tiers du XVIIIe siècle. Elle est moins une révolution brutale qu'une évolution brouillonne 243 . Le processus d'industrialisation bénéficie du progrès technique antérieur tout comme il le stimule. La période atteste de la lente émergence du charbon et de la vapeur comme énergies motrices, en lieu et place de la force humaine et animale. Le secteur textile est particulièrement innovateur, grâce à l'amélioration des procédés chimiques de fabrication ou à l'usage précoce de la vapeur au service de divers modèles de machines à filer et de métiers à tisser. Cette évolution se traduit par le lent et irréversible déclin des petits métiers urbains et ruraux. La fabrication des métaux bénéficie d'importantes innovations techniques : la découverte en 1735 de la fonte au coke, puis en 1789 du puddlage représentent deux étapes marquantes 244 . L'innovation introduite par la première industrialisation influe sur l'organisation technique du travail. La division technique du travail augmente, chaque ouvrier accomplissant une portion toujours plus réduite du procès productif. La division sociale du travail croît également par la différentiation fonctionnelle des activités laborieuses entre un grand nombre de métiers de plus en plus spécialisés 245 . Ce capitalisme entrepreneurial s'affirme par la concentration et la division sociotechnique du travail selon les qualifications de la main-d'oeuvre, ainsi que par l'établissement de vastes réseaux de distribution 246 .
L'évolution technique et organisationnelle au XVIIIe siècle fait le lit de l'entreprise privée moderne. Celle-ci connecte la gestion de quatre types d'activités : la production de biens et de services ; la main-d'oeuvre ; la commercialisation ; les questions financières. L'entrepreneur est un acteur économique qui prend des décisions à ces quatre niveaux 247 . L'usage de ce schème analytique vis-à-vis des diverses formes organisationnelles d'Ancien Régime -- organisation des métiers, manufactures dispersée et concentrée -- permet d'apprécier la transition vers les modèles productifs industriels ultérieurs. Dans un deuxième temps, l'impact social de ces diverses formes d'activité est apprécié principalement par le biais de la relation de travail. Le chapitre se clôt par l'examen des modalités de responsabilité sociale des formes organisationnelles considérées.
A. L'organisation technique du travail
L'économie d'Ancien Régime est typique d'une période transitoire, donc polymorphe et incertaine. Fernand Braudel distingue un triple étagement de la structure socioéconomique. Le rez-de-chaussée est habité par la vie matérielle -- pan majeur de l'activité économique. Guidée par l'impératif d'autosuffisance et par la logique d'autoconsommation, la vie matérielle est typique des structures sociales précapitalistes, peu perméables aux échanges et aux variations des prix. Le premier étage accueille les innombrables marchés locaux. Les échanges qui rythment la vie quotidienne y sont nombreux et «transparents». Leur densité et leur rapidité croissent considérablement du XVe au XVIIIe siècle malgré la segmentation des marchés. Preuve en est la transmission toujours plus fidèle et plus ample des variations de prix des biens échangés. Coiffant le tout, une forme embryonnaire de capitalisme anime le grand négoce, la banque et la bourse, ainsi que la gestion des grands domaines ruraux. Il associe aux échanges un procès d'accumulation d'ampleur considérable, quoique peu visible. Il procède d'une volonté de court-circuiter les structures traditionnelles d'échange afin d'engranger des bénéfices plus substantiels. Animé par une élite sociale restreinte, ce précapitalisme ne constitue pas vraiment un mode de production. Il ne couvre pas non plus l'intégralité des échanges marchands sur lesquels il se fonde pourtant 248 .
1° L'organisation des métiers
Malgré de fortes variations spatiales et temporelles 249 , le Moyen Age campe solidement en milieu urbain les activités artisanales de la corporation. Celle-ci est une association professionnelle locale de maîtres-artisans « possédant des pratiques de dévotion communes, de sociabilité et d'entraide, et qui tendent à participer à la politique urbaine 250 . » L'ordre corporatif occupe ainsi de larges pans du premier étage de la construction braudélienne, dont le solde appartient aux métiers libres (Kaufsystem). Les chartes de l'ordre corporatif formalisent juridiquement l'organisation des métiers esquissée en France dès les XIIe et XIIIe siècles par la hanse, guilde, jurande et autre conjuration. La corporation est souvent à l'origine un groupement à connotation religieuse qui, telle la confrérie, évolue vers une vocation professionnelle. Moins fréquemment, la corporation est une association constituée de toutes pièces qui regroupe des métiers jurés, c'est-à-dire régis par des statuts que les membres s'engagent à respecter. Dans les deux cas, la vocation professionnelle de l'organisation des métiers se définit toujours plus clairement au cours du Moyen Age, alors que sa connotation religieuse diminue sans disparaître tout à fait 251 .
L'émergence historique de la corporation s'explique par les aléas socioéconomiques du Moyen Age. L'organisation des métiers assure une certaine sécurité matérielle et sociale de ses membres et donne plus de poids à leurs revendications politiques. La charte octroyée à la corporation par l'autorité royale définit les droits, les obligations et les prérogatives de ses membres. Politiquement, la charte garantit à l'artisan la jouissance de ses moyens de production et du fruit de son travail, tout comme elle facilite ses rapports marchands. Sur le plan économique, elle organise, distribue et normalise la production. Socialement, la corporation tisse en outre des liens de solidarité qui, comme la normalisation de la production, pallient les lacunes institutionnelles de l'activité artisanale 252 .
L'organisation des métiers vise à plusieurs objectifs. Elle organise l'approvisionnement en matières premières des ateliers, défend par des mesures protectionnistes le marché artisanal local. Grâce au travail à façon 253 , elle se calque au plus près des besoins exprimés du marché local. Elle répartit le volume de travail entre les différents maîtres d'un même métier qui procèdent ensuite à la vente directe sans intermédiaire. Solidaire et égalitaire entre ses membres, la corporation établit un monopole collectif local de l'activité productive, afin d'éviter tout monopole individuel. Elle régule la distribution du travail entre les ateliers ainsi que l'approvisionnement des marchés locaux. L'ordre corporatif est une économie de pénurie peu préoccupée par l'accroissement des volumes de production ou par l'accumulation de capital 254 . L'ordre corporatif vise avant tout à la reproduction d'une configuration sociale, à la répartition équitable plus qu'à la maximisation des bénéfices de son activité économique 255 .
L'ordre corporatif ne constitue pas pour autant un ordre populaire. Sorte d'aristocratie des métiers et des arts, il se dresse souvent contre la noblesse urbaine 256 . En interne, la corporation pratique une solidarité clanique qui exclut la femme et l'immigré fraîchement installé. Le maître jouit en outre de nombreux privilèges par rapport au compagnon et à l'apprenti. Avec ses pairs, il lui appartient d'élire les notables qui réglementent la vie corporative. Il impose le règlement corporatif au compagnon et décide de privilèges accordés aux membres de sa famille. Enfin la réglementation minutieuse des procédés, des qualités, des quantités et des prix -- en principe destinée à assurer l'égalité de chance entre maîtres artisans -- assure de fait un monopole d'approvisionnement, de fabrication et d'écoulement des produits 257 .
La puissance publique intervient souverainement dans la vie collective de la corporation. Le pouvoir de contrôle et de sanction détenu par la noblesse locale et par l'autorité royale représente la clé de voûte de l'ordre corporatif 258 . Celui-ci est activement associée à la vie publique. La corporation sert souvent de cadre électoral à l'élection de magistraux municipaux. Elle perçoit en son sein l'impôt dû à la collectivité publique et participe souvent à la politique d'hygiène publique urbaine. Elle assume même quelques tâches de nature militaire, telles que l'organisation du guet 259 . La puissance publique balance ainsi entre le maintien et la suppression des privilèges corporatifs. À son actif, la corporation stabilise socialement l'espace urbain et garnit l'escarcelle publique. Sa contribution à la cohésion sociale reste cependant limitée, car un tel mode d'organisation sociale n'est équitable que vis-à-vis de ses seuls membres 260 .
L'atelier du maître-artisan est l'unité de base et le rouage essentiel de l'organisation des métiers. L'idéal corporatif aspire à l'indépendance économique du patron. Concrètement, le maigre pécule du maître-artisan ne lui autorise pas toujours l'acquisition des locaux et de l'outillage nécessaires à l'ouverture d'un atelier, le parfois contraignant à oeuvrer pour un confrère 261 . En tout cas, l'atelier est de taille modeste. Il regroupe autour du patron quelques compagnons, apprentis et tâcherons. L'innovation technique ou organisationnelle n'est pas un but recherché 262 . L'ordre corporatif s'occupe de transmettre les connaissances techniques et les tours de métier, avec pour idéal la qualité et non la quantité de l'ouvrage. L'habileté manuelle est privilégiée par rapport au travail mécanisé 263 . La spécialisation technique est quasiment inexistante, aux antipodes de l'idée du chef-d'oeuvre. L'augmentation de la production intervient au fil du temps moins grâce à l'introduction de nouvelles techniques qu'avec la lente modification des combinaisons productives existantes 264 . En bref, le maître-artisan se montre résolument conservateur, préoccupé qu'il est de défendre ses débouchés commerciaux contre la production d'artisans urbains ou ruraux non qualifiés.
2° La manufacture dispersée
Dans une économie urbaine noyautée par la mainmise corporative, le marchand-fabricant imagine et développe une nouvelle modalité d'organisation de la production, la manufacture dispersée (putting out ou Verlagsystem) 265 . Basé en ville, le marchand-fabricant fournit les matières premières et parfois l'outillage à la main-d'oeuvre urbaine et campagnarde qu'il occupe, coordonne la production décentralisée, et revend les fruits de son activité entrepreneuriale sur les marchés urbains, régionaux, nationaux et même internationaux. Le marchand-fabricant recrute dans les campagnes tant l'artisan désireux de s'affranchir des pesanteurs corporatives que le paysan à la recherche d'un complément à ses chiches revenus agricoles. La main-d'oeuvre rurale travaille à domicile et effectue les tâches techniquement les plus simples. L'artisan qualifié exécute en milieu urbain les opérations les plus complexes et les plus fines. Tirant habilement parti du faible coût salarial de l'artisan rural et du modeste montant de capital fixe investi, le marchand-fabricant engrange de substantiels bénéfices 266 .
Cette forme précoce d'entreprise innove sous plusieurs aspects. La division géographique du procès productif découvre une nouvelle complémentarité entre les zones urbaines et rurales. L'essentiel de la production campagnarde est vendu et consommé en ville. Deuxièmement, le réseau d'approvisionnement et de distribution s'étend très loin à la ronde, parfois outremer. Troisièmement, la manufacture dispersée entraîne l'industrialisation diffuse des campagnes. Enfin, l'activité manufacturière en milieu rural stimule le commerce de denrées vivrières. La réduction du temps de travail agricole de l'artisan-paysan ne lui assure en effet plus son autosuffisance alimentaire 267 . La fonction entrepreneuriale s'affirme ainsi dans l'économie d'Ancien Régime au fur et à mesure de l'intensification et de l'extension spatiale des échanges commerciaux 268 . Le succès de la manufacture dispersée est inégal selon les régions et le type d'activité 269 . Ce modèle productif ne prévaut pas nécessairement sur l'organisation des métiers, sur les métiers libres et l'économie informelle. Il s'impose pourtant à la fin du XVIIIe siècle comme la forme dominante de proto-industrialisation 270 .
Le bouleversement induit par la manufacture dispersée sur la structure productive dans l'Ancien Régime n'est que partiel au XVIIIe siècle, car de larges pans de l'activité artisanale ne promettent pas de profit suffisant au marchand-fabricant 271 . La manufacture dispersée se développe en marge des structures corporatives et en relation avec l'essor du commerce international. Point de surprise si la police des métiers dénonce l'entreprise comme une subversion de l'ordre corporatif et considère l'entrepreneur comme un fauteur de troubles 272 . Les milieux corporatifs érigent autour de leurs activités un rempart législatif. En France, l'administration royale prête sa connivence à la manoeuvre conservatrice, alléchée qu'elle est par les ponctions financières qu'occasionnent les nouvelles tracasseries administratives. Elle renforce de surcroît son contrôle sur la production économique privée et sur les turbulents mouvements corporatifs. Arrimés à la monarchie, ceux-ci s'apaisent et se sclérosent peu à peu 273 .
3° La manufacture concentrée
Selon l'Encyclopédie, la manufacture concentrée rassemble des ouvriers « dans un même lieu pour faire une sorte d'ouvrage sous les yeux d'un entrepreneur 274 . » La concentration de main-d'oeuvre intervient parfois sous la forme d'une juxtaposition d'artisans qui réalisent chacun la facture complète d'un même objet. Le plus souvent, le procès productif y est scindé en plusieurs phases, chacune d'entre elles faisant appel à un savoir-faire et donc à une catégorie socioprofessionnelle spécifiques. Regroupé sous le même toit, le travail est émietté entre différents corps de métiers ainsi qu'entre ouvriers qualifiés et manoeuvres. Du fait de sa faible mécanisation et de ses rudes conditions de travail, la manufacture concentrée est plus proche de l'atelier artisanal d'Ancien Régime que de l'usine. La gestion de la forte densité spatiale, la parcellisation du travail et la discipline réglementaire préfigurent par contre l'ordre industriel 275 .
La manufacture concentrée en mains privées ne s'assimile pas stricto sensu à la manufacture royale française dont les débouchés sont garantis par la monarchie. La distinction entre les deux types d'établissement manque cependant de clarté, car il est à l'époque extrêmement difficile et risqué de concevoir une unité productive de grande taille sans un soutien public 276 . La manufacture concentrée produit des biens de masse telles les indiennes. En revanche, la production de la manufacture royale est de haut de gamme, destinée au roi, à la Cour ou éventuellement à l'exportation. L'établissement rassemble des divers corps de métier afin de contrôler la fabrication et l'approvisionnement des magasins royaux en des produits stratégiques ou précieux, tels l'armement et la production artistique 277 . Elle emploie nombre de maîtres-artisans aux qualifications et à la rémunération élevées 278 . La manufacture concentrée préfigure mieux les formes modernes d'organisation technique et sociale du travail, car elle définit et introduit plus clairement l'entrepreneur dans la vie économique 279 . « À la fois capitaliste, organisateur du travail dans la fabrique, enfin commerçant et grand commerçant, l'industriel est le type nouveau et accompli de l'homme d'affaires 280 . »
Même si la manufacture concentrée apparaît dans le paysage économique d'Ancien Régime 281 , elle regroupe au XVIIIe siècle rarement plus de quelques dizaines d'ouvriers. Son essor se heurte à l'opposition précoce des métiers 282 . La manufacture concentrée convient particulièrement lorsque la production dépend d'une source très localisée de matière première ou d'énergie, lorsque le produit requiert de lourdes infrastructures, des connaissances techniques élevées ainsi qu'une abondante main-d'oeuvre locale. La sidérurgie, les mines, la fabrication et l'impression de calicot et d'indiennes 283 en Angleterre, en France, en Belgique et plus tard en Suisse, connaissent précocement ce type d'organisation productive. La manufacture concentrée vise à l'accroissement de la productivité, au meilleur contrôle des quantités et des qualités produites, au maintien de la confidentialité des procédés techniques. Ses débouchés commerciaux sont garantis par la puissance publique, notamment dans la construction navale, l'imprimerie, la facture de tapis et la verrerie 284 . L'essor de la manufacture concentrée dépend enfin de la disponibilité du capital ou des dispositions du droit des sociétés 285 .
* * *
Au bilan, la structure socioéconomique du XVIIIe siècle européen encore extrêmement fragmentée et fragmentaire, dans laquelle prédomine le petit atelier artisanal. Celui-ci convient à la taille réduite des marchés, au volume limité des échanges et à la stabilité relative des techniques. Qui plus est, l'atelier est indissociable des puissants mouvements corporatifs d'Ancien Régime. Il matérialise le compromis entre la liberté économique individuelle et l'intérêt public élaboré patiemment durant le Moyen Age. Le XVIIIe siècle marque pourtant le déclin irréversible de l'organisation sociale corporative, même si celle-ci végète longtemps encore. Face aux premiers frémissements politiques et économiques, la corporation démontre sa rigidité et sa frilosité, son sens étriqué de son particularisme et de ses prérogatives. En un mot, son conservatisme.
Selon la grille analytique proposée en introduction, il est peu de formes d'activité lucrative du XVIIIe siècle qui puissent être qualifiées d'entreprises, en dépit de nombreux traits capitalistes observables dès la Renaissance 286 . L'atelier artisanal, forme principale de l'activité économique, ne présente pas les caractéristiques d'une proto-entreprise. Dans la France du XVIIe siècle, les grands travaux publics ou militaires dirigés par Colbert ou Vauban et qui mobilisent plusieurs milliers de travailleurs n'ébauchent guère non plus l'entreprise commerciale moderne. La manufacture dispersée représente par contre une forme de proto-entreprise. Ce mode productif présente d'indéniables spécificités, n'étant ni un pur complément au travail agricole ni une simple variante de l'atelier urbain. Il est une ingénieuse réponse commerciale à l'essor des marchés d'échange, tout comme une habile solution managériale pour une production à coûts réduits. L'innovation technique n'exerce à cet égard qu'un rôle marginal. Souvent meilleur négociant qu'entrepreneur, le marchand-fabricant exerce toutefois un contrôle bien imparfait du processus de production. Il délègue souvent cette tâche difficile et ingrate à un contremaître.
La manufacture concentrée répond mieux aux critères d'une entreprise par le regroupement des fonctions de financement, de production, de gestion de la main-d'oeuvre et de commercialisation. Sa novation est plus organisationnelle que technique. Alors d'importance marginale, la manufacture concentrée du XVIIIe siècle préfigure néanmoins le modèle usinier du siècle suivant, et ce moins par son degré de mécanisation que par la division du travail et la segmentation des espaces qu'elle inaugure. Les manufactures dispersée et concentrée possèdent quelques caractéristiques communes. La fonction de propriété et de direction sont le plus souvent fusionnées. Seules les grandes forges en mains nobiliaires 287 ou les indienneries propriétés de marchands comportent un directeur salarié, aux compétences techniques avérées 288 . Les techniques comptables, commerciales et productives restent rudimentaires, l'encadrement de la main-d'oeuvre peu élaboré. En forme dispersée ou concentrée, l'entreprise proto-industrielle intègre et relie laborieusement les différentes facettes de son activité.
B. L'organisation sociale du travail
L'Occident chrétien séculier connaît au Moyen Age deux types de dépendance sociale : le lien familial et la vassalité. Avec l'organisation des métiers s'amorce au XIIIe siècle la dépendance salariale qui lie le compagnon au maître. Le rapport de travail se répand et se transforme au XVIIIe siècle au sein des premières formes d'entreprise capitaliste. Le travail libre et la relation salariale s'imposent peu à peu par rapport au travail réglé par l'ordre corporatif, lequel avait supplanté le régime de servage féodal 289 . Le rapport de travail acquiert véritablement les caractéristiques d'une relation sociale au sens où il introduit une véritable transformation de la société. Le travail est certes libre dans son principe, mais la relation salariale introduit une nouvelle forme de dépendance à laquelle s'adjoignent les disruptions sociales induites par la division du travail 290 .
1° L'organisation des métiers
L'organisation des métiers vise à la paix et à la sécurité de ses membres. Elle s'efforce en outre de régler le rapport du maître au compagnon. Dans l'atelier, la relation de travail se veut en principe égalitaire, empreinte de paternalisme et de familiarité, de loyauté et de confiance mutuelles. En pratique toutefois, ce rapport social prend au fil des siècles une coloration fortement hiérarchique et plus conflictuelle. À l'instar de la vassalité, l'engagement du compagnon est formalisé par un serment et se fonde sur des privilèges détenus par le maître 291 . Le rapport social liant le maître au compagnon est ambigu. Il est une relation d'ouvrage de nature contractuelle liée à la finalité productive. Il relève également d'un lien domestique dans lequel le patron a droit d'autorité morale sur son employé. Ce double rapport social accentue la proximité et la communauté d'intérêt du maître et du compagnon, mais il accentue la dépendance de ce dernier. Le maître cumule en effet la supériorité économique liée à ses revenus, l'ascendance sociale d'une élite socioéconomique et le pouvoir de police découlant du lien domestique 292 . L'ambiguïté inhérente au paternalisme est ainsi posée. Aussi l'indépendance, l'insubordination et l'insolence du compagnon est-elle régulièrement fustigée au sein de la corporation 293 . Pour le compagnon, le travail tient du mal nécessaire 294 alors que le maître ne peut se passer de ses services. En somme, l'atelier d'Ancien Régime contient en germe la conflictualité et la coopération pragmatique qui caractérisent le relation moderne de travail.
Élaborés d'entente avec les pouvoirs publics, les statuts du métier définissent la discipline comportementale du compagnon, la qualité de son ouvrage et de ses conditions de travail, ainsi que les modalités générales de sa formation. L'apprentissage commence dès le plus jeune âge, environ sept ans, et débute parfois en parallèle de la formation scolaire. La formation est longue -- seule la durée minimale est fixée. Le maître ne forme généralement qu'un apprenti à la fois, en plus d'éventuels membres de la famille 295 . Une fois sa formation achevée, l'apprenti devient un compagnon. S'il réalise un chef-d'oeuvre qui consacre sa maîtrise technique, le compagnon accède en principe à la corporation des maîtres. En principe seulement, car le maître-artisan veille jalousement sur ses prérogatives. Le compagnon voit ainsi son statut décliner au long du Moyen Age, se consolant peut-être du sort plus précaire encore réservé au tâcheron. De nombreux contentieux opposent de surcroît le maître au compagnon, notamment quant au billet de congé et au livret ouvrier 296 .
L'examen de maîtrise vise certes à s'assurer des compétences techniques du candidat, mais aussi de son indépendance matérielle, voire de son niveau d'instruction. L'épreuve, conçue initialement comme le garde-fou du niveau technique de la profession, donne lieu à de nombreux abus à la fin du Moyen Age. L'apprentissage comme l'examen de maîtrise sont en effet considérablement facilités pour le fils du maître. La barrière à la maîtrise est également financière 297 . Ce népotisme a pour double conséquence l'érosion de la cohésion sociale interne de la corporation de maîtres et surtout la frustration croissante des compagnons à leur égard, avec pour conséquence directe l'éclosion dès le milieu du XVIIe siècle de sociétés de compagnonnage 298 .
2° La manufacture dispersée
La généralisation du travail manufacturier dans les campagnes constitue le fait le plus original de l'histoire socioéconomique du XVIIIe siècle. Les bénéfices de l'innovation paraissent partagés. La population rurale salue le revenu d'appoint dégagé par cette nouvelle activité manufacturière. Le marchand-fabricant tire parti de la modicité des salaires versés à l'artisan-paysan 299 . Autre avantage pour l'entrepreneur, la main-d'oeuvre rurale se montre docile et peu encline aux revendications collectives 300 . Quant à l'autorité publique, elle considère plutôt favorablement l'essor de l'activité économique en milieu campagnard qui assure un meilleur équilibre économique et social 301 .
À y regarder de plus près, les effets sociaux induits par la manufacture dispersée sont loin d'être univoques. L'effet d'équilibrage économique entre villes et campagnes est bien fragile. Contrairement à l'ouvrier spécialisé employé durablement en milieu urbain, la main-d'oeuvre rurale n'est liée à son employeur que par une sorte de contrat sur appel. Le marchand-fabricant reporte sur la main-d'oeuvre rurale les risques entrepreneuriaux liés aux fluctuations conjoncturelles de la vie économique 302 . Secondement, l'indépendance économique du petit artisan rural vis-à-vis du marchand-fabricant est bien fictive et même s'il possède souvent ses propres moyens de production 303 . L'irrégularité des commandes, la spécification des procédés de fabrication, de la qualité et de la quantité de la production, ainsi que la faible rémunération de son travail excluent toute velléité en ce sens. En dépit du caractère aléatoire des revenus qui lui sont associés, ce type d'activité manufacturière devient pour l'artisan rural peu à peu la source principale de revenus. L'artisan rural a un statut hybride. La propriété des moyens de production, sa relative autonomie de travail, son recours à des tâcherons l'assimilent à un entrepreneur. En revanche, le livret ouvrier et son statut de quasi salarié font de lui un prolétaire préindustriel.
De nombreux conflits de travail opposent en outre le marchand-fabricant à sa main-d'oeuvre dispersée. Dans le secteur textile, la qualité de la pièce ouvrée constitue une sempiternelle pomme de discorde. Les contrôles à domicile effectués tentent de pallier l'absence de standards de qualité, voire de définition du produit. Ils freinent sans les supprimer les vols de matière première que le paysan-artisan détourne souvent pour son propre usage. Le respect des délais de fabrication est aléatoire, vu les exigences ponctuelles des travaux agricoles. L'abandon inopiné du mandat de fabrication intervient également lorsque le paysan-artisan est débauché par un autre maître d'oeuvre. Dans ce contexte, les avances sur paiement consenties parfois par le marchand-fabricant représentent davantage une tentative de fidélisation et de stimulation d'une main-d'oeuvre trop rare et trop versatile, qu'une manifestation de son esprit philanthropique. L'employeur n'hésite pas, si nécessaire, à faire jouer le principe de la concurrence entre les familles campagnardes qu'il emploie. La faible effectivité de ces mesures l'incite peu à peu à concentrer sa main-d'oeuvre 304 .
Le modèle de la manufacture dispersée n'est pas sans incidence sociale. Durant le Moyen Age, l'organisation sociale du monde rural est minutieuse, la hiérarchie familiale sévère. Le père choisit le ou la conjoint-e de sa progéniture et même le moment de leur mariage. La règle de primogéniture prévaut : mis à part l'aîné qui hérite de la ferme, les autres enfants quittent le toit familial à leur mariage, souvent tardif 305 . La logique productive de la manufacture dispersée tend à bouleverser ces pratiques sociales. Le travail artisanal procure un gain complémentaire à la famille paysanne et élève son niveau de vie. La manufacture dispersée transforme les mentalités rurales en leur insufflant le goût du gain et de la dépense. Les enfants s'émancipent plus tôt de la tutelle familiale par le mariage avec le ou la partenaire de leur choix 306 .
3° La manufacture concentrée
Anticipation de l'usine du XIXe siècle, la manufacture concentrée bouleverse l'idée même de travail en atelier. La direction du travail gagne en autorité ce qu'elle perd en familiarité : elle devient acte de gouvernement 307 . L'administration politique d'un groupe social suppose la délimitation d'un espace géographique. L'isolement constitue la règle fondamentale de la discipline manufacturière. Les bâtiments ne s'ouvrent sur l'extérieur qu'au travers d'une porte constamment gardée. L'ouvrier retardataire est mis à l'amende. Contremaîtres et commis supervisent le travail. Les primes et les promotions récompensent la ponctualité, l'assiduité et l'honnêteté ouvrières. Le vol est sanctionné par l'opprobre public, l'amende ou même la prison. Le respect craintif de l'autorité discipline tant bien que mal la population proto-ouvrière. Habituée au travail à domicile, celle-ci regimbe face à un nouveau code de travail perçu comme trop tracassier.
La légitimité et l'autorité de l'entrepreneur sont essentiellement tributaires de sa capacité à subvenir aux besoins élémentaires de l'ouvrier et de sa famille. Le patron tente de reproduire à son compte l'esprit familial de l'atelier corporatiste. Aussi l'ouvrier est-il par exemple invité au mariage de la fille du patron. Deux pierres d'achoppement entravent cependant cette construction symbolique. D'abord l'hydre à mille têtes du niveau salarial, qui ressuscite à chaque hausse des prix des denrées de première nécessité. Ensuite les enjeux de pouvoir qui se cristallisent dans la revendication ouvrière à choisir le contremaître selon ses compétences techniques et ses qualités humaines. Revendication inacceptable pour le patron qui exige de sa main-d'oeuvre s'adapte à cette nouvelle organisation du travail : « Les ouvriers sont faits pour la manufacture et non la manufacture pour les ouvriers 308 . »
* * *
Au bilan, le maître-artisan d'Ancien Régime tente d'intégrer le compagnon dans son propre milieu de vie, afin d'imprégner les relations de travail d'autorité paternelle et de solidarité. La conflictualité inhérente à ce modèle productif tient à sa faible capillarité sociale. Cette lacune alimente auprès du compagnon de sourdes frustrations et des velléités d'indépendance récupérées parfois par le marchand-fabricant. Quant au modèle de manufacture dispersée, il n'engendre pas de conflit social majeur. Il sied relativement bien à une organisation sociale encore largement rurale et agricole. Encore que ce mode productif ne permette qu'une gestion approximative des biens et des hommes, au détriment de la productivité de l'investissement et la qualité de l'article manufacturé. Ces dysfonctionnements organisationnels gâtent quelque peu la relation entre l'employeur et sa main-d'oeuvre. Enfin la forme organisationnelle de la manufacture concentrée se distancie nettement de celle du petit atelier et de la manufacture dispersée. La relation salariale qu'elle pérennise contraste avec la relative indépendance financière de l'artisan traditionnel. Les nombreuses et strictes règles de conduite découlant de la division des tâches et de la concentration humaine introduisent sur l'aire de travail une discipline sociale et morale nouvelle. En conséquence, ce modèle organisationnel délivre quelques prémisses de la radicalisation sociale ultérieure en milieu usinier.
C. La responsabilité sociale de l'entreprise
Le chapitre précédent a distingué l'incidence sociale inhérente à l'activité économique des initiatives sociales menées par l'entreprise. Dans le premier cas est analysée la contribution sociale de l'activité économique au développement social, ainsi que la congruence des principes et valeurs de l'entreprise et de son milieu social. Dans le second sont recensés et appréciés les éventuels correctifs apportés par l'entreprise à son utilité sociale, au travers notamment des oeuvres philanthropiques. La philanthropie répond très partiellement au lancinant problème de la pauvreté. Tout au long du Moyen Age, l'indigence est perçue comme un problème religieux plus que social. La pauvreté résulterait de la volonté du Créateur ; le croyant l'adoucit par l'aumône et la charité. Dès la Réforme, le problème se sécularise peu à peu. Lors de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la pauvreté est un véritable problème social auquel répond l'essor du mouvement philanthropique. L'assistance à l'indigent devient le premier devoir moral, l'expression du lien social 309 .
Les moutures successives de la loi des pauvres 310 (poor law) en Angleterre illustrent ce double glissement du sentiment philanthropique, mais aussi le manque de limpidité de l'attitude sociale des élites face aux plus démunis. L'instrument législatif a pour objet l'allégement de la misère sociale, tout comme la répression de la mendicité professionnelle et du vagabondage. Longtemps focalisé sur son versant répressif, il acquiert durant le second XVIIIe siècle un caractère plus social 311 . La réforme législative de 1834 met fin à l'assistance du pauvre par la paroisse, ce qui subventionnait l'emploi des sans-travail et qui faussait le marché du travail. Les nouvelles dispositions légales punissent l'oisiveté de l'enfermement dans une maison de travail (workhouse) 312 . La France d'Ancien Régime ne trouve pas de meilleure réponse à l'indigence, dont l'ampleur constitue un des détonateurs de l'explosion révolutionnaire 313 .
1° L'organisation des métiers
« Membres d'une même famille, citoyens d'une petite république, les maîtres, apprentis et compagnons [...] 314 . »
Voilà exprimé davantage un idéal qu'une réalité sociale. La solidarité clanique de la corporation de maîtres-artisans est synonyme d'ostracisme vis-à-vis non seulement du compagnon et de l'apprenti, mais aussi de la femme ou de l'immigré. La charte fondatrice, la répartition du travail, le secours mutuel 315 ainsi que divers rituels assurent la cohésion corporative. La charité envers le pauvre représente le versant philanthropique et public de la vie corporative. Elle se manifeste épisodiquement, notamment par un copieux repas distribué aux nécessiteux le jour de la fête patronale de la confrérie. Ces pratiques sociales déclinent au fur et à mesure du relâchement des liens corporatifs au XVIIIe siècle 316 .
L'organisation des métiers engendre un autre type de solidarité, entre compagnons cette fois-ci. Aux XIIe et XIIIe siècles, l'atelier corporatif contribue à l'émancipation du serf et invente pour l'affranchi le statut de compagnon. En plus d'un revenu, même modeste, le compagnon bénéficie au sein de l'atelier d'une cellule sociale de base, à partir de laquelle il développe des réseaux de solidarité. Dans un premier temps, la capillarité sociale du modèle corporatif semble satisfaisante : le compagnon est très souvent admis au sein de la corporation des maîtres-artisans, même s'il n'y jouit pas de droits semblables. Par la suite, la conflictualité croissante des relations de travail, l'exclusion progressive du compagnon de la corporation et la généralisation de la pratique du tour de France suscitent l'essor du compagnonnage.
Interdite par l'Eglise, la société de compagnonnage d'Ancien Régime connaît une clandestinité plutôt factice. Elle assume les deux fonctions principales du syndicalisme ouvrier du XIXe siècle. Par sa dimension politique, elle se constitue en corps social. Son pouvoir fédérateur croît au long du Moyen Age, si bien que sa densité et son extension spatiale excèdent au XVIIIe siècle largement le niveau local, ce qui lui permet de s'opposer ouvertement à l'ordre corporatif en dénonçant son verrouillage social 317 . Dans sa fonction sociologique, la société de compagnonnage développe parmi les compagnons un esprit de corps et de solidarité 318 . La société de compagnonnage contrôle le marché local du travail, les revendications salariales, les règles de la profession et de l'apprentissage. Elle assume des tâches d'éducation, d'entraide et de soutien logistique au compagnon qui effectue son perfectionnement technique itinérant -- son tour de France 319 .
L'idéal corporatif vise à l'élévation morale de ses membres, au renforcement des responsabilités individuelles et des solidarités collectives. La forte connotation religieuse de ses rites associatifs contribue à la formation des consciences. Par le rythme de travail et le calendrier des jours fériés qu'elle instaure, l'organisation des métiers ponctue et régularise la vie quotidienne de la communauté locale. Pour le maître-artisan, la considération sociale liée à son statut récompense son labeur au même titre que ses modestes revenus. L'organisation des métiers superpose en somme les réseaux familiaux, locaux et corporatifs. Elle ambitionne un heureux amalgame entre une activité économique rémunérée, un rôle social affirmé et une certaine connivence avec les institutions politiques et religieuses. Sa fonction institutionnelle est certes importante au niveau local. Elle ne rejaillit guère hors du cadre social restreint de ses membres. Le Moyen Age démontre les aléas de l'idéal corporatif, le XVIIIe la fragilité de ses accomplissements. Les incessantes chamailleries qui empoisonnent les relations entre les corporations de métiers complémentaires témoignent de l'étroitesse de leur sens solidaire.
2° La manufacture dispersée
Le marchand-fabricant affirme franchement son appât du gain. Ses activités se développent dans des secteurs plus lucratifs que l'artisanat traditionnel. La considération sociale que lui vaudrait son activité au niveau local ne constitue qu'une satisfaction bien annexe. La manufacture dispersée constitue un piètre laboratoire de responsabilité sociale de l'agent économique. Sa fonction institutionnelle est incertaine, car elle épouse discrètement les contours des institutions sociopolitiques en place -- pouvoirs publics et religieux, corporations -- sans dialoguer réellement avec elles. La forme dispersée de la production n'autorise guère de correctif éducationnel ou disciplinaire à ses dysfonctionnements organisationnels. La manufacture dispersée affirme sa dimension sociale essentiellement au travers de l'apport au monde rural d'un chiche mais précieux complément de revenus. Le rapport salarial entre le marchand-fabricant et l'artisan-paysan se double d'une relation de clientélisme. Le premier assure des commandes et par-là une relative sécurité économique à l'artisan contre son appui politique dans les querelles de pouvoir qui l'oppose au notable local. Vu ainsi, le marchand-fabricant pratique une forme élémentaire de paternalisme social. Point d'esprit philanthropique cependant, car il n'hésite guère à débaucher sa main-d'oeuvre rurale en basse conjoncture ou à renoncer à ses services en cas de récriminations de sa part.
3° La manufacture concentrée
La manufacture concentrée appose en quelque sorte aux qualités éducationnelles de la relation de travail en atelier un appareil disciplinaire dont l'ampleur, sinon le principe, sont inconnus jusqu'alors. Oscillant entre l'éducation et la discipline avec un penchant pour le second terme, la manufacture concentrée affirme sa dimension institutionnelle. L'apprentissage représente une contribution sociale essentielle et permanente de l'entrepreneur, encore qu'il ne faille exagérer le souci d'utilité publique qui guiderait le patron en l'occurrence. Le contrat d'apprentissage de l'indiennerie Oberkampf garantit formellement à l'apprenti une formation de qualité, un emploi permanent et un bon salaire. En revanche, la famille de l'apprenti verse une garantie monétaire au cas où son rejeton abandonnerait sa formation ou cédait aux sirènes d'une manufacture concurrente. Cette forme synallagmatique de contrat d'apprentissage décourage la forte mobilité de la main-d'oeuvre et assure ses qualifications techniques 320 .
Le souci de fixation de la main-d'oeuvre prend un tour plus indirect et plus complexe au regard du travail des enfants. Chez Oberkampf, l'enfant est admis dès l'âge de cinq ou six ans. L'entrepreneur n'exploite cependant pas, comme dans les filatures ou les charbonnages, l'agilité des petites mains enfantines 321 . Les menues tâches -- messagerie, courses diverses, menus transports -- accomplies par l'enfant représente un revenu d'appoint pour sa famille. Elles sont moins harassantes que le rude travail campagnard et sauvegardent l'unité familiale si ses parents sont employés en manufacture. Pour l'entrepreneur, le travail des jeunes enfants comporte une finalité sociologique et éducative : « à regarder les adultes travailler, ils s'imprègnent des exigences morales et physiques de leur futur statut d'ouvrier 322 . » Lorsque ces enfants atteignent l'âge de treize ou quatorze ans, l'entrepreneur sélectionne les plus aptes à débuter un apprentissage de huit ans. En somme, l'habilité entrepreneuriale la plus fondamentale et la modalité la plus évidente de son utilité et de sa responsabilité sociales consiste à tirer parti de la coïncidence des intérêts privés et publics.
La leçon n'est pas uniformément assimilée. A en croire Paul Manthoux, l'enrichissement rapide de certains entrepreneurs anglais durant les premières décennies de la révolution industrielle n'étoffe guère leur conscience sociale. Leur dureté avec leur main-d'oeuvre est notoire, comme sont patentes leur étroitesse d'esprit, leur cupidité et leur vanité. La loi sur les pauvres conserve à la fin du XVIIIe siècle des traits féroces 323 qui réduisent notamment la mobilité de la main-d'oeuvre que réclame la grande industrie de l'époque. Beaucoup d'entrepreneurs se plaignent en outre du coût social de cette assistance, feignant d'ignorer que leurs ouvriers y recourent souvent pour compléter le niveau misérable de leur salaire 324 . Aussi l'esprit philanthropique manifesté par les entrepreneurs anglais apparaît-il bien superficiel à l'historien : « La philanthropie était à la mode. Mais pour beaucoup de manufacturiers, elle s'arrêtait aux portes de la fabrique 325 . » Ce groupe social acquiert rapidement conscience de ses intérêts collectifs et promeut au Parlement les idées libérales. Il milite notamment pour l'allégement de la gouverne étatique de leurs activités, ainsi que pour le statu quo en matière de protection sociale des masses ouvrières 326 .
A supposer que l'observation critique de Manthoux ait quelque validité historique, elle comporte de notables exceptions. Parfois l'activité entrepreneuriale met en contact l'entrepreneur avec le monde artistique et scientifique, ce qui contribue à élargir la conscience qu'il a de la finalité de son activité 327 . Matthew Boulton est de ceux-là, sorte d'aristocrate entrepreneur en mal de notoriété sociale plus que d'espèces sonnantes et trébuchantes. L'homme est cultivé, inventif, droit, généreux, autoritaire, mais bienveillant envers et proche de ses ouvriers. La passion pour la poterie antique de Josiah Wegwood le conduit à l'idée d'entreprendre. Il allie étroitement talents pratiques et artistiques ainsi que de hautes qualités intellectuelles et morales. Esprit très ouvert et acquis aux idées révolutionnaires françaises, le quaker milite contre l'esclavage. Il organise pour ses ouvriers une caisse de secours et une bibliothèque, contribue à la fondation d'écoles publiques. La fierté personnelle qu'il retire de ses réalisations se fonde sur leur utilité publique, non sur son enrichissement personnel 328 .
4°Le mécénat de la Renaissance
La philanthropie du XVIIIe siècle a pour indéniable ascendance le mécénat des familles patriciennes italiennes des XVe et XVIe siècles. Le patronage artistique et scientifique de cette aristocratie urbaine comporte deux prémices, économique et culturelle. L'essor des échanges internationaux dès le XIe siècle dynamise certaines cité portuaires et intérieures de la péninsule. Carrefours commerciaux et culturels, Venise, Florence, Gênes et Milan constituent dès 1450 en Europe de grandes villes moyenâgeuses et de vigoureux pôles de croissance 329 . Par ailleurs, le grand schisme d'Occident de la papauté (1378-1417) et la chute de Constantinople en 1453 provoquent en Occident une crise de civilisation qui favorise l'essor du courant humaniste. L'humanisme redécouvre avec délectation les arts et les sciences de l'Antiquité classique. Il refuse tout passéisme, voulant assurer à la fois « le progrès et le retour en arrière 330 . »
La Renaissance redécouvre en fait certaines oeuvres antiques -- celles du siècle de Périclès chez les Grecs, celles des règnes de César et Auguste chez les Romains. Son foisonnement artistique inouï est orienté plus vers l'imitation des classiques que vers l'innovation 331 . L'époque n'est pas tout au lyrisme artistique ; elle érige la raison d'Etat comme principe politique premier. Elle apporte un bémol au divorce antique entre les activités intellectuelles et manuelles, revalorise la recherche et l'activité techniques. Férue d'humanisme, la Renaissance italienne connaît un formidable élan de mécénat artistique, particulièrement à Florence. Il est un mécénat d'Etat, tantôt sous la forme d'un mandat isolé telle la décoration de la chapelle Sixtine commandée en 1508 par le pape Jules II à Michel-Ange, tantôt par l'incorporation de l'artiste à la cour du notable 332 . Il est également un mécénat nourri par les guildes ou les confréries religieuses. Chargée de l'entretien de la cathédrale de Florence, la guilde de la laine commande au début du XVe siècle à Michel-Ange son David, alors que la guilde du drap confie à Ghiberti la réalisation des bronzes des portes du Baptistère 333 . Il est enfin un mécénat patricien qui précède historiquement et inspire les deux autres.
De son épicentre florentin, le mécénat de la famille des Médicis au XVe siècle stimule la vie culturelle italienne et même européenne. Famille de banquiers et de marchands, les Médicis s'imposent dès 1434 sur l'arène politique florentine et y demeurent jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Côme l'Ancien (1389-1464) est à la fois un riche héritier, un banquier et un commerçant avisé, un politicien redoutable, un bâtisseur et collectionneur enthousiaste et un généreux mécène. Aux activités bancaires familiales, il adjoint un commerce d'importation de biens de luxe d'Orient et de Russie et une production manufacturière textile. A son zénith, sa société de holding comporte une dizaine de filiales à travers toute l'Europe ainsi que deux ateliers de tissage. Homme d'Etat, il gouverne la république florentine au simple titre de premier citoyen entre ses pairs. Outre le palais familial, il édifie de nombreux édifices religieux et plusieurs bibliothèques. Il collectionne les objets d'art qui constituent bientôt le Trésor des Médicis. Passionné de culture classique, Côme fonde l'Académie platonique de Florence à la tête de laquelle il place son protégé, l'homme de lettres Marsile Ficin. Son mécénat artistique profite ainsi à l'architecte Brunelleschi, au sculpteur Donatello et au peintre Fra Angelico 334 .
En dépit de son qualificatif flatteur, Laurent le Magnifique (1449-1492) n'a pas l'étoffe de son grand-père. Après une enfance dorée, il accède très jeune aux rênes de l'empire familial. Faute de goût pour les affaires, il laisse péricliter le négoce familial ; plusieurs de ses filiales européennes font faillite. Il n'hésite pas à puiser dans la caisse de la société familiale pour financer son fastueux train de vie. Il se montre en revanche redoutable en politique. N'est-il pas sotto voce Le Prince à qui Machiavel reconnaît en 1513 la ruse du renard et le courage du lion ? Bourgeois florentin, il vit en aristocrate et s'entoure de courtisans. Le mécénat de Laurent de Médicis n'est pas sans magnificence. Poète de talent, il fréquente les cercles littéraires et fonde l'Académie laurentine. Il soutient plus mollement les arts picturaux et plastiques. Plusieurs artistes fameux -- Michel-Ange, Botticelli et le fantasque Léonard de Vinci -- ferment alors leur atelier florentin, attirés par d'autres mécènes. Guère porté à la charité, le Florentin préfère financer des fêtes populaires dont l'éclat clinquant rehausse sa renommée 335 .
Le mécénat de Côme l'Ancien se prévaut-il du banquier et commerçant, de l'homme d'Etat ou encore de l'humaniste ? La pauvre prestance physique et oratoire du Médicis contraste avec la magnificence de son palais et avec ses dépenses somptuaires. Son luxe ostentatoire qui rompt avec la traditionnelle austérité marchande et religieuse devient un trait désirable pour le patricien florentin 336 . Le citoyen florentin fait du mécénat la preuve d'un succès économique, l'outil de légitimation et la caisse de résonance de ses ambitions politiques. Sa fièvre de bâtisseur concrétise et pérennise l'empreinte sur Florence des Médicis qui rejoignent les rangs de la vieille aristocratie locale. Le patronage de Côme l'Ancien fusionne ainsi l'intérêt familial et public. Il est privé et économique par l'origine de ses ressources, public et politique par ses moyens et sa finalité. Il satisfait en outre sa piété religieuse. Quant au mécénat de Laurent de Médicis, il est indubitablement celui d'un prince et non d'un banquier ou d'un marchand, même s'il prolonge le grand oeuvre de son aïeul.
La destinée des Médicis croise pendant la Renaissance européenne celle des Fugger, autre famille de banquiers et de commerçants. A l'instar de Côme l'Ancien à Florence, Jakob II dit «le Riche» (1459-1525) bâtit la fortune et la renommée de sa famille à Augsbourg en Souabe. Jakob s'initie au métier de l'argent à Rome, Florence et Venise. Il développe ensuite un fructueux négoce de tissus et d'épices avec l'Orient, exploite de nombreux gisements miniers en Europe centrale, contrôle par un consortium de riches marchands augsbourgeois le commerce du cuivre et de l'argent à Dantzig, Venise et Anvers. Plus encore que le Médicis, Jakob Fugger est le banquier du pouvoir temporel et religieux. Il devient l'obligé de la maison de Habsbourg et de la papauté. Il finance par un prêt l'élection en 1519 de Charles d'Espagne -- le futur Charles Quint -- contre François Ier. En contrepartie, Charles Quint reconnaît les lourdes dettes contractées à son égard par son père Maximilien et lui assure sa protection politique. A sa mort, Jakob laisse à sa famille l'empire financier le plus important de son époque 337 .
Les profils psychologiques de Côme de Médicis et de Jakob Fugger présentent de nombreuses analogies. En commun, l'intelligence et la hardiesse, mais aussi la froideur, le calcul, la ruse, voire l'absence de scrupule et le cynisme. En commun toujours, la faible extériorisation de l'émotion, la rudesse de manières et la piété. Leur goût du négoce se développe par un apprentissage précoce. Tous deux mènent une vie plutôt sobre lorsque la dépense ne comporte pas d'enjeu stratégique. Quelques nuances d'importance également. Côme n'hésite pas à fouler la scène politique, alors que Jakob se cantonne dans les coulisses. Le mécénat du Médicis exprime ses ambitions politiques, celui du Fugger justifie ses richesses. Si la religiosité de Côme est tempérée de culture classique et d'humanisme, celle de Jakob est entière. Aussi ce dernier est-il plus sensible à son salut personnel et à la charité qu'à l'art ou la culture. Tout entier dirigé vers l'action, le Fugger se passionne pour l'innovation technique. Il construit et orne de nombreux édifices religieux, finance diverses oeuvres de bienfaisance. Il associe cependant le blason familial aux manifestations de sa foi et de sa générosité. Si Jakob Fugger n'est guère porté au mécénat ou à l'humanisme, ses descendants le sont davantage durant le XVIe siècle, pour le plus grand bonheur des Holbein par exemple 338 .
Jakob Fugger construit en 1516 à Augsbourg la Fuggerei. Ce lotissement de 53 maisons et de 147 appartements est destiné aux travailleurs pauvres -- tâcherons ou petits artisans -- de la ville, dont la moralité ne fait aucun doute.
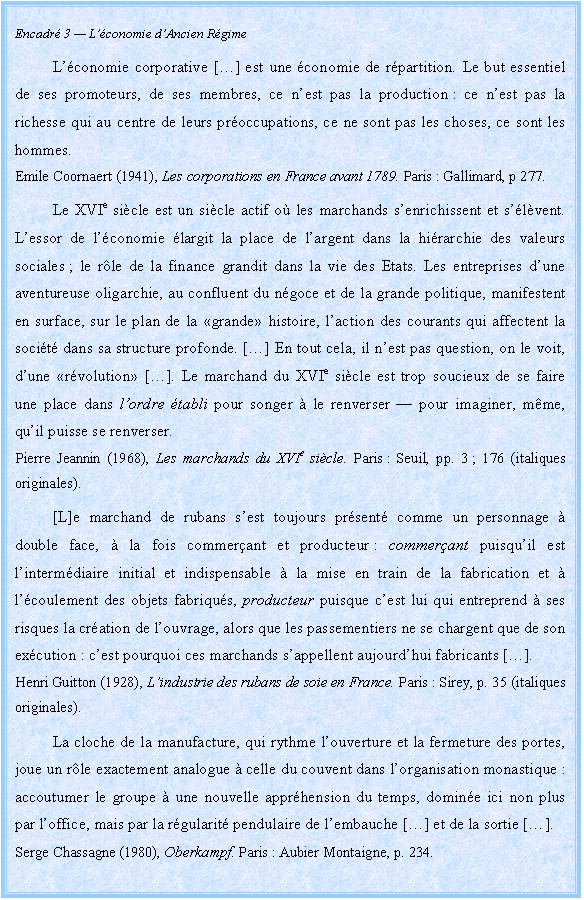 Encadré 3 : L'économie d'Ancien Régime
Encadré 3 : L'économie d'Ancien Régime
L'habitat n'est pas mis à disposition, mais loué pour une somme modique. Des pratiques religieuses sont intégrées à la vie du lotissement 339 . La Fuggerei ne constitue pas une cité ouvrière, puisqu'elle n'accueille pas la seule main-d'oeuvre de son constructeur. Pour une part, l'initiative sociale du marchand satisfait sa foi religieuse qui l'incite à la charité. L'initiative de Jakob Fugger vise plus encore à redorer le blason familial terni par la campagne contre les monopoles 340 . Le lotissement représente ainsi une forme primitive de logement social. La Fuggerei ouvre la voie du paternalisme industriel des XIXe et XXe siècle par le souci d'un encadrement moral des masses laborieuses.
* * *
Au bilan, le XVIIIe siècle atteste de dynamiques socioéconomiques diverses. La force de l'organisation des métiers s'émousse. Sa solidarité interne d'antan se transforme en une chasse gardée aux privilèges. Sa fonction sociale stabilisatrice se mue en un conservatisme borné. Enfin sa sollicitude philanthropique ne solutionne de loin pas l'indigence sociale. Le mouvement corporatif signe son arrêt de mort par son faible concours à l'évolution des sociétés européennes au moment crucial de leur transition vers la modernité. Mis hors-la-loi par la révolution française, le corporatisme ne disparaît pas instantanément. La solidarité interne de l'organisation sociale corporative et plus modestement ses oeuvres philanthropiques marquent durablement les esprits modernes. Quoique sujets à une idéalisation rétrospective, ces traits constituent aujourd'hui une référence plus ou moins explicite en matière de responsabilité sociale de l'acteur économique.
Le XVIIIe siècle témoigne par ailleurs des premières réalisations entrepreneuriales. Ces premières tentatives sont hasardeuses par définition, incertaines de leurs méthodes et de leurs résultats. L'époque découvre l'incidence sociale de l'activité économique et la responsabilité sociale de l'entrepreneur. Le marchand-fabricant considère sans doute que la main-d'oeuvre paysanne se satisfait du gain additionnel qu'il lui procure. Il enrichit parfois la relation d'ouvrage de quelques considérations paternalistes et contribue surtout à l'évolution de l'organisation sociale rurale. Par son schéma réticulaire, la manufacture dispersée préfigure avec une troublante acuité les problèmes d'organisation technique et sociale de l'entreprise transnationale contemporaine, ainsi que la définition de sa responsabilité sociale. Dans son enceinte restreinte, la manufacture concentrée exacerbe les tensions sociales inhérentes à la relation salariale préindustrielle par un encadrement plus serré de la main-d'oeuvre. De ces lignes de force se démarque une frange d'esprits éclairés mais non éblouis par leur réussite industrielle. Ce type d'entrepreneur tente d'améliorer ses rapports avec la main-d'oeuvre. Avec l'idéal corporatif en tête, il ponctue par un zeste d'humanité l'excès d'autorité perçue par le salariat. L'adoucissement du frustre encadrement de la main-d'oeuvre est inspiré par des considérations moins humanistes qu'instrumentales -- essentiellement la fidélisation de l'ouvrier qualifié. Vis-à-vis du reste de la société et de la communauté locale en particulier, l'entrepreneur, anglo-saxon surtout, saupoudre son activité économique de quelques gestes philanthropiques.
De telles initiatives sociales tiennent du franc-tireur. Elles ne suscitent guère de réflexion à large échelle sur les mutations sociales induites par l'activité économique. Les pouvoirs publics participent à cette carence. Le conservatisme d'Ancien Régime freine lourdement la dynamique entrepreneuriale qui se développe dans la mesure où les nantis -- la monarchie, l'aristocratie, le clergé, la bourgeoisie foncière et les ordres corporatifs -- s'accommodent bon gré mal gré de son effet de remodelage du paysage social. Plutôt réfractaire aux réalisations entrepreneuriales, la monarchie a encore moins de considération pour leurs conséquences sociales. Il n'est à l'époque tout simplement pas de correctif public systématique -- de politique sociale -- à l'incidence de l'activité économique privée, que ce soit en amont ou en aval de l'activité productive. La charité religieuse et publique assortie de la philanthropie privée tiennent lieu de politique sociale. D'ampleur limitée, ces initiatives discrétionnaires souffrent en plus de leur coordination insuffisante.
Quant au capitalisme financier et marchand du dernier étage de l'édifice braudélien, il ne participe guère à la dynamique entrepreneuriale de l'époque. Il ne s'inscrit pas contre l'ordre social existant, mais y participe par sa connivence avec le pouvoir temporel et religieux. Grâce à des techniques bien rôdées, ces réseaux d'affaires prennent une envergure et une portée géographique considérables et jouent un rôle de premier ordre dans le développement des échanges internationaux. Ce précapitalisme stimule grandement par son mécénat la vie artistique et scientifique de la Renaissance. Ce mécénat comporte une finalité moins économique que politique de renommée familiale et d'élévation sociale. En bref, le capitalisme marchand et financier de la Renaissance rehausse l'éclat des sociétés européennes qui l'accueillent sans guère pénétrer leur substrat social.
4. De la première à la deuxieme Industrialisation
De son épicentre anglais, la première industrialisation touche par ondes successives l'Europe continentale et le continent nord-américain dès le dernier quart du XVIIIe siècle. Elle n'a probablement pas le caractère révolutionnaire qu'on lui a prêté parfois 341 . Si elle manque de netteté chronologique, cette césure historique n'en reste pas moins fondamentale par son impact -- profond et irréversible -- sur la vie sociale. Au-delà d'inévitables particularismes nationaux qui affectent l'occurrence du processus d'industrialisation, ses moyens et ses coûts humains, il en résulte une indéniable homogénéisation du tissu socio-économique des sociétés européennes dans la seconde moitié du XIXe siècle 342 . But avoué de la première industrialisation, l'amélioration de la faible productivité de l'activité économique d'Ancien Régime requiert de nouvelles techniques et structures productives, ainsi que le renouvellement des compétences et de l'encadrement de la main-d'oeuvre.
Par rapport à l'accélération du progrès technique intervenu un siècle auparavant, la seconde industrialisation met en exergue des techniques au spectre d'utilisation industrielle bien plus large. La vapeur s'efface avec panache devant l'électricité et les dérivés du pétrole. Leur valorisation industrielle ne tarde pas : les moteurs électrique, à explosion et à combustion interne (Diesel) voient le jour avant le tournant du siècle, tout comme les premières machines de production plus ou moins automatisées. En parallèle, l'importance relative du secteur textile décline. Grâce aux progrès de la physique et de la chimie des matériaux, l'industrie chimique rejoint au début du XXe siècle la sidérurgie et la mine pour constituer la grande industrie 343 . Une deuxième vague de progrès technique intervient au milieu du XIXe siècle. Elle a pour assise l'acier et ses applications industrielles tel le rail de chemin de fer.
Le XIXe siècle consacre la laborieuse émergence de l'usine. Elle est essentiellement en mains privées. Les fonctions capitaliste et entrepreneuriale sont assumées par une seule personne ou une même famille. En dépit ou en raison de la difficile concentration du capital et du travail dans l'enceinte usinière, la structure productive demeure hybride. Elle mêle des reliquats d'Ancien Régime à des traits résolument modernes, joue sur les oppositions et les complémentarités des petites et grandes unités productives, du travail artisanal et industriel, des zones rurales et urbaines. Ces tensions ne se dénouent guère avant l'occurrence de la seconde industrialisation lors du dernier tiers du XIXe siècle 344 . La vie usinière introduit une nouvelle relation de travail, rugueuse et dépourvue d'aménité. Elle assèche et durcit les rapports entre le patronat et le salariat. Elle divise les hommes et parcellise le procès de production. Le travail en usine violente tout particulièrement l'ouvrier d'origine rurale, privé de ses repères géographiques, temporels et sociaux.
Dans un premier temps, les pouvoirs publics ne s'émeuvent guère de la précarité de la condition ouvrière. Dans la France d'avant 1840, l'Etat se refuse d'arbitrer la relation de travail ou d'embauche et se borne à assurer l'ordre public 345 . Le libéralisme règne quasiment sans partage dans le premier XIXe siècle avant d'affronter son contradicteur socialiste. La dureté matérielle et morale de la condition ouvrière ne tarde pas à susciter des résistances. D'abord erratiques et locales, les luttes ouvrières acquièrent à la fin du premier XIXe siècle un caractère plus méthodique et collectif. La législation sociale se dessine peu à peu au cours du XIXe siècle. Dans l'Angleterre du début du XIXe siècle, la condition de la main-d'oeuvre féminine et enfantine émeut certains esprits bourgeois. Ce n'est pourtant qu'en 1833 que la loi sur les fabriques réglemente le travail des enfants. Cette législation fait école sur le Vieux Continent. Aux grandes grèves des années 1840 répond la législation française sur le travail promulguée sous la IIe République (1848-1851) 346 . La France n'autorise cependant le droit de grève qu'en 1864 et les associations ouvrières qu'en 1884, contre respectivement 1875 et 1826 pour l'Angleterre. Puis entrent en vigueur des dispositions limitant l'âge au travail et la durée quotidienne et hebdomadaire du temps de travail.
Lors du second XIXe siècle, le patronat ne demeure pas impavide devant l'agitation ouvrière et le danger socialiste. Si l'encadrement paternaliste de la main-d'oeuvre qu'il conçoit alors est relativement homogène dans des modalités, il procède de convictions diverses. Dans une Angleterre acquise au libéralisme de l'école de Manchester, les initiatives sociales émanent de libres penseurs tel Robert Owen. Philosophe social, industriel philanthrope et plus tard politicien, Robert Owen connaît à l'aube du XIXe siècle les fortunes et les déboires du visionnaire. L'homme est assez brillant et novateur pour marquer son époque de son empreinte, trop précurseur et idéaliste pour transformer profondément les mentalités. Résolument séculier, le paternalisme industriel préconisé par Owen comporte une importante dimension éducative. Convaincu de sa supériorité morale, l'entrepreneur exerce une autorité bienveillante pour prôner la ponctualité, la frugalité et la moralité ouvrières. Le paternalisme connaît également un retentissement sensible parmi les entrepreneurs de confession réformée. Le projet paternaliste s'accompagne alors de considérations religieuses.
Si la prégnance du paternalisme est relativement modeste en Angleterre, celle de la philanthropie privée l'est davantage. La charité est à l'honneur parmi les classes privilégiées -- expression d'un "noblesse oblige" empreint de valeurs religieuses, mais aussi de commisération voire de dédain vis-à-vis du pauvre. Elle se développe encore sous l'ère victorienne de la fin du siècle. Une telle conception de la responsabilité sociale de l'activité économique trouve de solides justificatifs dans la philosophie classique anglaise. Selon Adam Smith, l'entrepreneur est capable d'une solidarité pragmatique malgré son égoïsme stimulé par la logique marchande 347 . L'économiste ne s'appesantit guère sur les modalités de cette solidarité ni sur sa relation concrète avec les principes compétitifs de la vie économique. L'utilitarisme moral élaboré par Jeremy Bentham (1748-1832) précise cette interrelation. Le philosophe définit pour meilleur principe d'action l'intérêt personnel bien compris, car il améliore le sort du plus grand nombre. Guide de la vie économique, l'intérêt personnel autorise et justifie la souffrance d'une minorité sociale, souffrance allégée par les pratiques charitables. On en déduit une conception de la responsabilité sociale de l'entreprise moins paternaliste que philanthropique, au contraire du modèle français.
En France, la diffusion du paternalisme parmi les cercles industriels français est plus large et plus homogène. Le phénomène doit beaucoup à Frédéric Le Play qui, au contraire d'Owen, influence davantage les débats politiques de son époque. Le régime de patronage qu'il propose tente alors de concilier les impératifs publics de paix sociale avec les objectifs privés de fixation et de moralisation de la main-d'oeuvre, décidément toujours aussi volage et dissolue aux yeux du patronat. Si la légitimité populaire du mouvement d'économie sociale promue par Le Play souffre de sa connivence avec le patronat français, elle continue d'influencer les politiques sociales patronales au long du second XIXe siècle 348 . Le régime de patronage connaît un succès d'estime notamment en Alsace-Lorraine, où il sied tout particulièrement à l'ethos calviniste des huguenots.
Si le choix entre les réalisations sociales et les mesures philanthropiques s'explique par le contexte socioculturel, il est également tributaire à un certain degré de l'origine et de la condition sociale de l'entrepreneur. L'entrepreneur d'origine aisée tempère de mesures philanthropiques la dureté des conditions de travail. Il se montre soucieux de l'éducation de sa main-d'oeuvre et exige en retour gratitude et dévouement. En revanche, l'ancien artisan ou ouvrier est plus rigoriste en matière réglementaire et plus exigeant dans la qualité de l'ouvrage. Il prône par son propre comportement l'attitude idoine au travail et rémunère généralement davantage sa main-d'oeuvre 349 .
A. L'organisation technique du travail
L'abolition par les révolutionnaires français de la corporation et de ses privilèges n'entraîne pas la disparition pure et simple de sa capacité de structuration sociale. Privé d'existence légale, l'ordre corporatif perdure sous une forme plus informelle. Aussi la société de compagnons ayant accompli leur tour de France est-elle très vivace durant le premier XIXe siècle 350 , comme pour protéger les métiers de la diffusion du machinisme 351 . Il est vrai que l'atelier artisanal demeure alors la forme principale de l'organisation productive, et ce tant par la proportion de la main-d'oeuvre qu'elle occupe que par la valeur de sa production 352 . On en déduirait la persistance de pesanteurs d'Ancien Régime qui obérerait l'industrialisation européenne. La réalité est plus complexe. La structure productive de l'époque est hybride, mêlant des éléments de proto-industrialisation avec des traits précurseurs des modèles productifs de la fin du siècle.
1° Une structure productive hybride
En dépit de ses inconvénients notoires 353 , la production en manufacture dispersée conserve au XIXe siècle un certain crédit auprès de l'entrepreneur français. La docilité de la main-d'oeuvre et la souplesse du modèle productif adoucissent les fluctuations conjoncturelles des marchés. En Angleterre, la fabrique s'impose dès le début du siècle dans le secteur cotonnier, puis dans les autres secteurs industriels dans la seconde moitié du siècle 354 . Le petit atelier urbain ou rural n'est cependant pas condamné ipso facto par l'industrialisation à grande échelle que connaissent surtout la filature textile et la sidérurgie. Ces divers modèles organisationnels se complètent plus qu'ils ne se concurrencent directement au sein d'un même secteur d'activité.
En France, le petit atelier de tissage manuel d'étoffes de laine, de soie ou de lin connaît par exemple encore de belles heures au XIXe siècle, alors que l'usine accapare le filage des matières premières textiles et le tissage mécanique des cotonnades. L'atelier maintient sa viabilité par la compression de ses coûts, essentiellement de ses charges salariales 355 . L'usine assure la sienne par l'augmentation de productivité engendrée par la mécanisation 356 . Ce modèle hybride perdure dans le secteur textile français pendant les trois premiers quarts du siècle, alors qu'il est rapidement dépassé en Angleterre 357 . Dans le secteur sidérurgique français, la petite forge locale utilisant le charbon de bois produit l'essentiel du fer de consommation courante, aux côtés du grand complexe sidérurgique dont les hauts fourneaux au coke permettent la réalisation de pièces de grande taille ou de séries standardisées 358 . A cet égard, les aciéries du Creusot qui occupent en 1795 déjà 1'500 ouvriers ne sont guère représentatives de la structure socio-économique du moment ; elles laissent plutôt présager du formidable potentiel de ce secteur industriel au long du siècle.
Durant le premier XIXe siècle, la concentration industrielle ne se développe pas de façon linéaire. Des mouvements centrifuges et centripètes cisaillent simultanément et alternativement le tissu industriel, éliminant les entreprises les moins compétitives, qu'elle que soit leur taille. Les plus grandes filatures mécaniques européennes expérimentent dans les premières décennies du siècle un schéma d'intégration verticale, afin de pallier notamment les difficultés d'approvisionnement dues aux guerres napoléoniennes 359 . Simultanément, les crises économiques récurrentes exercent un effet indirect de concentration industrielle par l'élagage, généralement par voie de faillite, des ateliers les moins performants. La transition du travail à façon vers la logique marchande est difficile vu l'instabilité chronique de la demande. Confrontées à d'insolubles problèmes de gestion et à des rigidités spécifiques à leur taille, certaines grandes manufactures, dont l'indiennerie Oberkampf, s'effondrent 360 . La concentration industrielle n'a décidément rien d'une panacée ou d'une marche triomphale.
Loin de décliner, la petite industrie urbaine s'affirme plutôt dès 1820 en Angleterre, dès 1830 en France. Une constellation de petites et moyennes entreprises densifie le tissu économique urbain par des flux de capitaux et de biens, fortifiés par des liens de sang comme par des relations interpersonnelles. Le dynamisme entrepreneurial profite également de l'amélioration des réseaux de transport et de l'essor des échanges, tout comme il paie parfois tribut au soutien et à la diligence des édiles locaux. L'atelier urbain gravite souvent autour de la fabrique, formellement par des contrats de sous-traitance ou indirectement par la complémentarité de leur production respective. La petite unité productive démontre sa compétitivité dans des niches sectorielles à forte intensité technique ou aux débouchés hétérogènes et fluctuants, tels les produits de luxe ou la fine mécanique 361 . En milieu rural, une myriade d'activités productives aux forts relents artisanaux perpétue la forte connivence entretenue au siècle précédent par la proto-industrie et l'agriculture 362 .
L'essor de la grande entreprise lors des deux premiers tiers du XIXe siècle doit beaucoup au développement des échanges internationaux. La tendance à l'internationalisation de la production s'observe en fait dès le milieu du siècle, voire antérieurement. Elle a pour prémisses d'une part l'amélioration des réseaux de transport et de communication, d'autre part la relative intégration des marchés nationaux et l'émergence des classes moyennes. Elle connaît deux variantes principales, la production sous licence et la production directe. Pour le détenteur du brevet, la production sous licence représente une stratégie intermédiaire entre l'exportation et la production directe. Elle élimine le risque économique lié à un investissement à l'étranger et lui garantit le versement régulier de royalties par son partenaire à l'étranger, lequel assume les risques commerciaux de l'exploitation du brevet. La production directe comporte plusieurs avantages. Elle permet d'échapper à la cherté de la main-d'oeuvre locale. Elle supprime les intermédiaires de vente et de production sur le marché étranger, et contourne les barrières douanières. Enfin la production directe contrôle la diffusion commerciale d'une invention, faute de brevet international de propriété intellectuelle.
Ces quatre considérations à l'esprit, l'armurier américain Samuel Colt ouvre en 1852 une manufacture à Londres. Calcul risqué qui n'est pas couronnée du succès commercial escompté. A l'échelon européen, certains entrepreneurs français ou britanniques jouent les précurseurs dans les années 1830 déjà. Le cotonnier alsacien Koechlin implante par exemple deux manufactures de machines textiles dans le Zollverein germanique, alors que Schlumberger établit une indiennerie dans le pays de Bade 363 . A partir de 1880, le mouvement d'internationalisation de la production s'affermit, surtout dans les marchés encore peu concurrentiels. Après un expérience malheureuse de sous-traitance en France, le fabricant américain de machines à coudre Singer ouvre en 1867 une fabrique en Ecosse, puis au Canada et en Autriche. Il développe parallèlement son réseau commercial avec pour quartiers régionaux New York, Londres, Hambourg. Dès 1890, beaucoup de firmes américaines et européennes optent pour l'installation de structures productives au sein même des marchés étrangers, coloniaux notamment 364 . L'essor de la grande entreprise est facilité par la rénovation du droit des sociétés. Au second XIXe se diffuse la société anonyme. Elle n'entraîne pas la disparition de l'entreprise en mains familiales, car la famille propriétaire conserve souvent une part majoritaire du capital social. Fait plus novateur, la société anonyme stimule l'essor des places boursières 365 .
D'un souci de belle ouvrage qui la caractérise au début du siècle, la production industrielle glisse vers 1880 grâce aux progrès de productivité à l'impératif de la production de masse 366 . Aussi tiendra-t-on pour acquise la diffusion dès le milieu du siècle de la concentration industrielle 367 . En interne de l'entreprise, le regroupement des forces productives procède d'une double ligne de facteurs, techniques et sociaux. D'une part, le machinisme introduit pour l'entrepreneur de nouvelles contraintes : amortissement des montants considérables de capitaux fixes engagés par l'acquisition de grosses machines à vapeur, coûts salariaux liés à la maintenance de ces machines. Ces contraintes rendent d'autant plus impérative la réalisation d'économies d'échelle par la concentration industrielle. D'autre part et corrélativement, la mécanisation de la production et l'augmentation de la productivité industrielle suppose la mise en discipline de la main-d'oeuvre au comportement fantasque et rebelle 368 .
2° Le capitalisme familial
Quelle que soit sa taille, l'entreprise du XIXe siècle est essentiellement en mains privées. Le propriétaire et l'entrepreneur ne font qu'un. Lorsque l'essor de l'entreprise est tel qu'il outrepasse les capacités financières ou les compétences techniques de son géniteur, celui-ci fait appel à des proches -- membres de sa famille, amis, relations de confiance. La fabrique en propriété familiale ne naît pas de la seule et soudaine volonté d'un homme à la vocation entrepreneuriale. Elle résulte d'une longue et patiente capitalisation et d'une évolution socioprofessionnelle intrafamiliale et intergénérationnelle qui puisent leurs racines dans les activités commerciales ou proto-industrielles d'Ancien Régime. Dans le second XVIIIe siècle, il n'est pas rare que le fils d'un commerçant de tissus devienne marchand fabricant, puis que son petit-fils fonde ensuite une filature 369 .
Le capitalisme familial allie l'entreprise et la famille, soit les unités économique et sociale de base. La famille favorise l'essor de l'entreprise au XIXe siècle. Sa cohérence institutionnelle et affective établit une communauté de destinées propice à l'action collective. La dynastie familiale est riche des valeurs de stabilité, de sécurité et de continuité. L'entreprise familiale autorise la souplesse et le secret, favorise la division solidaire des tâches. Les fils se partagent les fonctions directoriales, alors que les filles drainent par le mariage l'argent et les compétences 370 . La continuité familiale assure la réussite industrielle. La cellule et la dynastie familiale restent fragiles, liées à l'incertitude des destins individuels. Le capitalisme familial marque néanmoins de son empreinte le XIXe siècle et démontre sa résilience au siècle suivant encore 371 .
Le maintien de l'indépendance de l'entreprise passe par l'internalisation rapide de tout apport financier externe, ce que démontre le faible recours au crédit bancaire du capitalisme familial pour son développement 372 . L'endogamie dans le contexte familial élargi permet de " rester après Dieu le maître de l'entreprise 373 " et de développer l'entreprise familiale 374 . La famille accueille plutôt cordialement un gendre ou une bru qui stimulerait par des compétences techniques ou commerciales son propre savoir-faire manufacturier, à moins qu'il n'injecte du sang neuf dans l'entreprise sous la forme d'apport en capital. La création d'une interdépendance est ainsi souvent le moyen de préserver son indépendance et son avenir. Le Nord-Ouest français, qui enregistre au XIXe siècle le large recours à de telles pratiques matrimoniales, voit se développer un faisceau de liens sociaux et d'obligations mutuelles entre familles d'industriels.
B. L'organisation sociale du travail
Les conséquences sociales de l'industrialisation anglaise du XVIIIe sont multiples et complexes. Aussi le dépeuplement des campagnes croise-t-il des flux migratoires en sens inverse, de moindre importance il est vrai. Le travail domestique résiste opiniâtrement à la généralisation du travail en fabrique, comme l'activité manufacturière de l'ouvrier paysan glisse avec hésitation du temps partiel au temps complet. La déqualification professionnelle de l'ouvrier induite par la division du travail usinier est probable, encore que l'usine suscite de nouvelles compétences techniques. Par ailleurs, le caractère apparemment similaire d'une même facette de la vie économique diffère parfois notablement avant et après l'industrialisation. Ainsi le travail des enfants prend au XIXe siècle une ampleur considérable dans l'industrie textile ou minière, alors qu'il n'avait qu'une importance marginale précédemment. Ces remarques introductives sont généralisables à l'ensemble des sociétés occidentales de l'époque et nuancent l'analyse ci-dessous de l'impact social de l'industrialisation.
1° L'origine de la main-d'oeuvre
Considérant l'incidence des formes organisationnelles de l'activité productive sur les rapports sociaux, il n'est pas superflu de rappeler que la fabrique ou l'usine ne représentent au XIXe siècle pas la modalité unique ou même principale de l'organisation productive. Dans l'économie anglaise pourtant la plus avancée, la proportion des ouvriers anglais employés en 1850 dans de grandes unités productives n'est importante -- et encore rarement dominante -- dans les filatures mécaniques, les aciéries, les fonderies, le secteur minier. La plus forte partie de la main-d'oeuvre anime la petite industrie textile, alors que l'agriculture occupe encore de nombreux bras 375 . La diffusion spatiale de l'usine est lente, car elle bouleverse les géographies rurales et surtout urbaines. En dépit de ses volumes imposants qui s'accommodent mal des exiguïtés urbaines, l'usine aspire à se rapprocher des marchés et des petites et moyennes entreprises (PME) sis en milieu urbain. Elle blesse la fière coquetterie des centres villes, qui la relèguent dans l'espace périurbain ou à proximité d'agglomérations secondaires 376 . L'étude du milieu usinier demeure nonobstant cruciale, et ce à plus d'un titre. Tout d'abord, l'usine du XIXe siècle consolide et pérennise ce que la manufacture concentrée a timidement inauguré sous l'Ancien Régime : la dépendance salariale totale et permanente de l'ouvrier qui vend sa force de travail à l'entrepreneur. Ensuite, l'usine cristallise l'évolution des techniques par la mécanisation de sa production, transformation qu'elle réalise avec lenteur et parcimonie jusqu'à la deuxième révolution industrielle.
Les trois sources principales du salariat occupé par la grande industrie --proto-industrie rurale, artisanat urbain, paysannerie -- font la part belle aux populations campagnardes. Le phénomène résulte de la lente croissance du travail manufacturier dans l'activité de l'artisan paysan au détriment des tâches agricoles. Perceptible en France au XVIIIe siècle déjà, la tendance se confirme entre 1840 et 1880 par la lente désindustrialisation des campagnes et par des flux migratoires vers l'usine périurbaine 377 . Ces migrations proviennent surtout des goulets d'étranglement du travail et de la production agricoles face aux poussées démographiques 378 . La main-d'oeuvre itinérante s'arrime bien mal en milieu urbain. Son instabilité notoire découle pour une part de la précarité des engagements professionnels qu'elle contracte : la mobilité professionnelle et géographique de l'ouvrier non qualifié est élevée, victime des fluctuations conjoncturelles de la production. Plus fondamentalement, la main-d'oeuvre d'origine rurale répugne à s'en remettre à un seul patron, ce qu'atteste la forte mobilité géographique de l'ouvrier qualifié 379 .
2° La vie usinière
Tout à son projet concentrationnaire, l'usine tente de fixer et de discipliner cette main-d'oeuvre longtemps disparate. Elle suscite le plus souvent un développement urbanistique chaotique de l'agglomération qui l'accueille. Elle appose parfois à la fabrique des logements ouvriers. Plus rarement, l'usine crée autour d'elle une véritable ville-champignon. En tous cas, le logement ouvrier est rudimentaire, voire insalubre et carcéral. Il rompt l'harmonie traditionnelle de l'activité manufacturière et agricole de l'ouvrier paysan, l'isole du contact avec son environnement naturel. Alors que la manufacture du XVIIIe siècle s'inspire des règlements monastiques pour l'élaboration de ses principes de discipline ouvrière, l'usine du siècle suivant évoque plutôt la caserne 380 . Le soir, des chaînes barrent l'accès externe des habitations ouvrières qui ceinturent la manufacture de Saint-Gobain 381 . Pour l'ancien artisan paysan, l'emploi usinier permanent et à long terme sonne le glas de son indépendance. Les horaires stricts et continus du travail en usine tranchent résolument avec la foncière irrégularité des rythmes de la vie rurale. Cette perte de liberté est bien maigrement compensée par la sécurité d'une rémunération régulière 382 . Autrefois assuré à la fois en nature et en espèces, le salaire de l'ouvrier prend une forme essentiellement monétaire, froide 383 . Il suffit à peine à assurer la subsistance du salarié. La précarité matérielle de l'ouvrier d'origine rurale est aggravée par le sentiment de déracinement physique et social qu'entraîne pour lui la rupture des solidarités familiales et locales 384 . " L'industrialisation est vécue comme une blessure 385 . "
L'idéal corporatiste hante probablement l'esprit ouvrier du XIXe siècle. L'usine exclut pratiquement les relations personnelles et les obligations croisées entretenues par le maître-artisan et le compagnon dans un cadre de travail largement familial. Par sa taille et son organisation de travail, elle génère des rapports sociaux fortement hiérarchisés, impersonnels et potentiellement conflictuels 386 . Le contrat d'embauche représente une véritable loi interne à l'espace usinier. Il s'articule autour de quatre modalités principales : la gestion du temps par la définition des durées de travail et de pause ; la gestion des espaces par le règlement des entrées et sorties de l'usine, ainsi que des déplacements intérieurs ; la gestion des processus de production par la mention des règles d'usage des machines et des rémunérations ; enfin le dessin d'un ethos de travail par la formulation des principes hiérarchiques et des normes comportementales. En dépit de sa forme contractuelle, le règlement de travail est rarement négocié vu l'asymétrie de pouvoir lors de l'embauche entre l'employeur et son futur employé. La position de force du patron est confirmée par la pratique du livret ouvrier 387 . En sus de la panoplie d'amendes et autres retenues salariales qui sanctionne toute infraction disciplinaire ou faute professionnelle, le livret ouvrier revêt dans le contexte usiner du XIXe siècle un caractère d'instrument de sujétion qui discipline la conduite ouvrière 388 .
Modalité sociale première de l'usine, la concentration du travail autorise, à un degré inconnu jusqu'alors, le contrôle qualitatif des procédés de fabrication et des produits, des hommes et de leur travail 389 . Le recours à la mécanisation et à la division des tâches rendent le travail plus répétitif et monotone. Les conditions de travail en fabrique sont très rudes, particulièrement dans le premier XIXe siècle. L'insalubrité des conditions de travail y est patente. Espaces "improductifs", cantine et vestiaire apparaissent comme superflus aux yeux du patronat. La machine s'arroge l'essentiel de la surface utile, encombre de ses dangereux éléments mobiles l'espace encore inoccupé, échauffe l'air ambiant et le charge de poussières. L'aération et l'éclairage sont insuffisants, l'humidité souvent de mise, les mesures de sécurité le plus souvent inexistantes. En cas d'accident, il incombe à l'ouvrier de prouver la négligence patronale 390 . La journée de travail est longue comme un jour sans pain, avoisinant en moyenne quatorze heures quotidiennes durant le premier demi-siècle français. Face aux progrès de l'éclairage et en l'absence de limitation légale du temps de travail, elle tend même à s'allonger.
Le large recours à la main d'oeuvre enfantine et féminine hors de la cellule familiale est un des aspects les plus inédits du processus d'industrialisation 391 . Le phénomène est très répandu dans l'industrie textile et dans la petite industrie. Les enfants ne sont plus embauchés dans une perspective d'apprentissage comme le plus souvent dans les campagnes et les métiers d'Ancien Régime. La logique de division du travail sépare désormais l'ouvrier de sa progéniture. Dans l'usine, l'enfant est affecté à des tâches subalternes qui exploitent son agilité manuelle sans développer de réelles compétences professionnelles. La nécessité fait office de loi : l'intérêt patronal converge avec celui de l'ouvrier dont les responsabilités parentales légitiment un appoint, si dérisoire soit-il, à son maigre salaire 392 .
L'appréciation des conséquences de l'industrialisation sur les qualifications professionnelles est complexe. Elle requiert la considération de deux phénomènes aux effets sociaux connexes, à savoir la mécanisation et la division du travail. La première stratégie relève de la gestion de la production et vise notamment à alléger la peine physique de la main-d'oeuvre. La seconde concerne davantage l'encadrement de l'ouvrier en condensant son savoir-faire. Toutes deux concourent à augmenter la productivité du travail. L'irruption de la machine dans le procès de production n'a pas pour nécessaire corollaire le recours à la division du travail. Cette dernière peut être l'alternative à la machine dans la production d'articles techniquement simples et d'usage courant, tels que chaussures, vêtements, meubles. Dans ce cas, la parcellisation accrue du procès productif entraîne une certaine déqualification ouvrière. La simultanéité de la mécanisation et la division du travail s'observent mieux dans la grande industrie. En l'espèce, la division du travail n'a pas pour conséquence univoque la contraction des compétences techniques de l'ouvrier. Elle peut susciter de nouvelles qualifications ou en réactiver d'autres. Par exemple, la mécanisation de la grande filature requiert de nombreux mécaniciens chargés de la maintenance des machines 393 .
Devant la nécessité de compétences techniques nouvelles ou plus affûtées, l'industrie et la recherche scientifique affermissent leurs liens et développent de nouveaux champs d'investigation 394 . Beaucoup de temps et d'énergie sont nécessaires à dériver d'une découverte scientifique des débouchés industriels. En plus d'obstacles objectifs subsistent dans les mentalités patronales et ouvrières des résistances psychologiques liées à des procédés routiniers. Ces pesanteurs sont d'autant plus fortes que se creuse un fossé entre d'une part une élite technicienne formée dans les écoles d'ingénieurs et d'autre part les masses ouvrières au savoir acquis "sur le tas". L'ingénieur manque d'expérience pratique pour valoriser son bagage technique, alors que l'ouvrier regimbe face aux nouvelles exigences. Certaines firmes houillères fondent au milieu du siècle leur propre école, alors que progresse l'idée d'un apprentissage professionnel distinct de l'exercice du métier. L'acquisition du savoir-faire technique ouvrier conserve malgré tout en France vers 1880 un caractère très empirique et peu formalisé 395 .
3° Résistances ouvrières
" Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! " La célèbre exhortation du Manifeste du parti communiste de 1848 exprime implicitement la laborieuse et difficile agrégation des voix ouvrières, au-delà de leur récusation quasi unanime du régime de travail usinier. Plus fortement dévalorisé par le travail usinier, l'ancien artisan paysan se cabre plus fortement que l'ouvrier qualifié. La machine en soi n'est pas portée aux gémonies, car elle économise la force musculaire. Son double corollaire de division du travail et de déqualification professionnelle s'attire par contre les foudres ouvrières. La mécanisation dégage indirectement le patron du chantage autrefois souvent pratiqué par l'ouvrier très qualifié, donc précieux. Les nombreuses crises luddites 396 qui émaillent le premier XIXe siècle ne traduisent pas tant un refus ouvrier de l'innovation technique que la défense des métiers contre leur déqualification et leur perte de pouvoir informel face au patronat 397 .
Le mouvement ouvrier qui s'organise peu à peu au long du XIXe siècle n'est pas la conséquence immédiate de l'industrialisation. L'homogénéisation de la classe ouvrière et la cristallisation de sa conscience de classe sont laborieuses et irrégulières. La dynamique procède d'une grande diversité de facteurs. Premièrement, l'hétérogénéité caractérise longtemps la composition sociale, la condition et les revendications ouvrières. La segmentation reste forte entre les différents corps de métier, entre l'ouvrier qualifié et non qualifié, entre l'ouvrier d'usine et l'artisan de la petite industrie. Deuxièmement, la forte mobilité géographique et socioprofessionnelle de la main-d'oeuvre, ainsi que son fort taux d'analphabétisme, la rareté des moyens d'enseignement et d'expression ouvrière sont autant d'éléments qui obèrent la formation objective et subjective de la classe ouvrière 398 . Troisièmement, les dispositions légales freinent le processus. En France, la loi Le Chapelier de 1791 met en principe hors-la-loi toute association professionnelle patronale ou ouvrière, prohibe les réunions et les conventions tendant à fixer les prix et les salaires, interdit les grèves. Sa mise en oeuvre frappe en fait plus sévèrement les associations ouvrières que patronales. La loi n'est abrogée qu'en 1864 399 . Enfin, le corps ouvrier n'a pas d'expérience historique de revendications collectivement organisées. Si les relations de travail au sein des modèles productifs de type corporatif et proto-industriel sont souvent dépourvues d'aménité, la concentration industrielle confirme et approfondit la dichotomie entre le patronat et le salariat, ossifie et dramatise leurs rapports respectifs. En somme, la lente prise de conscience de l'inégalité de répartition des fruits du travail industriel est à la base de l'agitation sociale qui secoue le XIXe siècle.
L'analyse détaillée de la lente maturation et la convergence internationale des mouvements ouvriers au long du XIXe siècle dépasserait l'objet de notre propos 400 . Retenons le caractère initialement spontané et sporadique des révoltes ouvrières, dont les crises luddites ne représentent qu'une facette. Les revendications exprimées ou sous-jacentes concernent tant la dureté des conditions de travail que le niveau salarial ou encore la brutale mise à pied d'une partie de la main-d'oeuvre qui condamne celle-ci à l'indigence. La diffusion des idées socialistes assure la fermentation du constat rageur d'impuissance individuelle établi par l'ouvrier face à la puissance patronale.
L'affirmation de la solidarité ouvrière débute en France dès le début du XIXe siècle pour s'affermir dans les années 1830. Le maillage de l'action collective se resserre par la réactivation de multiples réseaux de solidarités d'Ancien Régime, tels les sociétés de compagnonnage, par la création de sociétés secrètes et des premières associations ouvrières. Pourtant interdites par la loi Le Chapelier, des caisses de secours mutuel ou de chômage naissent en s'abritant derrière le paravent public de notables. En plus de leur fonction de protection contre les risques sociaux, ces réseaux de solidarité alimentent souvent la défense politique des intérêts professionnels de leurs membres. Autre indice de la progression d'une conscience de classe, les premières publications ouvrières fleurissent dès 1830 sous la monarchie de Juillet. A l'analyse, le travail y est ressenti tant comme une joie et une fierté au vu du savoir-faire ouvrier et des valeurs morales qui le sous-tendent, que comme une peine physique et une malédiction morale. Ces écrits contribuent à l'émergence de la conscience de l'universalité des destinées dont l'association ouvrière fait son objectif premier 401 .
* * *
Au bilan, l'emprise croissante de l'usine dans le paysage industriel du XIXe siècle reflète la profondeur des mutations sociales des sociétés d'Ancien Régime. La concentration de main-d'oeuvre usinière encourage des migrations sociales qui fragilisent et réduisent l'autonomie matérielle de la cellule familiale. Par le large recours à la mécanisation et à la parcellisation du procès de travail, l'usine impose un contrôle plus strict des hommes. Elle affirme sa dimension institutionnelle par son versant répressif. Elle promulgue sa loi interne sans se préoccuper beaucoup de sa légitimité. Le sombre tableau de la condition ouvrière est éclairé par deux lueurs. L'ouvrier très qualifié échappe à la précarisation de sa situation matérielle et morale. Certains patrons contribuent au recul de la misère ouvrière.
C. La responsabilité sociale de l'entreprise
Au début du XVIIIe siècle, la conception libérale de la pauvreté en fait le produit du vagabondage et de la mendicité, la juste punition de l'oisiveté, de l'intempérance et de la dépravation morale. La condition des miséreux serait donc la juste conséquence de leurs péchés et s'inscrirait dans l'ordre divin des choses 402 . Apparaît dès 1830 le paupérisme, qui affecte durablement une partie des masses laborieuses. Dans les années 1840, les premières enquêtes ouvrières d'envergure confirment que cette nouvelle indigence affecte non seulement les sans-travail, mais aussi les milieux ouvriers 403 . Est ainsi brusquement mis en lumière un paupérisme industriel qui ne doit rien à l'oisiveté, pas plus qu'il ne serait un reliquat des populations flottantes d'Ancien Régime. De son côté, le salariat attribue la précarité de sa situation aux méfaits de l'industrialisation ; il perçoit toujours plus distinctement que son infortune profite au patronat. Moralement ressentie, la pauvreté se mue plus gravement en misère, laissant planer le spectre de troubles sociaux. Face à de telles menaces, les politiques publiques et les initiatives privées démontrent leurs limites 404 .
En France, les insurrections ouvrières se multiplient sous la monarchie de Juillet, malgré l'interdiction des grèves et en dépit de la répression publique. Elles acquièrent au fil du temps un caractère toujours plus offensif, portant sur des hausses des salaires et la réduction du temps de travail. Les élites politiques et économiques flairent le danger révolutionnaire. En Angleterre, la grève générale chartiste de 1842 sonne le tocsin. Si le mouvement perd de sa virulence par la suite, les troubles sociaux et politiques qui secouent la France portent un coup fatal en 1848 à la monarchie de Juillet. Les mouvements ouvriers réclament et obtiennent le droit au travail et le suffrage universel 405 . Le paupérisme comme sous-produit de l'industrialisation demeure cependant au début du second XIXe siècle un problème de société, une question sociale 406 .
1° Le paternalisme précurseur de Robert Owen
La précocité de l'industrialisation anglaise induit celle de ses expérimentations en matière de politique sociale de l'entreprise. Face à la faible fibre sociale des premiers industriels anglais, Robert Owen (1771-1858) représente à la fois le précurseur et l'exception. Ses qualités d'autodidacte et son mariage avec la fille d'un entrepreneur le propulsent en 1797, à l'âge de 28 ans, à la tête d'une grande filature sise à New Lanark en Ecosse. L'établissement occupe en 1816 1'700 ouvriers dont 400 enfants 407 . La manufacture représente pour Owen une sorte de laboratoire social pour valider ses idées philosophiques et entrepreneuriales. Le philosophe entend démontrer que la solution aux problèmes sociaux réside dans l'éducation morale de qualité et dans l'amélioration des conditions matérielles de vie. L'entrepreneur veut convaincre les industriels que l'augmentation de la productivité du travail requiert l'amélioration de la condition ouvrière. En bref, Owen estime que la pauvreté des masses populaires est la cause de tous ses vices et que cette indigence dessert les intérêts patronaux.
Owen améliore la productivité de la filature de New Lanark grâce à des mesures de rationalisation des structures et des procédés. Il se distingue de ses concurrents moins par sa grille salariale que par ses diverses initiatives d'amélioration de la condition ouvrière. Owen réduit l'horaire journalier de travail, améliore les conditions d'hygiène et de sécurité de la filature, assouplit les régimes d'amendes. Il rénove les logements ouvriers, ouvre des magasins d'alimentation et de vêtements. Il lutte activement contre l'alcoolisme, construit une école et y dispense des cours pour adultes. L'amélioration des conditions de travail des enfants attire tout particulièrement son attention. L'expérience est couronnée de succès : Owen réalise de bons profits tout en se gagnant peu à peu les faveurs de ses ouvriers. La réalisation d'une apparente quadrature du cercle lui vaut une notoriété considérable, attirant à New Lanark des visiteurs de toute l'Europe. L'établissement est bientôt pris en modèle, alors que son directeur acquiert une réputation internationale 408 .
Owen nourrit alors des ambitions politiques 409 . Il prône la duplication de son expérience pilote au sein de la société anglaise. Au fait, la filature modèle de New Lanark faillit capoter. Les premiers associés retirent leurs avoirs du capital social de l'entreprise 410 , en désaccord avec Owen sur la primauté qu'il accorde à l'éducation ouvrière vis-à-vis du profit. La troisième génération d'investisseurs, comprenant outre le philosophe Jeremy Bentham un ardent quaker et un anglican, désapprouve le contenu strictement laïque des programmes éducatifs de New Lanark. Owen quitte en 1824 ses fonctions directoriales pour se consacrer aux affaires sociales publiques 411 . En fait, le modèle de New Lanark est plus admiré que copié. L'extension du modèle d'Owen reste problématique à l'époque, car beaucoup d'entrepreneurs aux commandes d'une grande manufacture dépendent partiellement de capitaux externes. L'expérience de New Lanark démontre en effet l'influence de l'investisseur sur la définition de la responsabilité de l'entreprise. D'autres applications des idées d'Owen verront néanmoins le jour, sans prendre une ampleur considérable 412 .
On peut gloser à l'envi sur le caractère utopique des idées d'Owen, sur son incapacité à saisir le faible intérêt des élites économiques à oeuvrer en faveur de l'élévation matérielle et morale des masses ouvrières. L'histoire de la filature de New Lanark préfigure certaines tensions sociales qui tiraillent l'entreprise contemporaine. Elle illustre au début du XIXe siècle la difficile conciliation de l'intérêt personnel de l'investisseur avec le bien commun, ainsi que les possibles conflits de pouvoir entre l'investisseur et le manager. Owen pressent le caractère fondamental des bouleversements sociaux induits par l'industrialisation dont le paupérisme ouvrier n'est que le versant économique. La portée humaine et sociale du travail en manufacture outrepasse en effet la seule exploitation économique de l'ouvrier, pour affecter la définition même des compétences professionnelles et le prestige social de l'ouvrier. Dans les mots de Karl Polanyi, " [Owen] saisit que ce qui apparaît d'abord comme un problème économique est essentiellement un problème social 413 . "
2° Le patronage de Frédéric Le Play
En France, les premières réponses à la question ouvrière sont plutôt idéologiques. Elles sont présentées dès les années 1820 par les précurseurs du socialisme du second XIXe siècle. Henri de Saint-Simon (1760-1825) pressent l'avènement de la société industrielle et confie à l'entrepreneur l'édification d'un socialisme à caractère technocratique qui transcenderait la dialectique de classes 414 . A l'acte de foi saint-simonien, Charles Fourier (1772-1837) préfère l'idée du phalanstère qui permettrait une vie libertaire et harmonieuse au sein d'une communauté restreinte 415 . Pierre Proudhon (1809-1865) prône la collectivisation de la propriété par la constitution de fédérations agricoles et industrielles dont les principes d'égalité, de liberté et de responsabilité émanciperaient l'ouvrier 416 . Ces doux socialismes utopiques n'amendent guère la tonalité libérale de l'époque, d'autant plus qu'ils n'offrent pas de solution concrète à la question ouvrière.
La chute de la monarchie de Juillet en 1848 occasionne un branle-bas parmi les élites politiques et économiques françaises. Face à l'urgence, libéraux et socialistes se déchirent sur la formulation de politiques publiques, alors que la philanthropie et la charité privée paraissent bien impuissantes. Les cercles politiques se convainquent alors de la nécessité d'améliorer la condition ouvrière pour maintenir l'ordre public et enjoignent les milieux économiques à oeuvrer en ce sens. Le patronat y consent à contrecoeur, de peur d'une réglementation sociale contraignante 417 . Il appose cependant aux difficultés matérielles des milieux ouvriers deux autres préoccupations plus spécifiques. Il déplore la moralité douteuse de l'ouvrier qui ruine d'autant sa capacité d'épargne. Il dénonce la circulation sous le manteau de pamphlets socialistes qui attisent le ressentiment ouvrier dans la promiscuité usinière 418 .
" La guérison du paupérisme viendra de deux remèdes principaux : de la prévoyance et des autres forces morales qui multiplient la propriété individuelle et la famille souche ; du patronage volontaire exercé au profit des classes imprévoyantes 419 . " L'auteur de cette réflexion, Frédéric Le Play 420 (1806-1882), renvoie dos à dos libéraux et socialistes, les premiers pour l'insuffisance et l'inadéquation des solutions au paupérisme qu'ils préconisent par la charité ou le progrès technique, les seconds pour le caractère utopique des régimes à communauté de biens qu'ils imaginent. Il préconise la décentralisation de la puissance publique qui permet la valorisation de la propriété, de l'entreprise et de la famille. Il recommande la refonte du rapport salarial au travers du régime de patronage. Celui-ci se définit comme " un lien volontaire d'intérêt et d'affection " destiné à remplacer les liens forcés d'Ancien Régime. L'ouvrier adhère de façon volontaire et permanente à l'entreprise et à son ordre. Fort de nouvelles responsabilités, le patron a charge d'âme et de corps 421 .
Ainsi posée, la solution au paupérisme ouvrier passe notamment par l'acquisition par l'ouvrier de son logement pour en faire un véritable foyer familial. L'érection en milieu rural de l'usine et de logements attenants permet la préservation du contact de l'ouvrier avec son environnement naturel. L'éducation morale est assurée symboliquement par la valeur d'exemple du comportement patronal, et concrètement par des enseignements de culture générale et technique ainsi que par la modification des habitudes de récréation 422 . En bref, le patronage vise par l'amélioration des conditions matérielles et morales de l'ouvrier sa fidélisation et l'apaisement de ses revendications, ainsi que l'amélioration qualitative et quantitative de son travail par une meilleure maîtrise technique. Empreint d'humanité, le rapport salarial n'en demeure pas moins fondamentalement hiérarchique et asymétrique.
Le rayonnement des idées leplaysiennes est considérable parmi le patronat français et européen du second XIXe siècle, préoccupé qu'il est par le recrutement, la fixation, la formation et l'encadrement d'une main-d'oeuvre trop rare 423 . La question du logement est particulièrement centrale dans la condition ouvrière de l'époque. Son insalubrité est notoire, sa précarité synonyme de promiscuité et de moeurs dissolues ; sa piètre qualité peuple les cabarets et encourage la mobilité de la main-d'oeuvre. Autour des forges implantées dès le XVIIIe siècle dans les campagnes, le logis de l'ouvrier permanent tient du taudis. Les premières cités ouvrières bâties dès les années 1830 en France par les sociétés minières, houillères et textiles, sont des baraquements au régime casernier. Apparaît alors le logement ouvrier de dimension plus réduite. Celui-ci respecte mieux une certaine autonomie propice à l'éducation morale et à l'équilibre psychologique de la famille ouvrière. Un jardinet jouxtant la maisonnette procure à la famille un revenu d'appoint et une occupation de loisirs. Il préserve en outre à l'ouvrier de souche paysanne le précieux contact avec son milieu naturel.
La construction de logis ouvriers tout comme l'encouragement à leur acquisition par l'épargne et le crédit rencontrent dans un premier temps un succès mitigé. Le nombre de ces logements est faible par rapport aux effectifs ouvriers. Ensuite, la capacité réelle d'épargne ouvrière est bien maigre, sinon insignifiante 424 . Plus fondamentalement, l'ouvrier redoute la superposition de la relation hiérarchique de l'employé face à son employeur, du lien asymétrique qui relie le locataire au propriétaire, et de la dépendance du débiteur vis-à-vis de son créancier 425 . Le logement ouvrier s'interprète parfois comme le prélude à une mainmise patronale sur la vie non professionnelle du salarié. Caisse de prévoyance, de secours et de retraite, magasin de vivres ou économats, primes de fidélité en nature ou en espèces, école d'usine, éducation religieuse, associations diverses sont diverses modalités du patronage qui se greffent sur le logement ouvrier au service d'un même objectif de contrôle total du milieu ouvrier 426 . L'ouvroir ou la manufacture internat représente l'archétype de cette stratégie patronale 427 . En dépit de telles limitations et réticences, la cité ouvrière peuple peu à peu les abords de la grande manufacture et de l'usine. Le patronage tire habilement parti de la communauté d'intérêts liant le patronat au salariat, soit l'amélioration des conditions matérielles et morales de la vie ouvrière 428 .
Sous le Second Empire français, le régime du patronage se développe tout particulièrement en Alsace et en Lorraine. Largement basé sur des convictions morales et religieuses, l'engagement social du patronat textile alsacien s'esquisse dès 1820 pour s'affirmer après les événements révolutionnaires de 1848. La Société industrielle de Mulhouse joue un rôle capital. Sorte de forum qui réunit le patronat régional, ses débats et ses réalisations en matière sociale portent en priorité sur le fonctionnement interne de l'entreprise, par l'examen de mesures de prévention des accidents, de limitation de la durée du travail, et de réglementation du travail des enfants, la création de caisses de secours, de crédit et de retraite, la mise sur pied d'une couverture sociale pour l'ouvrier et sa famille. En externe de l'entreprise, l'engagement social du patronat prend la forme de la création de salles d'asile (maternelles), de soutien aux politiques publiques en matière de logement et de scolarisation 429 .
La sidérurgie lorraine exemplifie un autre fondement du patronage. Au milieu du XIXe siècle, la main-d'oeuvre qualifiée est encore trop rare et chère aux yeux de l'industriel. Seules des conditions de travail convenables et complétées par des prestations sociales annexes telles que le logement, attirent durablement les meilleurs ouvriers. Par ailleurs, les contraintes en matières premières -- eau, charbon, bois -- sont fortes pour le maître de forges qui caresse un projet industriel d'envergure. Aussi l'implantation du complexe productif est-elle souvent réalisée en milieu rural, en dépit de l'insuffisance des voies de communication et de l'infrastructure. La réalisation d'une voie de chemin de fer et l'érection progressive ou rapide d'une cité ouvrière représentent d'incontournables corollaires à la construction de l'usine sidérurgique. L'empreinte du projet entrepreneurial sur la géographie physique et humaine est alors marquée et indélébile 430 . La cité-usine est néanmoins d'un aspect souvent chaotique. Le régime de patronage renforce concrètement et symboliquement l'omniprésence et la toute-puissance de l'entrepreneur 431 . Il tente d'insuffler à la vie usinière un esprit familial par la ritualisation de pratiques sociales telles que la présence ouvrière au mariage ou à l'enterrement des administrateurs. Les pratiques religieuses sont stimulées, car elles " fortifient l'homme dans ses liens sociaux, le rendent plus dévoué à ses tâches vitales, familiales ou sociales 432 . "
Les usines Schneider du Creusot représentent probablement l'exemple le plus accompli et le mieux connu en matière de patronage dans le secteur métallurgique. Fort de 6'500 à 9'000 ouvriers, le complexe constitue au milieu du XIXe siècle la plus grosse concentration industrielle d'Europe 433 . Influencé par les idées saint-simoniennes, Adolphe Schneider initie dès les années 1830 une politique sociale de grande ampleur avec un double objectif : combattre les méfaits des cabarets, vaincre l'ignorance. Grâce aux largesses des Schneider sont bâtis une école, une église puis un bureau de poste. En 1840, Adolphe est élu maire du Creusot, avant de disparaître prématurément. Aux rênes de l'empire industriel, son frère Eugène Schneider finance au Creusot la construction de routes, d'un cimetière, de la mairie, puis une nouvelle église. Il développe la politique sociale de l'entreprise dans les domaines de l'enseignement, de la santé et du logement. A leur ouverture en 1837, les écoles accueillent d'abord des effectifs modestes puis jusqu'à 2'200 élèves en 1873. Un hôpital et une pharmacie délivrant gratuitement ses médicaments aux ouvriers sont construits en 1863. Les cités ouvrières se multiplient autour de l'usine sous la forme de maisonnettes basses, flanquées d'un jardinet. Leur confort est à l'image des qualifications professionnelles et sociales des occupants. En 1867 est mise en service une usine à gaz pour l'éclairage de l'usine et de la ville, avant la fondation d'une caisse de prévoyance et d'une maison de retraite. Un atelier de dentelle réunit les épouses des ouvriers. Un hippodrome et de nombreux cercles de loisirs stimulent la vie associative. Les activités sont variées : escrime, gymnastique, canotage, billard, jardinage floral 434 .
La ville-usine du Creusot est une petite république. Un règlement tracassier discipline le comportement ouvrier. Même l'entretien des maisons est réglementé et contrôlé. Mouchards, contrôleurs et amendes entretiennent une certaine tension sociale. Au travail, des primes stimulent la qualité de l'ouvrage et la productivité. La journée de labeur est limitée en 1871 à dix heures. N'est embauché que l'ouvrier âgé de plus de 14 ans, sachant lire et écrire. A bien des égards, l'usine domine la ville. Les citoyens et édiles locaux ne semblent pas s'en émouvoir. Eugène Schneider succède à son frère Adolphe à la mairie du Creusot. Il s'oppose en 1856 à la transmission à Napoléon III d'une pétition populaire demandant de rebaptiser le Creusot en Schneiderville. Ses oeuvres sociales sont primées lors de l'Exposition universelle de 1867, organisée par Le Play.
Principaux concurrents des Schneider dans la région lorraine, les Wendel instaurent également un régime de patronage dans leurs établissements. Les prestations sociales concernent des caisses de retraite et d'assistance pour les malades et les blessés, un système d'assurances pour les familles de victimes d'accidents du travail, la gratuité des soins médicaux et des médicaments. En outre, chaque ouvrier a droit à présenter personnellement ses doléances au patron. La force de ce code relationnel réside dans la transparence de ses règles et l'universalité de son application. En dépit de ses pouvoirs, même le patron y est soumis. Tout manquement à ce code de sa part serait rapidement connu et commenté dans l'entreprise 435 .
Le patronage ne constitue pas l'apanage du secteur sidérurgique. Ce régime solutionne au moins partiellement pour toute entreprise de grande taille la fixation d'une main-d'oeuvre rompue aux arcanes de complexes procès de fabrication. Sous le Second Empire, il connaît les faveurs de nombre d'industriels français. La glacerie de Saint-Gobain construit ainsi à Chauny dans l'Aisne des logements ouvriers dans les années 1830 déjà. Elle développe sous le Second Empire son régime de patronage dans des modalités analogues 436 . L'éducation de la main-d'oeuvre est particulièrement soignée. La formation technique des meilleurs ouvriers est assurée par des cours théoriques. L'éducation morale et la responsabilisation ouvrières s'effectue notamment par des coopératives -- unités autogérées d'approvisionnement et de consommation de denrées. Fait original, la compagnie de Saint-Gobain implante une glacerie au coeur du Zollverein, à Mannheim-Waldhof dans le Grand Duché de Bade. La firme dispose ainsi de nouveaux débouchés hors du marché français saturé en se jouant des barrières douanières érigées par l'union douanière allemande. Une cité-usine est construite ex nihilo en 1854. Son plan est conçu à la fois dans le respect des soucis fonctionnels liés à la fabrication -- rapidité d'accès aux fours, secret des procédés de fabrication -- et dans le souci de stimuler une sociabilité de voisinage. Clôturée d'une enceinte aux portes gardées, la ville-usine tient de l'enclave et de la forteresse. Ses trois cents ouvriers sont essentiellement français, tout comme le maître d'école et le prêtre. Elle comprend en outre une salle de gymnastique, une boulangerie, un économat. La cité édicte ses propres règles et sanctions, rythme l'écoulement du temps par un calendrier férié calqué sur celui de la mère patrie 437 . Le paternalisme se développe en d'autres lieux d'Allemagne comme à Essen -- fief sidérurgique de la famille Krupp 438 .
 Encadré 4 : Le patronage en Lorraine au milieu du XIXe siècle
Encadré 4 : Le patronage en Lorraine au milieu du XIXe siècle
Le second XIXe siècle français donne le jour à un projet plus anecdotique qui mâtine le régime de patronage de l'utopisme des premiers socialistes. S'inspirant partiellement de l'idée du phalanstère que Charles Fourier n'avait pu concrétiser avant son décès, l'industriel Jean Godin (1817-1888) fonde en 1859 à Guise dans l'Aisne un familistère. Il y améliore la sécurité et l'hygiène au travail, entreprend la construction de logements ouvriers. Le familistère du fabricant de poêles dispose de lavoirs, jardins et piscines. On y dispense aux enfants une scolarité gratuite, laïque, mixte et obligatoire, et ce bien avant la loi républicaine de Jules Ferry de 1882. Godin ne s'en tient pas là. Il expérimente une comptabilité sociale. Anticipant la gestion par les cercles de qualité, il constitue parmi sa main-d'oeuvre des groupes de volontaires pour étudier l'amélioration du procès productif 439 . Il tente enfin une expérience de démocratie industrielle par l'élection d'ouvriers appelés à répartir les primes de travail. Poursuivant son idéal autogestionnaire, il fonde en 1880 l'Association capital-travail qui fait virtuellement du travailleur le propriétaire de l'usine. Les critiques ne manquent pas. Emile Zola dénonce par exemple la discipline austère de l'établissement, alors qu'une fraction de la main-d'oeuvre refuse la répartition de bénéfices sous la forme de titres financiers. Godin énonce cependant une idée force : " Si j'ai assuré la fortune de mon établissement, c'est parce que j'ai toujours eu une invention d'avance sur les concurrents 440 . " Il démontre que l'innovation, même conçue hors de la sphère technique, profite simultanément à l'entrepreneur et à la société.
Les mouvements de grève qui resurgissent avec force dès la fin du Second Empire constituent une épreuve de vérité pour le régime de patronage, censé prévenir justement de tels troubles. Ceux-ci n'épargnent pas en 1869 les aciéries du Creusot. Le bras de fer a pour origine et pour enjeu la participation ouvrière à la gestion de la caisse de secours. De peur que celle-ci ne finance les mouvements de grève, Eugène Schneider se raidit dans son refus, puis tente son va-tout par un plébiscite. La consultation ouvrière lui vaut un camouflet public, son refus d'obtempérer l'éclatement des grèves. Le maître du Creusot supprime alors rapidement la caisse de secours au profit d'un système d'allocations familiales et de caisse de retraite 441 . L'épisode témoigne de la fragilité des réalisations sociales du patronat, ainsi que de leur nécessaire et constante adaptation aux attentes sociales. La maturation de la classe ouvrière suppose également sa plus grande responsabilisation. Le patronage du second XIXe siècle n'en est pas moins une réponse globale à la complexité des conséquences sociales de l'industrialisation.
* * *
Au bilan, le régime de patronage préconisé par Le Play se rattache aux diverses moutures du paternalisme, dont l'origine lointaine remonte à la Fuggerei d'Augsbourg au XVIe siècle. Le patronage s'inspire de façon plus immédiate et vraisemblable des idées d'Owen au début du XIXe siècle. Il se prolonge aux Etats-Unis dans le welfare capitalism américain qui se développe plus tardivement 442 . Au-delà de ses variantes, le paternalisme désigne un ensemble de pratiques patronales de nature discrétionnaire 443 destinées à fidéliser la main-d'oeuvre et à prévenir l'agitation ouvrière par le renforcement de l'encadrement du travail ainsi que par l'élévation de la condition matérielle et morale de l'ouvrier et de sa famille. En France, le patronage évolue dans le dernier quart du XIXe siècle vers l'autonomie et la responsabilisation accrues de l'ouvrier. Son essor bénéficie de la conjoncture économique favorable que connaît le Second Empire.
Dans le vocabulaire leplaysien, le patronage fait de l'entreprise une institution responsable, de l'entrepreneur une autorité sociale 444 . Ce régime formule une réponse du type entrepreneurial 445 à la détresse économique, sociale et morale des milieux ouvriers. Le patronage exploite habilement la communauté d'intérêts entre patronat et salariat. Il ancre la vie économique dans des valeurs morales. Pour l'industriel, le patronage assure une main-d'oeuvre stable, qualifiée, employée au mieux de ses compétences et de sa capacité de travail. Pour sa part, l'ouvrier bénéficie d'un réel mieux-être matériel et moral. De surcroît, le patronage augmente la mobilité sociale intergénérationnelle -- le grand-père entre à l'usine comme ouvrier, son fils devient employé et son petit-fils ingénieur. Il enrichit le climat de travail de liens interpersonnels tissés par les relations de voisinage ou la vie associative locale. En même temps persiste et se fige une hiérarchie statutaire entre l'ouvrier, l'employé et l'ingénieur, perceptible dans la grille salariale et le logement. La concomitance de ces deux phénomènes, l'un dynamique et l'autre statique, stabilise le salariat et sape la formulation de revendications collectives 446 . Même si cet objectif figure au registre de l'implicite, le patronage vise aussi à l'isolement de la main-d'oeuvre du reste du corps social. En cela, il contribue à retarder la cristallisation de la conscience de classe ouvrière. Cet effet reste limité, car le patronage concerne somme toute une frange étroite du monde ouvrier.
Louis Reybaud définit les oeuvres sociales du patronage comme " les institutions qui entretiennent l'empire des bonnes habitudes 447 . " Faut-il en déduire le caractère résolument conservateur, sinon réactionnaire du régime de patronage ? Ce serait mal interpréter le rôle des traditions. Le patronage n'est guère une réaction anachronique basée sur des valeurs d'Ancien Régime. Il facilite plutôt la difficile adaptation sociale aux réalités industrielles par l'affermissement des ancrages sociaux et religieux traditionnels. Le patronage transpose les principes d'autorité et de sollicitude du père de famille dans le monde du travail : le patron est un "père" exigeant, mais bienveillant envers l'ouvrier. Celui-ci lui manifeste sa gratitude par la droiture de leur conduite, son application au travail et sa fidélité à l'entreprise. Le patronage exprime moins un conservatisme social figé que le sens bien compris du développement social basé sur des valeurs traditionnelles, progrès auquel l'entrepreneur entend contribuer 448 .
L'entrepreneur d'Alsace-Lorraine ne se contente généralement pas d'initiatives sociales emblématiques qui ont valeur d'engagement politique indirect. Il partage ses idées et ses expériences avec ses pairs au sein d'associations patronales telles que la Société industrielle de Mulhouse. A l'instar d'Adolphe, puis d'Eugène Schneider 449 , l'industriel n'hésite pas à engager sa notoriété publique en embrassant une carrière politique qui lui permette de promouvoir directement ses idées. Entrepreneur, il se fait également bâtisseur d'infrastructures diverses, urbaniste, hygiéniste, juriste, concepteur de programmes de scolarisation et de formation professionnelle. Son engagement politique qui s'exprime au travers d'obédiences diverses répond avant tout à ses convictions personnelles, sans exclure toutefois une action collective patronale. Eclairé par une formation de qualité, de solides valeurs morales et religieuses et mû par une vigoureuse curiosité intellectuelle, l'entrepreneur huguenot use du puissant pouvoir de transformation sociale de l'activité industrielle pour oeuvrer en faveur du développement économique et social.
L'engagement politique direct et indirect de l'industriel du second XIXe siècle est lourd des mêmes ambiguïtés qui entachent la citoyenneté de l'entreprise. Homme politique, l'entrepreneur défend-il l'intérêt public, celui de son secteur d'activité ou encore son intérêt propre ? Au niveau local, ses initiatives sociales privées complètent-elles ou empiètent-elles sur les décisions et les réalisations publiques ? Il n'est pas de réponse péremptoire à ces difficiles questions. L'implication politique directe de l'entrepreneur peut aboutir à la mainmise de l'entreprise sur son environnement sociopolitique. La haute visibilité liée à un tel engagement politique incite aussi l'entrepreneur à assumer ses responsabilités. Quoi qu'il en soit, l'engagement politique direct de l'industriel est fort répandu à l'époque. Aux yeux des élites, les impératifs de l'industrialisation renforcent la complicité des objectifs privés et publics, économiques et politiques. Le corps des citoyens accepte mieux les réalités industrielles lorsqu'elles s'accompagnent de mesures sociales. Le patronage pallie en cela partiellement les carences des politiques publiques en matière d'infrastructure sanitaire et de transport, de scolarisation et de formation professionnelle, de droit et de médecine du travail. Il suggère également la voie de leur développement ultérieur.
Un tel développement législatif n'intervient pas sans peine. Une large majorité d'industriels y reste hostile, en dépit des réalisations de l'avant-garde huguenote. Votée en 1841 à l'instigation des industriels d'Alsace-Lorraine, la loi sur le travail des enfants connaît une application très inégale dans le reste de la France. L'élaboration et l'application subséquentes du droit français du travail s'inspire souvent de la législation anglaise 450 . La dynamique est obérée par des manoeuvres similaires de freinage ou d'opposition de la part d'une importante fraction du patronat. Celui-ci accepte à contrecoeur les développements législatifs, de peur de dispositions plus contraignantes ou de troubles sociaux. Le régime du patronage prôné par Le Play et Cheysson peine à s'imposer auprès des industriels de l'époque. Lorsqu'il consent à assumer une gouverne sociale sur sa main-d'oeuvre, l'industriel ne souffre d'aucune contestation. Le "père" n'hésite pas à réprimer sévèrement la grève, vécue comme un aveu d'ingratitude de la part de ses ouailles.
5. De la deuxième industrialisation à nos jours
La deuxième industrialisation intervient durant le dernier quart du XIXe siècle grâce aux applications industrielles de l'électricité et de la chimie, grâce encore à l'invention du moteur à combustion. Elle s'effectue dans un esprit plus acquis à la complexité des réalités et des idées. Au tournant du siècle, Albert Einstein suggère une cosmogonie moins mécaniciste et plus complexe que les vues coperniciennes et newtonienne. Sigmund Freud bat en brèche la conception rousseauiste de la rationalité humaine en pointant l'importance de l'instinct et de l'irrationnel dans la motivation comportementale. Le XXe siècle témoigne d'une attitude résolument optimiste envers la technologie, faisant notamment de l'électricité une force libératrice pour l'humanité 451 . La transmission du progrès scientifique sur l'évolution technique est plus rapide et plus féconde.
L'industrie automobile synthétise les découvertes techniques de la deuxième industrialisation. La Belle Epoque fait bonne place aux pionniers de l'automobile et de l'aviation. Leurs réalisations aussi audacieuses que rudimentaires témoignent d'un esprit aventurier et créateur très «début de siècle». La deuxième industrialisation est quasiment concomitante avec une vague de concentration industrielle aux Etats-Unis. Cette dernière doit beaucoup au marasme économique de la Grande Dépression qui, de 1882 à 1896, aiguise la concurrence sur les marchés américains. L'entreprise réinvente ou perfectionne alors ses techniques productives 452 . La deuxième industrialisation se caractérise par la grande simultanéité de son occurrence parmi les sociétés européennes. Par rapport à la précédente, ses effets sont plus homogènes dans une comparaison internationale. Elle pénètre plus largement et profondément les tissus socio-économiques et les pratiques sociales au cours du XXe siècle.
L'ère est à la production et à la consommation de masse. L'organisation tayloriste puis fordiste du travail instaurent des cadences productives élevées, une monotonie et un surmenage au travail que Charlie Chaplin tourne en dérision dans Les Temps modernes. Même mieux rémunéré, l'ouvrier ne répond guère positivement à sa déqualification et à la tristesse foncière du milieu usinier. Afin de fidéliser sa main-d'oeuvre et de justifier ses méthodes comme son pouvoir, la grande entreprise modernise le régime de patronage en responsabilisant quelque peu l'ouvrier. Ce paternalisme décline dès 1920, relayé par divers régimes publics d'assurances sociales élaborés dès la fin du XIXe siècle pour calmer l'agitation ouvrière. « Classes laborieuses, classes dangereuses 453 . »
La Crise économique de 1929 représente une césure importante. L'entreprise fait aveu d'échec dans son ambition d'autorégulation technocratique et de leadership sociétal par les projets tayloriste et surtout fordiste. L'entreprise se cantonne désormais dans ses tâches productives. La puissance publique, déjà échaudée aux Etats-Unis depuis la fin du XIXe siècle par la boulimie de certains trusts, prend les rênes de la vie économique et sociale. Elle maintient et renforce sa gouverne après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle vague de progrès technique dans les domaines de la pétrochimie, de l'électronique et de l'aéronautique initie une croissance économique et un progrès social exceptionnels que l'Etat keynésien et providence se charge d'entretenir pendant trois décennies. La période faste ne désavoue guère l'organisation tayloriste et fordiste du travail.
Les deux chocs pétroliers de 1971 et 1973 marquent une nouvelle rupture historique. Ils mettent un terme à l'opulence d'après-guerre, dissocient l'occurrence du progrès économique et social. L'Etat-providence réduit ses prodigalités. Dans le monde anglo-saxon, l'Etat redonne à l'entreprise une liberté qu'elle ne se fait faute d'exploiter. La période atteste d'une troisième accélération du progrès technique, particulièrement dans les domaines de l'information, de la communication et des biotechnologies. La rapidité de diffusion de l'innovation est sans précédent. L'évolution technique accentue la tertiarisation de l'économie, accélère formidablement la mondialisation des marchés de biens et services, accouche d'une « nouvelle » économie. L'entreprise transnationale fait l'objet d'une attention critique accrue. Ses pratiques sociales sont ambivalentes. Elle réduit considérablement sa contribution à l'emploi, affirme valoriser le potentiel créatif et émotionnel de sa main-d'oeuvre tout en exigeant d'elle une flexibilité et une rentabilité accrues. L'entreprise répond parfois aux critiques sociales par l'affirmation de sa citoyenneté.
L'affirmation citoyenne de l'entreprise coïncide avec l'émergence de la nouvelle économie. Toute économie nouvelle repose sur trois éléments fondateurs, une matière première, une source d'énergie et un moyen de transport 454 . La première industrialisation use de la coke et de la fonte pour matières premières, de la vapeur comme source d'énergie et repose sur l'essor du commerce international et la construction des chemins de fer. La seconde industrialisation découvre les produits chimiques et les colorants, supplante la vapeur par l'électricité et le pétrole et invente le transport automobile. La nouvelle économie adopte pour matière première l'information numérisée grâce à l'électronique des semi-conducteurs et transportée grâce aux réseaux numériques du type Internet. Les trois accélérations du progrès technique rénovent en outre le rapport de l'homme à la machine. La première industrialisation multiplie la force musculaire grâce à la machine. La deuxième substitue partiellement le travail physique, que la nouvelle économie supplante par la redéfinition de la nature du travail.
Moins encore que les industrialisations des XVIIIe et XIXe siècles, la nouvelle économie ne supplante pas les structures économiques existantes. Elle les complètent et les pénètre. Elle n'affecte qu'une partie de la vie économique et de la population active mondiale. En revanche, sa rapidité de diffusion est inouïe. A de maints égards, la nouvelle économie s'intègre à l'économie traditionnelle, laquelle accélère sa propre évolution. L'avenir est à des partenariats triangulaires entre l'entreprise, ses partenaires d'affaires et sa clientèle. De technique, l'innovation devient organisationnelle et sociale. Pour l'heure, l'impact socio-économique des nouvelles technologies paraît moindre que les innovations techniques de la deuxième industrialisation. L'électricité ou le moteur à combustion ont en effet donné naissance à de nouveaux produits finaux de masse, alors que l'Internet facilite et réduit les délais de production et de vente des produits existants 455 . Dans le temps long en revanche, le remodelage social induit par les technologies de l'information semble considérable. La formidable intensification des échanges immatériels modifie la vie économique et son cadre politique, les paramètres écologiques, les valeurs socioculturelles et les attitudes individuelles 456 . La numérisation de l'information, sa rapidité et son fiable coût de diffusion marquent un point d'inflexion dans la vie sociale. La nouvelle économie redéfinit le développement des sociétés en termes d'accès à l'information. La maîtrise des nouvelles technologies devient la condition sine qua non du développement personnel et collectif.
A. L'organisation technique du travail
Le tournant du siècle marque l'affirmation de la grande industrie. Aux Etats-Unis d'abord et surtout, la tendance est à la formation d'oligopoles. La stratégie est assez nouvelle. Avant la Grande Dépression du XIXe siècle, la production de qualité est considérée comme la meilleure stratégie face à un marché perçu comme restreint et rigide. Par la suite, la grande entreprise fait preuve de davantage d'audace pour défendre, organiser et augmenter sa présence sur le marché. La grande entreprise tente de contrôler le fonctionnement du marché, soit directement par la constitution d'ententes ou de cartels, soit indirectement par lobbying politique 457 . Dès les années trente, la puissance publique régule plus fermement les marchés dans un paradigme de production standardisée et de consommation de masse.
Le dernier quart du XXe siècle témoigne de plusieurs glissements d'importance pour l'organisation technique du travail. La consommation devient plus individualisée, plus prudente et réfléchie, d'où une production plus diversifiée qui valorise en principe la composante humaine de l'entreprise. L'évolution technologique s'accélère, ce qui place l'entreprise face à l'exigence renforcée d'innovation constante. Les NTIC font éclater l'organigramme des sociétés, tendance renforcée par l'essor de tous types de relations souples d'affaires. Enfin le potentiel créatif et le bagage émotionnel de l'employé sont mieux reconnus aux côtés de l'expérience professionnelle, du moins dans l'idéologie managériale 458 . En conséquence la grande entreprise traque les synergies dégagées par les alliances stratégiques et autres fusions-acquisitions. Sa relation avec son milieu opérationnel conjugue discontinuité et permanence, diversité et globalité. Le management comporte désormais quatre dimensions essentielles : motiver, innover, maîtriser, flexibiliser 459 . Motiver une main-d'oeuvre pluriculturelle ; innover en interne, par acquisition ou contrat externe ; maîtriser les coûts ; flexibiliser les structures organisationnelles par leur aplatissement et leur assouplissement.
1° La grande entreprise moderne
La période 1860-1940 marque la tendance nette à la constitution de grandes unités productives 460 . L'entreprise transnationale moderne synthétise la complexification historique de l'organisation sociotechnique de la production. La logique d'économies d'échelle condamnerait-elle à l'aube du XXe siècle l'atelier, en raison de son niveau technique plutôt rudimentaire et de sa forte dispersion géographique ? La réponse est nuancée. Certes, la Grande Dépression met à mal les dernières formes d'activité proto-industrielle -- travail domestique et artisanat rural. L'atelier souffre davantage en milieu rural, où sa grande dispersion géographique le handicape sévèrement. Plus concentré, l'atelier urbain résiste mieux. Sa compétitivité s'améliore grâce à l'introduction de petites machines, dont l'usage est rendu possible par l'électrification des villes. Jouant sur la flexibilité de son organisation et sur la polyvalence de sa main-d'oeuvre, l'atelier bénéficie plutôt qu'il ne souffre du voisinage de l'usine, dont il obtient des commandes en sous-traitance. Quant au travail à domicile, il connaît au début du siècle une nouvelle vigueur grâce à la diffusion commerciale de la machine à coudre et à l'essor des grands commerces. En tout état de cause est révolue la complicité d'Ancien Régime entre villes et campagnes, entre industrie et agriculture. Copinant l'usine et la ville, la production standardisée et la consommation de masse de biens manufacturés s'affirment définitivement à l'aube de la Première Guerre mondiale en tant que modalités premières de l'activité industrielle 461 .
La concentration industrielle et la production de masse sont perceptibles aux Etats-Unis dès la fin de la Guerre de Sécession en 1865. Une telle précocité tient aussi bien au vigoureux développement des moyens de transport qu'à la taille et à l'homogénéité du marché américain. La dynamique progresse comporte des phase d'accélération (1887-1904, 1916-1929, 1950-1970, 1980-2000). En Allemagne et ailleurs en Europe, la concentration industrielle intervient plus tardivement, au début du XXe siècle. L'exemple américain amplifie également les tendances industrielles du siècle, à savoir l'élargissement considérable de l'échelle de la production et de la distribution de biens de consommation courante 462 . Le produit de masse comporte deux attributs fondamentaux, soit des caractéristiques fonctionnelles standardisées et un prix peu élevé. Il requiert une unité productive plus vaste et plus complexe, de nouveaux principes organisationnels articulés autour de la production en série et du travail à la chaîne. L'industrie manufacturière réalise au début du XXe siècle la quintessence de cette redéfinition scientifique, technique et sociale du travail 463 .
L'internationalisation de la production croît au long du second XIXe siècle. Les investissements directs étrangers atteignent en valeur agrégée et cumulée quatorze milliards de dollars en 1914. En Europe, la dynamique est brutalement stoppée par la Grande Guerre. Grâce à son implantation sur les marchés étrangers, la firme américaine mature ses structures et son management. Elle ressemblerait alors davantage à la société transnationale des années 1970 qu'à la grande entreprise de 1850, voire même de 1870 464 . Quoi qu'il en soit, l'affirmation au début du XXe siècle de la grande entreprise transnationale enrichit la diversité morphologique des acteurs économiques, diversité qui reflète déjà grosso modo celle du tissu industriel contemporain 465 .
Qu'est-ce au juste qu'une grande entreprise moderne ? Sa définition tient de la bouteille à encre. Son caractère inter- ou multinational n'est aucunement spécifique des temps contemporains, puisqu'il apparaît dans le second XIXe siècle. Alfred Chandler propose trois éléments distinctifs : sa nature managériale, le caractère multidivisionnel de son organigramme et son importante bureaucratie 466 . Selon l'historien américain, l'entreprise managériale dissocie les fonctions de propriété et de direction, et donc le propriétaire et l'investisseur d'une part, le gestionnaire professionnel ou le manager d'autre part. Deuxièmement, la grande entreprise contemporaine présente une structure organisationnelle complexe qui distingue les fonctions de planification, de décision, d'exécution et de contrôle. Assistée d'un service juridique, la direction opérationnelle chapeaute usuellement les divisions de la production, des ressources humaines, des questions commerciales et financières. Troisièmement, la complexification de l'organigramme fonctionnel de l'entreprise implique le renforcement de son appareil bureaucratique. La minutie de la définition des procédures, la division et la hiérarchisation accrues des tâches requièrent l'embauche de nombreux cadres administratifs. Muni de ces trois critères, Chandler estime que la grande majorité des grandes entreprises américaines présentent en 1917 une structure organisationnelle de type managérial. Subsistent çà et là quelques reliquats du capitalisme familial et financier 467 . Il suggère ainsi à cette époque une transition rapide entre un capitalisme familial vieillissant et un capitalisme managérial porteur de toutes les promesses pour le XXe siècle.
Chandler force le trait en reléguant trop hâtivement aux oubliettes de l'histoire la grande entreprise en mains familiales. Aucun des trois critères identifiés par l'historien ne saurait définir à lui tout seul la grande entreprise moderne. Si le capitalisme managérial caractérise le marché américain des années vingt ou trente, il cohabite pour longtemps encore avec sa variante familiale. Un grand nombre de firmes, et pas seulement les plus petites d'entre elles, demeurent alors et pour longtemps encore en mains familiales, particulièrement en France, mais aussi aux Etats-Unis. De façon similaire, la complexification des structures organisationnelles n'est pas un trait distinctif absolu de la grande entreprise contemporaine. Durant le second XIXe siècle, certaines entreprises présentent déjà nombre de caractéristiques managériales : la glacerie de Saint-Gobain adopte par exemple à cette époque une structure de type multidivisionnel 468 . Dès 1960, un bon nombre de firmes de taille moyenne présentent un organigramme multidivisionnel 469 . Enfin, la croissance de la logistique bureaucratique paraît moins un trait distinctif de l'entreprise qu'un effet connexe et indésirable du développement de ses opérations. En fait, la transition entre le capitalisme familial et managérial est lente et progressive, s'étalant sur près d'un siècle depuis 1870 environ. A l'instar des formes productives d'Ancien Régime et des premiers temps industriels, ces deux modalités d'activité économique se côtoient et se complètent longtemps avant de se succéder l'une à l'autre. La grande entreprise contemporaine se caractérise en fait par son caractère transnational marqué, au sens de la combinaison du procès productif au travers de plusieurs pays.
2° L'ère de la rationalisation (1880-1930)
Dans les années 1887 à 1904, la première vague de concentration industrielle sur le marché américain est de type horizontal, s'effectuant par absorption de la concurrence. Elle a pour origines d'une part le développement du réseau ferroviaire et la conjoncture économique favorable, d'autre part la pratique informelle mais très répandue d'accords cartellaires intrasectoriels qui donnent naissance à des trusts. Destiné à démanteler ces oligopoles, le Sherman Act de 1890 accélère et institutionnalise en fait la concentration industrielle, car beaucoup de trusts se constituent alors en holdings 470 . La seconde vague de fusions, de 1916 à 1929, procède principalement d'une logique d'intégration verticale, par le regroupement de la filière productive. L'assouplissement de la législation antitrust, la vigoureuse croissance économique de 1922-1929 et l'euphorie boursière de 1926-1929 contribuent également au regroupement des sociétés commerciales 471 . En Europe, la concentration industrielle s'observe dès la fin du XIXe siècle. Le premier mouvement d'ampleur intervient toutefois dans les années 1920 avec le développement des techniques productives de masse. Elle se traduit par l'agrandissement de l'espace usinier et par une gestion centralisée 472 .
« Les années 1880-1914 ont fondé le XXe siècle 473 . » L'affirmation se vérifie tout particulièrement pour la fonction de recherche et développement (R&D) qui émerge dès la fin du XIXe siècle, d'abord dans le Konzern de l'industrie chimique allemande, puis dans la grande firme américaine. Le laboratoire d'entreprise assume une fonction permanente d'innovation technique. D'erratique, la recherche acquiert un caractère programmé et captif ; d'aléatoire, l'innovation devient pour ainsi dire systématique et continue. Le rôle et le nombre des techniciens et des ingénieurs augmentent. Grâce à de lourds investissements, l'innovation technique se multiplie 474 . Innover ne suffit pas ; encore faut-il en dériver les applications industrielles. Au talent technique de l'ingénieur se juxtaposent la curiosité de l'entrepreneur, ainsi que la capacité ouvrière à maîtriser l'innovation. Puis le produit doit rencontrer les attentes du marché. Au besoin, celles-ci sont stimulées, orientées par des actions commerciales ciblées 475 . La grande entreprise relie aussi rationnellement que possible son potentiel technique aux opportunités ouvertes par la consommation de masse.
La systématisation des méthodes de gestion est fille de cette ère de l'organisation. Dans les derniers soubresauts du XIXe siècle, la grande entreprise embauche des juristes, experts-comptables et spécialistes en ressources humaines. Les premières business schools ouvrent leurs portes aux Etats-Unis, parallèlement à la mise sur pied en France des premières filières universitaires d'études commerciales 476 . Des facteurs plus conjoncturels concourent à la systématisation fonctionnelle au sein de la grande entreprise. La Grande Dépression atteint de plein fouet en France les secteurs de la grosse métallurgie, de la mécanique lourde et du verre. Face à la contraction de leurs débouchés, certaines firmes ébauchent dès 1882 leurs premières stratégies marketing afin d'écouler leur production. L'étude systématique des goûts et des caractéristiques de la clientèle, tout comme le dessin de véritables stratégies commerciales en vue de sa séduction n'interviennent cependant que dans l'entre-deux guerres 477 .
Au tournant du siècle, les recettes organisationnelles développées jusqu'alors pour stimuler la productivité industrielle ne suffisent plus. La valorisation industrielle du progrès technique de l'époque reste limitée au regard de l'inefficience patente de l'organisation du travail. Les principes de mécanisation de la production et de division du travail sont désormais intégrés dans une réflexion générique à large spectre. Dans leur réflexion d'économie industrielle, les ingénieurs travaillent à la définition de modes de gestion, de production et d'organisation des hommes qui plaquent au plus près aux exigences d'une production à grande échelle.
Henri Fayol (1841-1925) se fend en 1916 d'un ouvrage intitulé Administration industrielle et générale, dans lequel il vulgarise les principes managériaux forgés au feu de sa longue expérience de dirigeant salarié d'une grande entreprise 478 . Ses réflexions portent logiquement sur la définition des fonctions managériales. Il en recense six, d'ordre technique, commercial, financier, sécuritaire, comptable et administratif. Ces fonctions se décomposent à leur tour quatre dimensions -- organisation, coordination, contrôle et prévoyance. Fayol définit encore plusieurs principes généraux d'administration, notamment la subordination de l'intérêt particulier à l'intérêt général, et la corrélation de l'autorité et de la responsabilité 479 .
A la même époque, Frederick Taylor (1856-1915) se base également sur son propre parcours professionnel pour publier en 1912 ses Principes d'organisation scientifique. De son parcours professionnel d'ouvrier à ingénieur en chef, il a souvent l'occasion de constater les lacunes de l'organisation sociotechnique du travail et de méditer sur son amélioration 480 . Quant à son goût de la performance, Taylor le cultive vraisemblablement durant sa carrière sportive couronnée en 1881 par un titre de champion américain de tennis. Le taylorisme est bien davantage qu'une division minutieuse du travail additionnée de l'aiguillon du chronomètre pour stimuler la cadence productive. Le pari audacieux formulé par l'ingénieur américain peut se formuler ainsi : accroître la productivité du travail sans fatiguer davantage l'ouvrier, augmenter les salaires sans réduire les bénéfices du patron. Sa solution réside dans l'organisation «scientifique» du travail. Le terme un peu grandiloquent s'inscrit dans l'engouement de l'époque pour le scientisme. Il désigne l'étude systématique du savoir-faire ouvrier enrichie des connaissances théoriques de l'ingénieur, afin d'en extraire les méthodes les plus efficaces de production et d'organisation. Le taylorisme recommande la sélection systématique de l'ouvrier selon des critères psychotechniques et l'amélioration de ses compétences techniques. Il préconise une grille de rémunération à la pièce, à la fois stimulante pour l'ouvrier productif que lourdement pénalisante pour celui dont le rendement serait insuffisant 481 . Taylor n'invente pas la division parcellaire du procès productif, dont l'incidence positive sur la productivité est déjà relevée au XVIIIe siècle par les Encyclopédistes et Adam Smith 482 . Il innove en revanche au travers de la définition systématique des tâches et l'établissement de départements de planification. Distinguant nettement la conception et l'exécution du travail, il propose une véritable théorie de l'organisation dont la division du travail n'est qu'un élément 483 .
Le taylorisme repose sur la généralisation de la machine-outil ainsi que du travail à la chaîne. Datant des années 1840, les premières expériences de travail à la chaîne sont monnaie courante trente ans plus tard dans le secteur sidérurgique. On y déplace les éléments les plus volumineux et les plus lourds d'une équipe d'ouvriers à l'autre, alors qu'auparavant ces groupes gravitaient autour de l'objet en construction. Au début du siècle, la jeune industrie automobile fructifie le potentiel rationalisant du travail en continu. L'exemple le plus célèbre est celui de la Ford T. Fiable et d'un coût relativement modique, le modèle connaît d'emblée un succès d'estime lors de sa première commercialisation en 1909. Henri Ford (1863-1947) décide alors d'organiser le montage à la chaîne des moteurs, puis des radiateurs et enfin en 1914 de l'assemblage des éléments mécaniques et des carrosseries sur les châssis. Du coup, l'opération finale de montage ne nécessite qu'une heure et demie, soit environ le dixième du temps précédemment nécessaire 484 . Après de fortes résistances initiales, le taylorisme s'impose de la Première Guerre mondiale à la Crise de 1929. Confirmant l'adage selon lequel nul n'est prophète en son pays, le rayonnement des idées de Fayol est sensiblement moindre en France qu'aux Etats-Unis.
3° L'ère de l'optimisation (1930-1975)
Une vague de concentration industrielle se dessine dès les années cinquante pour connaître son apogée à la fin de la décennie suivante. La dynamique naît sur les marchés américain et anglais, avant de se propager en Europe continentale. Elle procède d'une stratégie de diversification tous azimuts et bénéficie d'un environnement économique et financier favorable. Elle consacre le conglomérat qui relie par le mince trait d'union financier des entreprises aux activités plutôt disparates 485 . Contrairement à la vague précédente, cette phase de concentration industrielle accouche d'une structure organisationnelle et décisionnelle relativement décentralisée 486 .
La structure multidivisionnelle de l'entreprise managériale se répand amplement sur le marché américain dans les années cinquante, puis en Europe une décennie plus tard. Sa structure organisationnelle se complexifie sans se scléroser trop 487 . Elle est de type staff and line, à la fois fonctionnelle et hiérarchisée. L'organigramme procède d'une division fonctionnelle en départements. La cohérence générale de l'organisation est assurée par la coordination transversale des départements à divers niveaux hiérarchiques (staff). L'organisation interne des départements est de type hiérarchique (line) 488 . Jusqu'aux années soixante, l'idée tayloriste du one best way continue d'imprégner les techniques managériales. Elle cède par la suite la primeur aux contingences du all depends. Cette nouvelle approche managériale recherche les configurations organisationnelles les plus efficientes, sur un postulat inchangé de stabilité environnementale. La spécificité des objectifs et des moyens de l'organisation définit sa structure productive, sans considération de facteurs externes 489 . A l'ère de la rationalisation succède celle de l'optimisation.
Sur le plan technique, le fordisme s'impose dans l'industrie automobile américaine et européenne au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il se rénove par l'automation à partir des expériences menées dès les années trente dans les usines Ford. L'automation ou le néofordisme est un système productif muni d'un contrôle automatisé de la ligne de production, ce qui permet le dépassement des capacités physiques humaines. Il repose sur l'usage des machines-transfert -- machines-outils à contrôle numérique pilotées par un ordinateur central, qui permettent une production diversifiée et variable, un travail plus précis, des délais de fabrication plus courts et des coûts réduits 490 . La machine étant surveillée par la machine 491 , l'ouvrier est affecté aux tâches de programmation et de contrôle des automatismes du processus productif 492 . Les techniques informatiques développées pendant le second conflit mondial inspirent même l'idée d'une usine automatique 493 . Les principes tayloristes demeurent toutefois prédominants dans l'essentiel de l'industrie, pour décliner quelque peu dès les années soixante. Ses techniques productives homogènes conviennent bien à la production standardisée de produits au long cycle de vie 494 .
En somme, les principes fordiste et tayloriste de division fonctionnelle du travail restent à l'honneur entre 1930 et 1975. La formidable croissance économique qui accompagne toute la période d'après-guerre 495 génère un bel optimisme quant aux potentialités d'extension de la consommation de masse. L'environnement de la firme est évacué du dessin organisationnel. Le modèle productif entend améliorer la productivité en interne de l'organisation par les principes de verticalité et de centralisation décisionnelle, ainsi que par le contrôle strict de l'information par la direction 496 . Cette structure pyramidale repose sur les normes d'ordre, de conformité et d'uniformité que les chocs pétroliers ébranlent au début des années septante.
4° Vers un management intégré et ouvert sur son milieu (1975-2000)
Après les deux chocs pétroliers des années septante, certaines firmes s'unissent en conglomérats afin de réduire par la diversification les risques encourus dans leurs activités de base 497 . Une nouvelle vague de concentration industrielle s'amorce à partir du marché américain dans les années quatre-vingts. Elle est servie par le contexte institutionnel très favorable des marchés américain et anglais ainsi que par l'accès élargi aux marchés mondiaux de capitaux. Elle revêt un caractère souvent spéculatif. En Europe, la concentration profite largement du démantèlement des barrières douanières nationales 498 . La dynamique concentrationnaire s'accélère au cours des années nonante 499 . La grande firme recherche une taille critique compatible avec des marchés mondialisés et synonyme de bouclier protecteur contre une offre publique d'achat (OPA). La croissance peut alors être d'origine interne ou externe. Dans le premier cas, l'entreprise se recentre sur ses activités de base (core business) pour améliorer sa compétitivité dans des niches sectorielles. Une croissance interne insuffisante peut l'inciter à acquérir une autre firme. Le caractère spéculatif d'une partie de la concentration industrielle ne fait pas de doute. Le phénomène doit beaucoup à la baisse des taux d'intérêt obligataires qui reporte l'investisseur sur le marché des actions. Plus liquide et fluctuant, ce marché favorise des stratégies d'investissement en vue d'un rendement maximal à court terme. L'activisme actionnarial des fonds de pension américains comporte aussi une forte tonalité spéculative. A tout le moins, ce dernier phénomène croît en importance 500 .
La dynamique de concentration industrielle représente une facette d'un phénomène plus complexe de scissions, d'alliances stratégiques et de réorganisation interne. Grâce aux progrès des NTIC, l'entreprise transnationale assouplit sa morphologie organisationnelle. Le déclin de la grande usine se dessine toujours plus distinctement. L'avenir appartiendrait-il à une constellation de petites et moyennes entreprises (PME) 501 tels que ceux de la Silicon Valley en Californie ou l'agglomération bolognaise en Italie 502 ? La grande entreprise affiche l'ambition paradoxale de gagner simultanément en gigantisme et en souplesse.
« Il s'agit de transformer un supertanker en une flottille de vedettes rapides dont quelques unes doivent être capables de tenir la haute mer 503 . » La grande firme contemporaine concentre sans centraliser. Sa structure productive se fait réticulaire, articulée autour de points nodaux plus ou moins stables. Si la direction générale ne centralise pas formellement le contrôle des firmes satellites, elle maintient son pouvoir par l'imposition de standards de qualité ou d'objectifs bénéficiaires. La marge de manoeuvre de la firme satellite s'entend dans le choix des processus, non des objectifs 504 . L'entreprise transnationale s'ouvre davantage, encore que sélectivement, à son environnement social. La pensée managériale conçoit mieux l'entreprise en tant qu'élément d'une configuration sociétale dynamique 505 . L'entreprise contemporaine n'est plus cette organisation fordiste tentaculaire vouée à l'impossible réduction de l'incertitude générée par son milieu. Elle distingue désormais l'incertitude, sur laquelle elle n'a aucune prise, du risque qu'elle peut réduire 506 . Elle gère le risque systémique et conjoncturel par la flexibilité et l'interaction. Son organisation technique se fait plus complexe et plus ouverte sur son environnement alors que son organisation sociale gagne en souplesse 507 .
La pensée managériale occidentale s'inspire dès les années 1960 des méthodes japonaises de gestion. Au contraire du taylorisme et du fordisme, le management japonais définit en priorité les processus et la division sociale du travail pour en déduire les structures fonctionnelles et l'organisation technique du travail. Fragilisée par l'effritement du mythe d'une croissance économique illimitée, l'entreprise fordiste souffre au début des années quatre-vingts de sa lourdeur et de sa rigidité. Elle innove peu. L'entreprise occidentale comprime alors ses coûts de production et réduit ses inerties en s'inspirant du toyotisme -- mode de production en flux tendus (lean production) mis au point par la firme Toyota 508 . Elle développe des accords stables de coopération avec des instituts de recherches ou des entreprises à la lumière des expériences japonaises lors des années cinquante et soixante 509 . Elle améliore la qualité de ses produits grâce notamment aux cercles de qualité totale d'inspiration nippone.
Le toyotisme est un système de production à grande échelle de biens diversifiés et de qualité. Il cherche à honorer les commandes dans les meilleurs délais par la réduction des gaspillages de matière, d'énergie et de temps lors du procès productif. Le toyotisme met en oeuvre des flux de produits pièce à pièce qui impliquent corrélativement une grande synchronisation des opérations, des objectifs de qualité totale des produits et d'amélioration continue par apprentissage. Parfois qualifié de semi-fordiste, le toyotisme ne renonce pas au travail à la chaîne. Il l'optimise grâce à la production en flux tendus et à l'autonomisation de la ligne productive 510 . Le volume de la production est piloté en aval de celle-ci -- par les commandes de la clientèle ou par l'atelier de montage final -- afin de minimiser les stocks, réduire les gaspillages et les délais d'attente. Le toyotisme suppose la circulation de l'information relative à l'objet fabriqué tout au long de la filière productive et commerciale 511 .
Contrairement à une idée reçue, le toyotisme n'est pas un pur produit de la gestion japonaise. Les bases du système juste-à-temps sont conçues par le fondateur de la firme Toyota, Eiji Toyoda. L'un de ses cadres, Taiichi Ohno, les développe et les formalise au début des années cinquante à la lumière d'expériences américaines antérieures 512 . Le système productif est amélioré graduellement. Il se diffuse dans les années septante parmi les entreprises japonaises 513 . Le toyotisme n'a pas le succès des modèles tayloriste et fordiste. Face à la récession japonaise, il est rapidement modifié dans les années nonante par sa firme génitrice 514 . Le toyotisme est desservi par la tertiarisation économique ainsi que par la diversification des produits et des modes productifs. Il préfigure néanmoins quelques-unes des tendances récentes de l'organisation productive.
Dans les années quatre-vingts, de lourds investissement techniques transforment l'organisation du travail des secteurs secondaire et tertiaire. Le progrès des automatismes et des solutions informatisées de calcul, de commande et de pilotage permettent de nouvelles solutions organisationnelles. Les nouveaux impératifs de flexibilité et variété de la production entraînent la multiplication de petits ateliers semi-autonomes coordonnés entre eux par la direction opérationnelle 515 . Innovation, flexibilité et dynamisme sont les maîtres mots du management contemporain. Ils concernent tant les structures que les hommes. L'assouplissement des structures donne une importance nouvelle à la qualité des processus 516 . La décentralisation des organigrammes et l'aplatissement des hiérarchies favorisent l'innovation technologique, organisationnelle et sociale. L'innovation se décline au travers de quatre types de stratégies complémentaires : la reconfiguration des structures, des processus et des tâches pour une production en flux tendus ; le remodelage de l'ensemble des fonctions et des activités de l'entreprise ainsi que de leurs interrelations ; la sous-traitance de services annexes et la mise en réseau des entreprises ; enfin la gestion des actifs intangibles tels que le savoir-faire ou la réputation de l'entreprise.
B. L'organisation sociale du travail
Nourrie par la lente progression des salaires réels, l'émergence d'une classe moyenne inférieure dès le dernier quart du XIXe siècle se confirme au siècle suivant. Le phénomène ouvre l'ère de la consommation de masse. Entre 1880 et 1920 s'affirme l'usine moderne, gourmande en main-d'oeuvre ouvrière malgré ses nombreuses machines. Sa localisation en périphérie urbaine suscite un essor plutôt chaotique des banlieues. Si l'atelier reste étonnamment vivace, le travail se conçoit toujours davantage en usine et en grand magasin. En 1914, les aciéries du Creusot occupent 20'000 ouvriers alors que les industries automobile, aéronautique et électrique expérimentent précocement de fortes concentrations de main-d'oeuvre 517 .
Le dernier quart du XIXe siècle marque la montée du fait syndical. La fréquence, l'ampleur et la virulence des mouvements de grève croissent surtout dès 1890. En France, le droit de grève est reconnu légalement dès 1864, la liberté syndicale vingt ans plus tard. La grève acquiert durant cette période ses traits principaux : elle est moment privilégié de l'action et de la mémoire ouvrières 518 . En ses débuts, la grève est le plus souvent spontanée et exprime dans sa soudaineté et sa brutalité un trop-plein de frustrations. Son caractère toujours plus méthodique et violent lui confère un mandat politique de protestation collective. La concentration industrielle de la deuxième révolution industrielle et la précarisation du niveau de vie ouvrier lors de la Grande Dépression participent à l'essor de la revendication ouvrière 519 . La fonction syndicale est ambiguë, à la fois tison et arbitre du conflit de travail. Fer de lance, le syndicat d'entreprise cristallise l'esprit de corps du salariat, agrège et formule ses revendications. Organe de conciliation, il jette des passerelles entre le paternalisme patronal et le radicalisme ouvrier. En cas d'échec des négociations intervient la grève. Son efficacité directe s'apprécie à l'aune de la satisfaction des revendications ouvrières. Sa force indirecte tient en son possible effet mimétique sur d'autres associations syndicales, tout comme en son fantôme : le spectre de la grève.
1° L'ère de la rationalisation (1880-1930)
L'usine moderne est bien davantage qu'un grand atelier. Ses structures organisationnelles expriment un véritable saut qualitatif 520 . En principe du moins, sa direction travaille sous la surveillance du conseil d'administration, à qui elle présente et justifie les décisions opérationnelles à moyen terme. De façon plus concrète, l'usine moderne conteste l'autonomie traditionnelle de l'ouvrier de métier par son obsession d'organisation du procès de production. Spécialisation des hommes et des machines, rationalisation tous azimuts, dévalorisation du savoir-faire traditionnel, renforcement de l'encadrement ouvrier contribuent à la formation d'un salariat moderne. Forte d'un même vécu usinier et urbain, la classe ouvrière connaît une homogénéité et une conscience collective qui culminent dans l'entre-deux guerres avant de s'altérer dans la seconde moitié du XXe siècle 521 .
L'affirmation de l'usine dès la fin du XIXe siècle amenuise la mobilité sociale du salariat. L'aventure entrepreneuriale est toujours ardue en raison de la lourdeur des investissements initiaux. Le fossé se creuse entre cols bleus et cols blancs du fait de la complexification des techniques productives qui développent les formations supérieures et secondaires. Le clivage s'affirme en dépit de l'introduction dès 1870 de la scolarité publique gratuite, au niveau élémentaire du moins. Les filières traditionnelles d'apprentissage «sur le tas» s'enrayent, car les cadences usinières élevées ne s'accommodent guère de démarches formatrices. En France, la formation professionnelle publique ne répond en 1910 toujours pas aux attentes patronales. La grande firme ouvre des établissements privés à l'enseignement ciblé 522 . Les perspectives d'avancement professionnel offertes à l'ouvrier sont toujours plus restreintes face à l'ingénieur et au cadre administratif 523 .
Les lois sociales élaborées dès la fin du XIXe siècle adoucissent partiellement le travail en usine. La place de travail reste nonobstant exiguë et bruyante, les lieux d'aisance rares, les cantines quasi inexistantes, le chauffage insuffisant. Les impératifs de la production de masse l'emportent. En France, les firmes Renault, Michelin, Berliet adoptent au début du XXe siècle l'organisation scientifique du travail, que l'ouvrier rebaptise aussitôt « organisation du surmenage au travail ». Les résistances ne tardent pas. L'éclatement de la Première Guerre mondiale marque néanmoins en France le rapide essor du taylorisme, car l'industrie engage 350'000 femmes inexpérimentées et dociles : « Tournant capital dans l'histoire de l'aménagement de l'entreprise 524 . »
Le taylorisme introduit une plus grande différentiation et hiérarchisation fonctionnelles au sein de l'organisation sociale de l'usine. Il génère une classe spécifique d'ingénieurs spécialistes de l'organisation du travail. L'ingénieur n'est pas ce garde-chiourme qui, armé de son chronomètre, scanderait sa cadence inflexible à l'ouvrier. L'ingénieur manie cet instrument dans le cadre d'expériences pilote afin de déterminer au plus juste le geste le plus précis et le plus rapide. Puis intervient l'instructeur qui diffuse le mode opératoire dessiné par l'étude. Enfin le contrôleur effectue le contrôle qualitatif et quantitatif du travail ouvrier 525 . Le chronomètre lie ainsi l'élaboration et la reproduction d'une gestuelle épurée de tout mouvement superflu. L'apparition dans l'atelier de l'instructeur et du contrôleur recentre le chef d'atelier sur leur fonction première de coordination des tâches. Mais le positionnement socioprofessionnel est difficile pour ces nouveaux venus qui sont souvent ressentis comme des intrus, des intellectuels dénués de tout sens pratique. Le taylorisme accroît et institue les clivages au sein du monde ouvrier. L'ouvrier habile et expérimenté concourt à la réalisation des expériences pilote, monte et règle les machines. A l'échelon intermédiaire, l'ouvrier spécialisé, aux faibles compétences techniques et affecté à un segment très restreint du procès productif 526 . Au bas de l'échelle, le manoeuvre occupé aux mille tâches sans qualification technique. L'usine dilue l'autorité en une pyramide technocratique 527 .
La réaction ouvrière n'est pas univoque. L'hostilité prédomine face à la discipline usinière et à l'extrême parcellisation du travail qui vide celui-ci de sa dimension créative. La déqualification professionnelle et le déclassement social induits par le «bagne industriel» freinent les progrès dans la fixation de la main-d'oeuvre 528 . En 1914, les usines Ford embauchent 53'000 personnes afin de maintenir constant un effectif de 14'000 employés 529 . L'adaptation pragmatique de l'ouvrier se dénote au travers du recul de l'absentéisme et au progrès de la ponctualité au travail. L'ouvrier valorise timidement la stabilité de l'emploi, tout en trouvant parfois dans l'alcoolisme et les loisirs un antidote à la monotonie harassante du travail usinier. Enfin l'aversion générique de l'usine s'accompagne parmi une frange ouvrière militante d'une critique technique des politiques patronales. Si cette élite ouvrière reconnaît l'utilité du machinisme et de la division du travail, elle stigmatise les failles de la gestion patronale et réclame sa participation à l'amélioration des conditions de travail 530 .
2° Le compromis fordiste (1930-1975)
La division tayloriste et fordiste du travail domine tout le premier XXe siècle occidental. Le fordisme approfondit le taylorisme, tout comme le néofordisme ou l'automation prolonge et développe le fordisme. Le néofordisme déqualifie encore davantage le travail ouvrier en dépit d'une certaine rotation des postes. Il implique moins de contremaîtres et plus d'ingénieurs. Le contrôle est plus abstrait et plus rigoureux. « Les ouvriers ne sont plus soumis à une contrainte personnelle d'obéissance, mais à une contrainte collective de production 531 . » Le fordisme repose sur un compromis qui partage entre le patronat et le salariat les bénéfices de l'augmentation de la productivité : efficacité accrue contre rémunération plus substantielle. Il subordonne par ailleurs la division technique à la division sociale du travail. L'élévation du niveau de vie de l'ouvrier fait de lui un consommateur potentiel, d'où une nouvelle division technique du travail. Dès les années soixante, le néofordisme est toujours plus critiqué pour les problèmes psychologiques qu'il engendre auprès de la main-d'oeuvre et pour sa rentabilité insatisfaisante 532 .
Pourquoi dès lors ces réticences ouvrières ? Dès les années trente, l'Ecole des relations humaines fondée par Elton Mayo met en évidence la logique des sentiments et de l'irrationalité dans la vie sociale de l'entreprise, dimension négligée jusqu'alors 533 . Des expériences menées aux Etats-Unis entre 1924 et 1932 dans l'usine de Hawthorne de la Western Electric soulignent l'importance pour l'ouvrier de rémunérations non économiques. La productivité s'améliore si la direction soigne sa communication avec la main-d'oeuvre et veille à la qualité de l'ambiance de travail 534 . Une telle logique s'inscrit mal dans le rigide schéma fordiste, ce qui lui vaut un succès limité. Les travaux de l'Ecole des relations humaines sont concomitants de diverses recherches et expériences pilote menées en Europe 535 . Durant les années cinquante apparaît l'école sociotechnique. Eric Trist et Frederick Emery au Tavistock Institute of Human Relations de Londres ainsi qu'Einar Thorsrud à l'université de Trondheim en Norvège établissent l'interaction des variables techniques et sociopsychologiques. L'organisation du travail doit être optimisée dans ses dimensions technique et sociale, comme sur le plan interne et externe. L'entreprise est appréhendée désormais en tant que système ouvert sur son environnement 536 .
A la même époque, diverses expériences pilote de démocratie industrielle tentent de pallier les rendements insatisfaisants du taylorisme et du fordisme 537 . Elles établissent des cellules semi-autonomes de travail. Le travail est élargi par rotation des équipes de montage et enrichi grâce à la participation de l'ouvrier à l'organisation du travail. Le coût économique de l'humanisation du travail et de l'autonomisation de l'individu et du groupe serait absorbé par la rotation réduite du personnel ainsi que par la flexibilité accrue de la production. Certaines de ces initiatives bénéficient d'un soutien public, principalement en Europe du Nord et en Scandinavie 538 . Si ces expériences ne concurrencent guère les principes tayloristes et fordistes qui restent à l'honneur jusqu'aux crises pétrolières des années septante 539 , elles préfigurent l'adoption ultérieure par les firmes occidentales des méthodes japonaises de cercles de qualité et de gestion de la qualité totale 540 .
3° A la recherche d'un nouveau compromis (1975-2000)
Dans les années quatre-vingts, le progrès technique contribue au dépassement du taylorisme. La robotique et l'informatique industrielle réduisent la composante manuelle dans la production et par-là le taylorisme. D'une approche fonctionnelle et cloisonnée, on passe à une conception systémique et polycellulaire de l'entreprise 541 . Les potentialités de l'humain sont mieux reconnues : l'organisation se fait qualifiante et responsabilisante 542 . L'organisation qualifiante plaide pour l'autonomisation de petites équipes de travail. Le décloisonnement fonctionnel et divisionnel de l'organigramme suggère une gestion par projet dans un objectif de qualité totale, une communication plus directe entre la clientèle, l'entreprise et ses fournisseurs. Elle suppose une dynamique évolutive du contenu des compétences professionnelles, ainsi que la participation des travailleurs à cette évolution 543 . L'organisation qualifiante s'inspire indubitablement du toyotisme.
Tant l'organisation qualifiante que le toyotisme réduisent la scission tayloriste et fordiste entre la conception et l'exécution du travail. Tous deux responsabilisent individuellement et collectivement l'ouvrier. Les deux modes productifs valorisent davantage le facteur humain et prônent une logique participative. L'organisation qualifiante se distingue du toyotisme par son accent plus franc sur les compétences et les facultés d'apprentissage de la main-d'oeuvre, ainsi que par son domaine d'application non limité au secteur manufacturier. Sans oublier l'essentiel : l'organisation qualifiante tourne résolument le dos à Taylor et Ford et leur minutieuse division du travail. Le toyotisme en revanche conserve une certaine division sociale des tâches et le travail à la chaîne. Il use à la fois du contrôle et de l'incitation. Ainsi sa politique de ressources humaines stimule matériellement l'employé grâce à une grille salariale couplée à sa productivité. Le toyotisme réduit sans éliminer le caractère dégradant et policier du travail à la chaîne. Il le contrebalance par une puissante symbolique d'identification de l'ouvrier à l'entreprise 544 . Le toyotisme ne s'affranchit pas forcément des problèmes du taylorisme, car la responsabilisation de l'employé et une meilleure communication interne ne garantit ni son niveau de qualification ni sa véritable responsabilisation. La gestion par projet ne supprime en effet pas le contrôle externe du taylorisme sur l'exécutant. Elle internalise le contrôle grâce au travail en équipe et à la mise en réseau qui assurent la conformité des schémas mentaux et des méthodes de travail. Quant à l'organisation qualifiante, elle postule faussement qu'un progrès économique suivrait forcément sa mise en oeuvre 545 .
Dans les années nonante, certaines firmes ne placent plus les ressources humaines parmi leurs préoccupations principales. Alors que la composante main-d'oeuvre de la production se réduit par rapport à la technologie, elles se retournent vers des préoccupations plus tangibles telle la traque aux coûts cachés 546 . L'enjeu contemporain lié au travail est l'emploi. Le travail se précarise, tant dans l'horizon temporel que par rapport à l'ambiance de travail. Le travail montre aussi son revers, le chômage et l'exclusion. Le chômage est mal vécu. L'orientation vers les loisirs de la vie contemporaine n'érode guère la fonction sociologique de l'activité professionnelle. Le travail est « le moyen d'assurer la vie matérielle, de structurer l'espace et le temps, c'est le lieu de l'expression de la dignité de soi et des échanges sociaux 547 . » Phénomène de société, l'exclusion se décline en de multiples variantes : l'exclusion des moins jeunes à qui on reproche leur manque de flexibilité ; l'exclusion des plus jeunes à qui on pointe leur manque d'expérience. A un problème nouveau, «l'inemployabilité» du qualifié 548 , répond un défi nouveau -- son adaptation aux rapides mutations du travail et des compétences professionnelles 549 . Connaître devient moins important qu'apprendre à connaître.
C. La responsabilité sociale de l'entreprise
La deuxième industrialisation marque le recul du paupérisme et plus encore l'enrichissement de la bourgeoisie entrepreneuriale. L'internationalisme socialiste préoccupe les esprits libéraux. Dans le dernier quart du XIXe siècle, la responsabilité sociale du patronat se partage entre des initiatives sociales de type paternaliste et des pratiques philanthropiques ou de mécénat. Les premières postulent le bien-être et le contentement ouvriers comme le fondement de la prospérité industrielle 550 . La charité ou le mécénat polissent de façon moins calculée l'image bourgeoise 551 . Les variantes de paternalisme industriel ne sont appliquées de façon étendue que dans un nombre restreint d'entreprises et ne survivent guère à la Grande Guerre. En transparence se lisent toujours le souci de stabilisation sociale et parfois l'arrière-pensée religieuse. Le patronage leplaysien est sobrement moralisant dans son objectif de fixation de la main-d'oeuvre. Au tournant du siècle, les prestations sociales se multiplient. Le bénéficiaire privilégié de ces politiques est l'homme marié et père de famille, employé de longue date et doté de robustes qualifications techniques 552 . Face à la montée aux barricades du syndicalisme ouvrier, l'intransigeance des pouvoirs publics et des milieux patronaux témoigne de leur préoccupation de préserver l'ordre public 553 . Le contrôle serré de la main-d'oeuvre augmente sa productivité, mais suscite l'effervescence ouvrière. Avant 1930, la plupart des patrons négocient âprement les avantages sociaux accordés à l'ouvrier. D'autres, tel Henri Ford, octroient unilatéralement des avantages sociaux afin de court-circuiter l'action syndicale 554 .
1° Les paternalismes (1880-1930)
Les années 1880 posent en Europe les premiers jalons de l'Etat-providence. Celui-ci naît d'une perception assez unanime des insuffisances des politiques publiques et des initiatives privées en matière sociale. Les débats politiques y relatifs n'en restent pas moins fortement polarisés. Ils écartent toute participation ouvrière 555 . L'Allemagne prend les devants. Après l'unification des Länder en 1871, le chancelier Bismarck entreprend l'édification de la nation allemande et la légitimation du pouvoir impérial face au socialisme. Il introduit durant les années 1880 le premier dispositif d'assurances sociales obligatoires -- assurance maladie, assurance accident, puis caisse de retraite. L'exemple est largement suivi en Europe. L'Angleterre ne pallie qu'entre 1908 et 1911 les carences de sa loi sur les pauvres de 1834. En France, la IIIe République promulgue dans les années 1880 les lois ouvrières qui légalisent notamment les syndicats. Si la mise sur pied de l'assistance sociale publique est relativement précoce (1893-1913), celle des assurances sociales obligatoires est plus tardive (1928-1930) et a pour origine des initiatives privées encouragées par l'Eglise 556 . Les Etats-Unis demeurent à la traîne et comptent toujours sur les solidarités privées et familiales 557 . Les profondes mutations sociales du tournant du siècle amènent certains politiciens américains à réclamer un engagement public plus marqué, complémentaire à l'action privée 558 . La couverture publique en matière de retraite ou d'assurances sociales demeure néanmoins quasiment inexistante jusqu'en 1930, avant de s'étoffer quelque peu 559 . La période voit ainsi le paradigme de la responsabilité individuelle s'effacer devant celui de la solidarité collective 560 .
-
Du patronage au paternalisme (1875-1900)
Le patronage connaît en France de belles heures dans le dernier quart du XIXe siècle, à en juger par les réalisations des Wendel en Meurthe-et-Moselle. Dans l'annexion territoriale qui fait suite à la défaite française de 1871 face aux armées de l'Allemagne impériale, Henri I de Wendel perd ses deux sites productifs. Il entreprend la construction d'un nouveau complexe sidérurgique à Joeuf-en-France 561 . Entre 1879 et 1894, Wendel élabore pour ses ouvriers un système de prestations sociales sans équivalent à la ronde : salaires élevés, caisse de retraite et soins médicaux gratuits, cités ouvrières, écoles. L'inspiration leplaysienne est indéniable et saluée comme telle à l'époque 562 . Toutefois, d'importants mouvements de grèves éclatent sous la IIIe République et s'amplifient par la suite. La mutation rapide du tissu industriel accentue le malaise social. Une partie du patronat n'en a cure : « Plier une main-d'oeuvre encore indocile aux impératifs de la production industrielle reste l'obsession majeure 563 . » Le renforcement de la discipline usinière ressuscite le sempiternel problème de fixation de la main-d'oeuvre, alors que se dégradent le climat de travail et la légitimité patronale. Corollaire du développement syndical, l'essor des mouvements grévistes paraît témoigner de la maturation des classes ouvrières. Le syndicalisme crée un néologisme, le «paternalisme», pour morigéner contre la pesante tutelle patronale sur et hors de la place de travail 564 .
Alors professeur d'économie sociale à l'école des Mines, Emile Cheysson 565 prône un «patronage éclairé» qui consolide le système d'institutions sociales tout en allouant davantage de responsabilité et d'autonomie à l'ouvrier, notamment dans la gestion des caisses de pension. Cette stratégie décharge le patron de la gestion des fonds ouvriers et le blanchit de tout soupçon d'ingérence. Elle stimule les ouvriers à l'épargne vu le contrôle patronal limité. Elle augmente le sens de la responsabilité des ouvriers et leur implication dans la vie de l'entreprise. Elle préserve enfin le salariat des idées socialistes 566 . Ses recommandations ne trouvent pas d'écho retentissant auprès du patronat. Elles paraissent insuffisantes et inadaptées face aux problèmes sociaux liés à la deuxième industrialisation. Les mouvements de grèves qui émaillent la dernière décennie du XIXe siècle démontrent que le salariat ouvrier ne se contente plus de demi-mesures. Cheysson lui-même reconnaît à la fin du siècle l'anachronisme du régime de patronage et son inadaptation à la grande usine moderne 567 . La fragilisation de l'autonomie traditionnelle de travail de l'ouvrier, l'augmentation des cadences de travail, le renforcement disciplinaire et la perte du contact direct entre l'ouvrier et son employeur sapent la légitimité patronale. La direction s'efforce d'y remédier par une nouvelle forme d'encadrement ouvrier, le paternalisme.
Le régime paternaliste se développe dans le secteur sidérurgique français au tournant du siècle pour connaître son âge de maturité dans l'entre-deux guerres. A priori, le paternalisme du début du XXe siècle ne diffère guère du patronage du second XIXe siècle. Tous deux ambitionnent fondamentalement l'adaptation de l'organisation sociale du travail industriel aux nouvelles contingences productives et au contexte sociopolitique. Les deux régimes partagent pour prémisse le déficit de main-d'oeuvre qualifiée de la France rurale où l'industrie minière et sidérurgique est traditionnellement implantée. Le travail ouvrier reste pénible et les perspectives d'ascension socioprofessionnelle limitées. En conséquence, le paternalisme tente de freiner le drainage de la main-d'oeuvre des bassins industriels ruraux vers les agglomérations urbaines qui abritent les jeunes industries de transformation et de services 568 . Dès le dernier quart du XIXe siècle, l'usine accroît sensiblement sa taille. Qu'elle se rapproche de la ville ou qu'elle s'entiche du milieu rural, elle se recroqueville sur elle-même et rompt ses attaches campagnardes. Même en milieu rural, la technicité et la rationalisation croissantes du travail usinier s'accommodent toujours plus difficilement des irrégularités de la vie paysanne. Le patronat encourage la main-d'oeuvre résidant aux alentours de la cité-usine à s'y établir. Le souhait reste lettre morte, ressenti par l'ouvrier comme une assignation à résidence et une immixtion dans sa vie privée.
Le paternalisme du tournant du siècle consacre la diversification des origines sociales du salariat : à l'artisan qualifié et à l'ouvrier paysan se joint le travailleur immigré 569 . L'ouvrier qualifié jouit des faveurs patronales 570 . Le régime paternaliste durcit l'encadrement de la main-d'oeuvre : contrôle comportemental plus étroit de l'ouvrier sur sa place de travail et dans ses déplacements dans l'usine, tutelle alourdie sur la gestion des institutions sociales et des activités associatives. Le paternalisme dégage des effluves totalitaires qui incommodent d'autant plus le salariat qu'il a conscience et démontré sa capacité d'action collective. Aussi l'ouvrier exploite-t-il les goulets d'étranglement de la rationalisation des espaces, des rythmes et des processus usiniers 571 . La résistance passive, la dérobade, le freinage sont pour lui des tactiques courantes. De son côté, le patron n'hésite dans sa politique sociale plus à jouer sur les disparités sociales, sur les différences d'origine et sur les inégalités de traitement des différents types d'ouvriers pour mieux asseoir son autorité. En parallèle, il multiplie les initiatives symboliques dans le but de conforter sa propre légitimité 572 . Par la stratégie de division politique du salariat, le paternalisme tranche fortement avec le régime du patronage qui visait à la création de solidarités ouvrières. Le régime paternaliste accentue la symbolique de l'autorité patronale que défie toujours plus ouvertement et radicalement l'activisme ouvrier.
La mise en oeuvre du paternalisme du tournant du siècle est plus onéreuse que celle du patronage. Les attentes ouvrières prennent pour niveau minimal les réalisations sociales accomplies sous le régime de patronage du Second Empire. Ensuite l'usine qui rompt ses attaches sociales rurales doit assumer pleinement la substitution des solidarités sociales qui soutiennent traditionnellement l'ouvrier et sa famille, l'invalide du travail et le retraité. L'obligation revêt un caractère de plus en plus légal et politique par le développement des lois ouvrières que le syndicalisme d'entreprise s'affaire à faire respecter 573 . Dès lors, le patronat hésite. De nouvelles réalisations sociales couperaient l'herbe sous le pied du législateur et des mouvements syndicalistes. D'autre part et plus communément, il hésite à maintenir à flot le régime assurantiel du patronage qui a manifestement pris l'eau.
La politique sociale des cristalleries de Baccarat en Alsace illustre à la fin du XIXe siècle cette pesée d'intérêts. Dans les années 1880, la production traditionnelle d'articles de luxe de la cristallerie évolue rapidement vers une production d'articles de série à qualité et coût réduits. En parallèle, le régime de patronage est remis en question par la direction. A ses yeux, les valeurs de solidarité et de démocratie promues par ces institutions sociales nourrissent l'activisme syndical. En 1890 est créée une caisse de chômage qui ne concerne que les ouvriers permanents. Ses prestations couvrent les seuls impondérables, telle la baisse des commandes ou une réparation de machines. Surtout, le financement et la gestion de ce fonds sont du ressort exclusif de la direction 574 .
La distinction entre les régimes de patronage et de paternalisme est parfois floue. A la fin du Second Empire, apparaît le grand magasin dans les beaux quartiers. A Paris, les époux Boucicaut et leurs associés ouvrent en 1869 Au Bon Marché, pour le plus grand bonheur des dames de la classe moyenne émergeante 575 . La concentration des structures de vente implique la rationalisation et la division des tâches. Des métiers sont redéfinis : la profession de la vente se décline désormais aussi au masculin avec pour nouvelle déontologie le savoir-vivre, la courtoisie et le souci de l'entière satisfaction de la clientèle. Au Bon Marché est une vaste et lourde bureaucratie à la hiérarchie complexe d'hommes d'appareil, affectés à la manutention, à la vente, au contrôle ou à l'administration. Sa gestion des employés est martiale. La discipline est stricte, les renvois fréquents, les salaires de base modestes, les conditions d'hygiène incertaines. On se presse pourtant devant le bureau d'embauche, car l'établissement est organisé en une aguichante méritocratie. Les cadres sont choisis parmi les employés les plus méritants ; la guelte stimule le vendeur 576 .
Catholiques convaincus, les Boucicault s'inspirent des réalisations sociales antérieures des industriels d'Alsace-Lorraine 577 . Leur magasin se veut une «grande famille» et une «organisation philanthropique». Moins lyriquement, leur politique sociale contrebalance les effets pervers de la nouvelle organisation du travail tels que le stress induit par le salaire au mérite et la stricte discipline. Elle assure le recrutement d'une main-d'oeuvre de qualité et désamorce les conflits de travail. Elle comporte enfin d'explicites ambitions moralisatrices. Le système a pour clés de voûte les caisses de prévoyance et de retraite. Celles-ci sont alimentées par les bénéfices annuels. La stratégie est subtile. Le partage des bénéfices renforce l'esprit de corps, incite le personnel à l'épargne, le discipline et le fidélise 578 . Le patronage du Bon Marché installe un climat de travail autoritaire et moralisateur et multiplie les immixtions dans la vie privée de l'employé. Il se pose en pourfendeur de la mobilisation collective : « Sollicitude contre dévotion, le marché ne laissait que peu -- voire aucune -- place au syndicalisme 579 . » Peu de changements internes interviennent jusqu'à l'éclatement en 1919 de la première grève et de la transformation subséquente de l'entreprise en société anonyme. D'inspiration leplaysienne, la politique sociale d'Au Bon Marché connaît le succès d'un instrument adapté aux défis de son temps.
Les variantes de paternalisme mises en oeuvre par certaines grandes entreprises de l'époque orientent parfois la formulation ultérieure des politiques sociales. Au début du XXe siècle, le système d'assurances sociales des aciéries du Creusot distingue les risques maladie, accident et vieillesse et dispose respectivement d'une caisse mutuelle, d'une caisse de pension et d'une caisse de retraite pour y remédier. Ces prestations sociales sont financées par des prélèvements sur la masse salariale. L'exemple creusotin inspire l'élaboration du système public français d'assurances sociales 580 . Initiatives privées et politiques publiques procèdent d'une communauté d'objectifs dont le moindre n'est pas d'endiguer les velléités révolutionnaires des masses ouvrières. Pour les pouvoirs publics, le nivellement de principe des responsabilités privées établit une cohérence nouvelle entre les politiques publiques industrielle et sociale, entre le comportement des acteurs économiques et la législation sociale 581 . Ce rapprochement entre les pouvoirs publics et le monde industriel comporte ses limites. Les lois ouvrières ne contentent pas, on s'en serait douté, l'intégralité du patronat. Si elles allègent la responsabilité de l'entreprise pionnière, elles placent au pied du mur les patrons demeurés à la traîne. Au début du XXe siècle, une partie du patronat français morigène contre les revendications ouvrières tout en comme il redoute le développement du droit du travail. Après avoir pesé sur le jeu démocratique pour émousser le contenu et la portée des nouvelles dispositions législatives, cette fraction du patronat ne se fait faute de freiner leur mise en oeuvre. Les institutions sociales sont maintenues pour préserver frileusement l'acquis. Leur développement consolide plutôt l'autorité patronale qu'il ne responsabilise le salariat. Vu ainsi, l'hiatus est patent entre l'ingénieur social Cheysson et une partie du patronat français. Somme toute, cette division du patronat face à la question sociale accompagne toute l'histoire capitaliste.
* * *
Les initiatives sociales du patronat britannique au tournant du siècle procèdent intimement des valeurs victoriennes. L'esprit victorien est pratique et pragmatique, plutôt anti-intellectuel et utilitariste. Fortement puritain, il accorde une valeur centrale au travail, lequel apporte argent, respectabilité et succès. La propriété est indissociable de la charité. La charité privée est visible dans sa manifestation afin de gagner l'approbation sociale du philanthrope. Les charités privées se développent considérablement durant la seconde partie du règne victorien (1860-1900) 582 . La philanthropie privée se fait plus systématique et coordonnée ; elle devient «scientifique». Parfois connotée religieusement comme pour l'Armée du Salut, elle est plus souvent empreinte d'humanité séculière 583 . L'impact social de la philanthropie privée démontre ses limites lors de la Grande Dépression. Au début du XXe siècle, la lutte contre la pauvreté figure en bonne place sur l'agenda de la classe politique anglaise qui s'inspire des exemples allemand et néo-zélandais 584 .
Plusieurs initiatives privées en matière de logement ouvrier voient le jour en Angleterre au tournant du siècle. Elles ont pour particularité d'émaner pour la plupart de chocolatiers et de quakers 585 . George Cadbury fonde Bournville près de Birmingham en 1893, imité en 1901 par Joseph Rowntree à New Earswick et Joseph Fry à Bristol. Bournville et New Earswick sont des cités-jardins qui expérimentent quelques-unes unes des idées progressistes de l'époque en matière d'urbanisme, notamment la complémentarité de la vie industrielle et campagnarde et la coexistence des classes sociales 586 .
Bournville en particulier suscite un fort intérêt public. La cité est conçue selon un plan aéré et diversifié. Aucunement réservée exclusivement aux seuls salariés de l'industriel, elle réunit des habitants de conditions sociales diverses. Bournville fusionne pratiquement l'infrastructure productive et la philanthropie privées avec le service public 587 . George Cadbury s'implique corps et âme dans sa conception et sa vie quotidienne, convaincu de l'impact matériel, social et moral favorable de la cité-jardin sur l'ouvrier et sa productivité, ainsi que des potentialités de généralisation de l'expérience pilote. Bournville fait effectivement école à travers l'Angleterre et à l'étranger 588 . Les leçons dégagées par l'expérience influencent considérablement la politique de logement de l'époque jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Au revers de la médaille, les loyers assez élevés excluent les familles les plus nécessiteuses 589 . La cité-jardin dépasse néanmoins le caractère palliatif de la philanthropie victorienne pour aborder à leur racine les problèmes sociaux liés à l'industrialisation.
* * *
Le paternalisme développé aux Etats-Unis (welfare capitalism) dès le dernier quart du XIXe siècle ne distingue pas formellement le patronage du paternalisme. A l'instar de ses variantes européennes, le paternalisme américain est une stratégie patronale défensive : il justifie l'influence de la grande entreprise dans la vie sociale. Le paternalisme ambitionne l'amélioration des conditions de la productivité, la fixation de la main-d'oeuvre, la prévention d'une intervention gouvernementale et de l'activisme syndical. La stratégie est également normative. Elle brosse un idéal-type de l'ouvrier, caractérisé comme travailleur, économe, sérieux, endurant, propre, intelligent et loyal 590 . Le paternalisme américain voue un soin tout particulier au logement ouvrier 591 . L'instruction élémentaire ou technique s'accompagne d'enseignement religieux ; des caisses de pension suppléent aux carences publiques alors que la vie récréative n'est pas en reste. Les ouvriers sont parfois associés aux décisions de la direction ou détenteurs d'une part du capital social de la société. L'assistant social de l'entreprise (welfare secretary) fait part de ses expériences à ses pairs lors d'assemblées professionnelles nationales 592 .
L'immensité du territoire américain explique tant l'occurrence que certaines modalités paternalistes. Comme en Europe, le secteur minier américain reconnaît précocement les vertus du logement ouvrier. Plus spécifique en Amérique du Nord, la formidable expansion dans les années 1870 du réseau ferroviaire amène les ouvriers constructeurs de voies ferrées à passer souvent la nuit sinon en rase campagne, du moins dans des conditions très précaires. Epaulées par la Young Men's Christian Association (YMCA) 593 , les compagnies ferroviaires développent alors le modèle de railroad rest house 594 . Ce logement sur rails offre non seulement le gîte et le couvert, mais aussi des salles d'eau, une bibliothèque, des équipements sportifs. Divers cours y sont dispensés.
L'expérience américaine la plus célèbre au XIXe siècle en matière de cité-usine (company town) est également au crédit d'une société de chemin de fer. Suite à une importante grève qui paralyse ses ateliers de construction de wagons-lits, George Pullman entreprend la construction dès 1880 de Pullman City. Implantée à proximité de Chicago, la cité-usine s'ordonne méticuleusement autour d'une fabrique moderne et bien aérée, d'un forum commercial et administratif couvert et d'une église. Elle s'enorgueillit de systèmes d'assurance maladie, d'écolage, d'épargne et de crédit. Elle propose à l'ouvrier et à sa famille une bibliothèque et un théâtre tout comme une riche vie associative. En 1886, la ville compte 1'800 logements et environ 10'000 habitants. Contrairement à la plupart des entrepreneurs européens, Pullman entend tirer un profit comptable régulier de la cité-usine. L'objectif financier renchérit les loyers et favorise les pratiques autoritaires ou népotiques dans l'octroi de dégrèvements. Pullman City faillit ainsi à son but premier. Une grève éclate en 1894 pour dénoncer les graves problèmes de gestion de la cité-usine. L'expérience est peu imitée 595 .
L'activisme syndical motive grandement le développement d'initiatives sociales par l'entreprise américaine. A la fin du XIXe siècle, patronat et syndicats s'entrechoquent durement. Le patronat cherche à diviser et déstabiliser le mouvement syndical. L'enjeu porte moins sur les conditions de travail que sur la souveraineté de la direction sur l'organisation sociotechnique du travail. La résistance ouvrière à l'innovation technique et organisationnelle est férocement combattue, à l'exemple de la sanglante crise «luddite» qui éclate en 1892 dans l'usine Carnegie Steel de Homestead 596 . La stratégie de division de l'opposition ouvrière entraîne l'essor du syndicalisme d'entreprise durant le premier conflit mondial. Conjugué à l'intéressement ouvrier aux bénéfices, le paternalisme contribue à la castration de l'agitation syndicale 597 .
L'action des pouvoirs publics stimule également l'essor du paternalisme. La promulgation en 1890 des lois antitrust aiguillonne le grand conglomérat. En dette d'image sociale vertueuse, la Standard Oil, l'United States Steel ou l'International Harvester se font dès l'aube du XXe siècle les chantres d'une bruyante responsabilité sociale 598 . A l'échelon national, un Committee on welfare work incite dès 1916 les entreprises au respect de conditions minimales de travail. Ce travail de promotion se poursuit sous l'administration Wilson 599 . La carence de prestations sociales publiques constitue une autre raison à la l'initiative privée. La législation américaine en matière d'assurance accident se développe timidement dès 1902 au niveau des Etats fédérés ; la jurisprudence fédérale admet seulement en 1936 le principe de la caisse maladie et de pension, ainsi que de l'assurance maternité 600 . Aussi la pression endossée par l'entreprise privée américaine est-elle forte. Le welfare capitalism atteint ainsi son apogée au milieu des années vingt 601 au travers de initiatives sociales à caractère toujours plus pratique -- soins médicaux, retraite. La Crise de 1929 lui assène un coup fatal, si bien que la plupart des programmes sociaux sont abandonnés avant la Deuxième Guerre mondiale 602 .
La vigueur de la croissance de l'industrie manufacturière américaine entre 1865 et 1900 est exceptionnelle 603 . La période atteste comme nulle autre dans l'histoire capitaliste du dynamisme entrepreneurial. Les Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, John Rockefeller et autres John Morgan personnifient aujourd'hui encore l'archétype de l'entrepreneur. Ceci dit, l'empreinte du magnat industriel américain du tournant du siècle est des plus ambiguës. En témoignent les termes qui le désignent usuellement -- baron voleur (robber baron) ou tycoon 604 . Son audace et sa pugnacité sont louées par les uns, sa rapacité et son luxe tapageur conspués par les autres 605 . Les deux lectures sont plausibles. Une certitude : le magnat industriel est immensément riche.
L'opinion publique américaine se forge peu à peu son opinion. Au début du second XIXe siècle, le succès économique porte en ses débuts une aura de vertu morale qui tendrait à exonérer l'industriel de toute autre justification 606 . La fortune colossale et le train de vie parfois fastueux du baron voleur, pour ne pas évoquer ses pratiques d'affaires souvent douteuses, lui valent bientôt une impopularité croissante. La perception s'affirme dès la grande Dépression des années 1870 et se cristallise dans les lois antitrust de 1890. Les intellectuels, romanciers ou universitaires, alimentent la sourde hostilité envers ces hommes d'affaires 607 .
Le baron voleur déploie plusieurs lignes de défense. Narcissique et pleine d'espoir pour les masses, la première évoque le parcours personnel de l'industriel par la référence aux valeurs victoriennes de vertu, d'abnégation et d'élévation morale personnelle. Elle confère à son épopée une valeur d'exemple à suivre 608 . Ou bien l'argumentaire du magnat est typiquement puritain, fataliste et bienveillant : la richesse résulte du talent en affaires ; ce talent est un don de Dieu qui doit être mis en valeur pour servir la collectivité. L'ère de grand progrès technique appelle enfin à une justification d'ordre «scientifique». Le darwinisme social d'Herbert Spencer 609 pose la cupidité comme nécessité de l'existence, le succès industriel comme la récompense du plus habile et la preuve de ses capacités. Rockefeller exprime l'idéologie avec lyrisme :
« La croissance d'une grande entreprise est simplement un exemple de la survivance du plus apte [...] La rose de beauté américaine ne peut avoir toute la splendeur et tout le parfum qui réjouissent le spectateur que si l'on sacrifie les premiers boutons qui l'entourent. Ce n'est pas une conséquence mauvaise propre aux affaires. C'est simplement une conséquence d'une loi naturelle et d'une loi divine 610 . »
De telles justifications trompent peu leur monde. Le richissime Carnegie n'affirme-t-il pas qu'« entasser des millions, c'est de l'avarice, non de l'épargne 611 . »
Son célèbre Evangile de la richesse 612 pose les fondations idéologiques d'une philanthropie «scientifique». Selon Carnegie, la personne fortunée est le dépositaire et l'administrateur d'une richesse servant le bien commun. La carrière de l'industriel se partage entre l'acquisition et la distribution de richesses. L'héritage, la donation à la puissance publique ou la charité représentent de piètres actions philanthropiques. L'aide à des institutions d'utilité publique leur est préférable 613 . En 1865, Carnegie est un jeune millionnaire âgé de trente ans. Il multiplie son avoir par plus de cent mille jusqu'à sa mort en 1919, mais tient partiellement parole en matière philanthropique 614 . Ses donations soutiennent surtout l'enseignement supérieur et la recherche universitaire aux Etats-Unis comme au Royaume-Uni. Il soutient en outre 2'800 bibliothèques publiques ainsi que 7'700 paroisses dans l'acquisition ou la rénovation de leurs orgues 615 . Ses libéralités s'entourent du même battage médiatique qui vante ses succès industriels, ce qui a le don d'irriter ses concitoyens. A l'instar de Rockefeller, Carnegie crée une fondation afin de coordonner son action sociale et de perpétuer sa mémoire 616 .
La philanthropie du magnat industriel n'a pas au tournant du siècle le caractère désintéressé que son large spectre le laisse supposer. Le soutien à l'enseignement universitaire et à la recherche scientifique servent indubitablement les intérêts industriels du donateur 617 . Face à la vieille bourgeoisie, cette philanthropie valorise sociologiquement le magnat et compense peut-être psychologiquement un intime complexe d'infériorité en matière éducationnelle. La religiosité parfois ostentatoire de l'industriel conforte son argument selon lequel son talent d'essence divine servirait la communauté 618 . Le soutien à la grande presse contribue à redresser l'image du baron voleur. Enfin le soutien aux arts rappelle le mécénat de la Renaissance qui associait le donateur à la magnificence de son époque. Au bilan, la philanthropie du baron voleur apparaît comme une justification facile de sa fortune, destinée moins à contribuer au bien commun qu'à glorifier son auteur 619 . Une telle conception de la responsabilité sociale pèche indubitablement par sa forte dissociation entre la création et la distribution de richesse, entre une grande dureté en affaires et une philanthropie palliative et cosmétique.
-
Du paternalisme à l'ère de la rationalisation (1900-1930)
Les principes managériaux couchés à la Belle Epoque par Henri Fayol dans L'administration industrielle et générale rompent avec la personnalisation du pouvoir directionnel des régimes du patronage et du paternalisme 620 . Son analyse est précise, sèche et froide. Il l'humanise quelque peu lorsqu'il évoque l'autorité du dirigeant d'entreprise. Selon lui, l'autorité statutaire tient à la fonction, alors que l'autorité personnelle est faite « d'intelligence, de savoir, d'expérience, de valeur morale, de don de commandement, de services rendus, etc. 621 » Le bon chef sait conjuguer autorité statutaire et personnelle. En vain rechercherait-on dans l'ouvrage une réflexion d'envergure sur la politique sociale de l'entreprise. L'ère de la rationalisation ne gomme pourtant pas de ses préoccupations le facteur humain.
Pour Frederick Taylor, l'organisation des hommes serait pour lui plutôt un sous-produit d'une organisation méticuleuse du procès de production. Il reconnaît dans ses Principes d'organisation scientifique la nécessaire communauté d'intérêts qui lie le patron et ses ouvriers, tout comme il recommande instamment l'introduction graduelle de ses méthodes. L'organisation scientifique du travail et la formation technique de l'ouvrier stimulent la coopération et l'harmonie sur la place de travail et élèvent la productivité. L'ingénieur se fait juge de paix. Grâce à la neutralité de son savoir scientifique, il arbitre et adoucit la confrontation entre le salariat et le patronat 622 . L'ingénieur contribue activement à la paix sociale d'autant plus que l'élévation du salaire ouvrier réduit les disparités de revenus observées au début du XXe siècle 623 . Le projet sociétal taylorien implique une « complète révolution des mentalités » patronales et ouvrières : l'autorité patronale ne s'exerce plus dans une relation de pouvoir, mais dans l'administration des choses 624 .
Les idées tayloristes nourrissent les âpres débats sur l'organisation industrielle qui animent l'Europe du début du XXe siècle. Elles rencontrent un terreau fertile dans le courant intellectuel de rationalisation et d'américanisme qui croit au potentiel pacificateur de l'organisation scientifique du travail. La paix sociale américaine semble donner raison à Taylor. Les esprits européens acquis au taylorisme sont tout d'abord d'obédiences politiques diverses, séduits par le progrès économique et social promis par ce mode de production. L'éclatement de la révolution bolchevique radicalise les socialismes européens et les éloigne de Taylor. Dans les années vingt, l'organisation scientifique du travail conserve les faveurs des élites politiques et économiques de tendance conservatrice 625 . Dans la vie industrielle, la paix du travail promise par le taylorisme se concrétise à grand peine et surtout n'induit pas la paix sociale.
Le projet de société échafaudé par Taylor fait long feu. L'organisation scientifique du travail aggrave les problèmes psychiques de l'ouvrier. L'obsession rationalisante et la tristesse foncière du milieu usinier entraînent des pertes d'efficience et des troubles de santé détectés dès la fin du XIXe siècle par le médecin hygiéniste, l'ingénieur social ou l'ergonomiste du travail. Ceux-ci redéfinissent alors les conditions de travail, l'effort physique et l'espace usinier. Ils intègrent au calcul de productivité notamment la qualité d'hygiène, de sécurité et de prévention au travail. L'intégration de critères psychotechniques à la logique de rationalisation rencontre en France un accueil des plus réservés parmi le patronat 626 . La grogne ouvrière face à l'introduction des méthodes tayloristes porte sur trois points principaux. L'élévation des cadences de travail se calque sur le potentiel des meilleurs ouvriers, d'où un stress permanent pour les moins performants 627 . L'ouvrier dénonce la déqualification professionnelle qu'entraîne une parcellisation extrême du processus productif. Il doute enfin du report sur le niveau salarial de la productivité accrue de son travail. Ces trois objections s'avèrent largement justifiées en pratique.
Il est plusieurs explications aux sombres retombées sociales du taylorisme. La critique économique du taylorisme pointe les coûts très élevés des études préalables, ainsi que le caractère aléatoire des gains de productivité découlant de la division accrue des tâches. La critique sociologique met en avant le caractère chimérique du one best way taylorien et du postulat de rationalité humaine qui le sous-tend. La critique culturelle est voisine du précédent argument, mettant en cause l'universalité des principes tayloristes. Quant à la critique politique, elle fustige le manque de concertation entre concepteurs et exécutants et surtout dénonce l'idée selon laquelle le taylorisme induirait la paix du travail. Taylor dira un jour : « Là où je suis passé, les syndicats n'ont pas de raison d'être. » Ses méthodes d'organisation positionneraient chaque ouvrier selon ses exactes compétences et satisferaient ainsi ses aspirations 628 . Plus fondamentalement, on peut douter du caractère «scientifique» de tels principes de gestion érigés en lois exactes et en axiomatique d'une nouvelle science, le management 629 .
Le taylorisme représente néanmoins une innovation organisationnelle majeure qui permet l'accroissement de l'ordre, de la certitude, de la stabilité, de l'efficacité et de la productivité du travail. Il se voudrait également une innovation sociale par le dépassement du clivage historique entre le patronat et le salariat. La foi de Taylor en une société technocratique n'est pas sans apparentement avec les idées saint-simoniennes, encore qu'il place aux avant-postes l'ingénieur et non pas l'industriel comme Saint-Simon. Le rôle clé dévolu à l'ingénieur dans la constitution d'un ordre social nouveau peut surprendre l'esprit contemporain. Elle s'inscrit alors dans l'air du temps 630 et correspond au vécu d'ingénieur de Taylor.
Le taylorisme innove en déclarant son incompatibilité avec le paternalisme qu'il considère suranné et superflu 631 . Si les deux doctrines recherchent l'augmentation de la productivité industrielle, leurs moyens divergent notablement. Le taylorisme considère la rémunération économique comme l'expression ultime de la responsabilité sociale de l'industriel alors que le paternalisme considère plus largement la condition ouvrière. Le taylorisme côtoie pourtant longtemps le welfare capitalism. La grande entreprise américaine au début du XXe siècle déploie souvent simultanément les deux stratégies, jouant sur leurs complémentarités plutôt que sur leur antinomie. La trop sèche organisation scientifique du travail s'humanise grâce à des mesures sociales de type paternaliste. Le fordisme tente la synthèse du paternalisme et du taylorisme.
* * *
Le phénoménal succès industriel d'Henri Ford à la Belle Epoque tient-il aux méthodes de Taylor enrichies de la production à la chaîne ? Si le raccourci n'est pas dépourvu de pertinence, il force considérablement le trait. Taylor et de Ford partagent le même constat initial de gaspillage de matière, de temps et d'énergie. Le constructeur automobile aborde par exemple la gestion des ressources naturelles non pas dans le souci de leur préservation, mais de réduction des coûts superflus 632 . A l'instar du taylorisme, le fordisme vise à l'augmentation des rendements par une meilleure organisation 633 . Les deux hommes n'évacuent pas le progrès social de leurs préoccupations. Ils le conçoivent comme l'effet obligé de la réorganisation industrielle. Tant Taylor que Ford formulent un projet de société articulé autour de l'entreprise et de son organisation. Enfin, les deux férus d'organisation sont convaincus de l'universalité d'application de leurs principes.
Le taylorisme et le fordisme diffèrent sensiblement sur plusieurs points. Dans la formulation de son projet de société, Taylor considère la seule gestion de la main-d'oeuvre. Il compte sur la fonction d'arbitre de la relation salariale assumé par l'ingénieur et ne doute pas de l'effet redistributif sur les salaires de l'augmentation de productivité. Ford repense quant à lui l'entièreté du procès de production dans une optique de production et de consommation de masse. La standardisation des pièces et le travail à la chaîne permettent d'énormes gains de temps et de substantielles économies de main-d'oeuvre, par-là l'abaissement des coûts de production. Si seulement cinq cent à mille ouvriers suffisent au fonctionnement d'une usine, estime-t-il, disparaîtront alors toutes sortes de problèmes sociaux liés à la concentration usinière, tels que l'insalubrité des faubourgs industriels ou l'insuffisance des moyens de transport 634 . Le doublement des salaires fait participer effectivement l'ouvrier aux bénéfices d'une productivité accrue. L'ouvrier est désormais également un consommateur potentiel. Son nouveau pouvoir d'achat est magnifié par l'abaissement des prix de vente. Le fordisme assure ainsi la réduction des inégalités et la paix du travail.
Le taylorisme et le fordisme divergent encore quant à la valorisation des compétences de la main-d'oeuvre. Par l'usage de critères psychotechniques, l'embauche «scientifique» tayloriste tend au darwinisme social. Ford travaille lui à l'intégration et à la complémentarité sociales. Son entreprise est un melting pot, un creuset apte à dissoudre les particularismes et les antagonismes culturels. Les écoles d'entreprise des usines Ford de Detroit assurent à la main-d'oeuvre fraîchement immigrée des connaissances linguistiques et techniques de base, tout comme elles facilitent son intégration culturelle dans la nation américaine. Ford ambitionne d'employer chacun selon ses compétences, physiques et intellectuelles. L'industriel se targue de n'écarter aucune demande d'emploi pour cause d'invalidité, car la parcellisation extrême des tâches et le travail à la chaîne permettent d'intégrer même un ouvrier infirme dans le procès productif. La fabrication de ses automobiles est décomposée en 7'882 occupations, dont 4'034 n'exigent pas de validité corporelle complète. Les usines Ford embauchent ainsi de nombreux personnes amputées ou mutilées aux jambes ou aux mains, des aveugles, borgnes, sourds-muets, épileptiques. On confie même des opérations de serrage manuel de boulons à des hommes alités, mais pouvant se tenir assis. Le fait peut paraître anecdotique. Ford en dégage pourtant de profondes implications : « L'industrie organisée en vue de l'intérêt général fait disparaître la nécessité de la philanthropie 635 . »
Au revers de la médaille, la parcellisation extrême du travail dans les usines Ford n'a d'égal que sa monotonie, chichement combattue par la rotation des hommes sur les postes. Une telle mobilité fonctionnelle est peu coûteuse, car près de la moitié des postes ne requièrent pas plus d'un jour de formation 636 . Plus problématique est par contre la très faible loyauté du personnel à l'entreprise. Dans un premier temps, Ford introduit en 1914 un système d'intéressement de l'ouvrier aux bénéfices de l'entreprise. Ce régime entend parallèlement stimuler la moralité ouvrière, car le versement de primes n'intervient que si l'ouvrier démontre son sens de l'épargne et la qualité de sa vie privée à l'inspecteur qui effectue une visite à son domicile 637 . Ce système inquisiteur et suranné est rapidement abandonné 638 . En 1914 toujours, Ford lance son célèbre « Five dollars a day ! », soit environ le doublement du salaire journalier, assorti de la limitation à huit heures du temps de travail quotidien 639 . Son bénéfice est quadruple. La productivité du travail est multipliée par huit. Sa main-d'oeuvre se montre immédiatement plus fidèle 640 . L'ouvrier peut envisager l'achat d'un exemplaire du modèle T 641 . Enfin la pertinence et la légitimité de l'action syndicale sont affaiblies.
On peut lire dans l'évolution de la politique salariale de l'industriel l'aveu de l'anachronisme du régime de patronage du XIXe siècle appliqué à la grande usine moderne. L'Hôpital Ford et l'Ecole pratique Ford reprennent à Detroit dans les années vingt les complémentarités instituées par le patronage entre l'initiative privée et la politique publique 642 . Complémentarités épurées de considérations religieuses et enrichies d'une nouvelle ambition. Le fordisme transforme l'ouvrier en un consommateur de la production de masse, court-circuite le marché par l'achat en fabrique et spécule sur un effet d'entraînement qui mènerait à une société d'abondance. Sa politique sociale vise au recul de l'absentéisme et du freinage, à la réduction des incidences négatives sur la productivité des maladies, accidents et autres grèves. Elle n'a rien d'une philanthropie désintéressée, car elle découle des impératifs du travail à la chaîne.
Henri Ford formule même un projet de société dans lequel la grande entreprise jouerait un rôle de premier plan 643 . La paix du travail qu'elle assure en son sein engendre la paix sociale. Elle est le fer de lance d'une nouvelle compétition pacifique entre les nations qui met la guerre hors-la-loi 644 . Le projet sociétal fordiste est typique de la Progressive Era que connaissent alors les Etats-Unis. Les initiatives privées du citoyen américain tentent de réaliser ce que les politiques publiques ne parviennent à achever. Ce bel optimisme tourne court avec la Crise de 1929, mais le modèle productif fordiste accompagne le XXe siècle occidental jusqu'aux années septante.
* * *
Dans les années vingt, Ford supplante Taylor dans les discussions au sujet de l'organisation industrielle parmi les élites européennes. Sa vision d'une société d'abondance est toutefois plus un justificatif idéologique qu'un objectif politique 645 . Tant le taylorisme que le fordisme sont repris en Europe dans leur acception restreinte de mode de production plutôt que de modèle de société. Depuis la fondation en 1898 de la firme Renault-Frères 646 , le constructeur automobile Louis Renault ne fait pas mystère de son intérêt pour le taylorisme. Il applique à titre expérimental la division poussée du travail et le chronométrage dans quelques-uns de ses ateliers, ce qui lui vaut en 1906 une première grève de protestation ouvrière. Guère ému par l'incident, l'industriel étend l'application de ces méthodes productives après sa rencontre en 1911 sur sol américain avec Taylor et Ford. Renault est discret, taciturne, exigeant envers lui-même comme vis-à-vis de son personnel. Le règlement d'usine est tatillon. De nouvelles grèves éclatent en 1912 et en 1913, que l'industriel laisse pourrir plutôt que de résoudre par la négociation. Son autoritarisme s'avère payant, puisqu'il devient alors le premier constructeur français d'automobiles 647 .
Renault est un esprit libéral convaincu. L'industriel rejette par exemple toute participation directe des ouvriers aux bénéfices de l'entreprise. Son libéralisme est néanmoins empreint d'humanisme pour exclure tant l'autoritarisme borné que le paternalisme misérabiliste et bonhomme. Dans le climat politique tendu d'avant-guerre et au vu de la piètre qualité de vie matérielle et morale dans les banlieues ouvrières, il préconise « un peu plus de socialisme d'action en faisant un peu moins de socialisme d'idée 648 ». S'il ne tolère aucune contestation de son autorité patronale, sa politique sociale éveille ses ouvriers de la communauté d'intérêt qui les lie au patronat. Louis Renault se distingue notablement d'un André Citroën : « Pour le premier, l'ouvrier est le collaborateur sans qui rien ne peut se réaliser ; pour le second, c'est un enfant qu'il faut guider 649 . »
La politique sociale de Renault jusqu'en 1920 n'est pas sans rappeler le patronage éclairé préconisé par Cheysson. L'analogie n'est pas fortuite. De la deuxième industrialisation émergent au début du XXe siècle les industries de transformation comme le secteur automobile. En écho à la première vague de construction de logement ouvriers réalisée dès 1860 par la sidérurgie lourde et l'industrie minière du Nord et de l'Est français, l'industrie automobile développe des initiatives sociales 650 . En réponse aux déficiences des programmes publics d'instruction générale et technique, Renault crée notamment une filière interne d'apprentissage. Il se montre concerné par la qualité de vie de sa main-d'oeuvre. L'acquisition en 1919 d'une partie de l'île Seguin, voisine de ses usines de Billancourt, offre à l'ouvrier un espace naturel de détente. Les associations sportives Renault s'y installent, les jardins ouvriers y fleurissent. L'industriel favorise l'essor de cercles associatifs ouvriers sans s'immiscer dans leur gestion 651 . Gêné par les exiguïtés de Billancourt, il conçoit en 1918 une ville usine au Mans. Six cent maisons ouvrières jouxtent l'usine. La cité est pourvue d'une infrastructure médicale, d'une coopérative de consommation, de restaurants, d'une garderie d'enfants, d'installations sportives et culturelles. La réalisation du projet est ajournée par la difficile conjoncture d'après-guerre 652 .
La cité du Mans se matérialise un peu dans «Michelin-Ville» ou Clermont-Ferrand en Auvergne. Les frères André et Edouard Michelin s'y établissent en 1887 pour redresser l'entreprise familiale. Edouard marque l'entreprise de son empreinte. Il est séduit par les principes tayloristes, croit en l'Eglise et en l'Armée dont il tire les valeurs de moralité, de discipline et d'austérité. Il entend éduquer techniquement et moralement sa main-d'oeuvre par la fondation d'écoles d'entreprise. Il met sur pied de multiples oeuvres sociales. Les premières cités ouvrières sont bâties en 1909 ; elles s'étendent presque sans discontinuer jusque dans les années septante, avec pour apex les années vingt et soixante 653 .
 Encadré 5 : Du patronage au taylorisme
Encadré 5 : Du patronage au taylorisme
En procurant l'emploi, le logement, l'éducation et la santé à sa main-d'oeuvre, l'industrie automobile française du début du XXe siècle s'inspire en droite ligne du régime de patronage du siècle précédent. Le rapprochement n'est pas fortuit. Le contexte social français du début des années 1920 évoque celui du milieu du XIXe siècle. L'heure est à la confrontation. Les mots d'ordre syndicaux préconisent l'action directe et la grève générale, encouragés par la révolution bolchevique en Russie et par la radicalisation spartakiste en Allemagne voisine. L'industrie automobile n'achève toutefois pas le degré de contrôle de la main-d'oeuvre atteint par la sidérurgie ou l'industrie minière lors du second XIXe siècle. La maturation de la conscience ouvrière ne s'accommode plus d'un encadrement trop moralisateur ou d'un culte paternaliste, tel que l'avait compris Cheysson en recommandant un patronage éclairé.
2° La main visible de la puissance publique (1930-1975)
L'effondrement des cours de la bourse de New York lors du «jeudi noir» de novembre 1929 marque une césure historique et symbolique en matière de responsabilité sociale de l'entreprise. Elle rend compte brutalement des limites de l'autorégulation marchande et de l'action privée 654 . Les coûts sociaux de la Crise de 1929 sont énormes 655 . Aussi la part des dépenses sociales publiques dans le PNB, stagnante depuis les années 1880, augmente-t-elle significativement durant l'entre-deux guerres dans de nombreux pays occidentaux. Une coalition d'acteurs publics et privés entreprend la réforme de la vie économique. La puissance publique arbitre désormais d'une main plus ferme et plus visible les relations industrielles. Avec de sensibles variations nationales il est vrai, l'Etat définit plus souverainement les droits et les devoirs des acteurs économiques, les modes de négociation entre partenaires sociaux et la portée de leurs décisions. Aux Etats-Unis, le New Deal du président fraîchement élu Franklin Roosevelt instaure une régulation plus fine et plus centralisée des relations industrielles qu'en Europe 656 . L'Etat fédéral américain ménage cependant parfois assez d'autonomie locale pour permettre des expériences de démocratie industrielle dont il garantit les principes de fonctionnement -- bonne foi, exécution des décisions 657 . Le New Deal rooseveltien et plus tard la Grande Société de John Kennedy sont des moments historiques exceptionnels durant lesquels le secteur privé appuie délibérément l'interventionnisme étatique afin de stimuler les réformes économiques 658 .
La date de 1929 ne marque certes pas un tournant absolu dans le rapport de l'entreprise avec les pouvoirs publics. Le dernier quart du XIXe siècle émet déjà toute une série de signaux avertisseurs au secteur privé. Aux Etats-Unis, les premières restrictions publiques aux affaires sont élaborées dès les années 1880 dans un climat social toujours plus critique envers la grande entreprise. En 1893, une panique boursière ébranle les places de Vienne, Paris, Londres, Francfort, New York. Malgré l'opposition d'une fraction du patronat, les législations sociales nationales régulent toujours davantage le marché du travail. Le renforcement du dirigisme étatique durant la Grande Guerre et suite à la révolution bolchevique russe est apprécié plutôt positivement par l'opinion publique 659 . L'Etat se fait plus énergique en Allemagne et en Angleterre qu'en France, en Suisse ou aux Etats-Unis 660 . L'année 1929 confirme ainsi abruptement une tendance déjà mature.
Les politiques économique et sociale publiques trouvent une nouvelle cohérence au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. L'Etat se fait keynésien et providence, entrepreneur et promoteur de la solidarité sociale 661 . La croissance économique équilibrée sans chômage ni inflation, la réduction des inégalités de revenus, la protection sociale publique par des solutions assurantielles, collectives et obligatoires, l'élargissement de la fourniture publique de biens et de services collectifs sont autant d'objectifs politiques qui concourent à la mutualisation des bénéfices et des risques liés à l'activité économique 662 . La gouverne publique sur l'économie se renforce. Le keynésianisme justifie l'interventionnisme étatique en pointant les puissants effets des politiques monétaire et fiscale sur la stabilité macroéconomique, la croissance économique et le niveau d'emploi 663 . L'Etat keynésien et providence fonde ses réalisations d'après-guerre sur une vigoureuse croissance économique qui ne s'essouffle que dans les années septante.
Acte fondateur de l'Etat-providence d'après-guerre, le plan Beveridge est adopté en 1943 par le Parlement anglais. Il innove par son traitement global de la question sociale, posant le chômage comme la source de tous les risques sociaux. Il promeut non pas une solidarité sélective comme le système bismarckien 664 , mais non discriminatoire et nationale. Fort de l'expérience sociale douloureuse des années trente, le plan Beveridge institue un plan centralisé de sécurité sociale financé par l'impôt, un système national de santé et une politique économique de plein emploi. Il instaure une planification rigoureuse de la production industrielle, des investissements et du marché du travail 665 .
L'influence des idées de William Beveridge est considérable sur le double plan synchronique et diachronique. A l'exception des Etats-Unis, les pays occidentaux développent et institutionnalisent dans l'immédiat après-guerre leurs politiques sociales à l'échelon national. En France, le projet de Sécurité sociale est d'inspiration anglaise, mais reste inachevé. Les pays nordiques, la Suède tout particulièrement, portent le plus haut l'idéal de justice sociale qui sous-tend l'Etat-providence 666 . L'influence du concept bévéridgien est perceptible tout au long des trois décennies de vigoureuse croissance économique d'après-guerre. Il occasionne le gonflement générique des budgets sociaux publics 667 . Les droits du travail se développent, la couverture sociale se diversifie avec pour postes principaux la santé et l'assurance vieillesse 668 . L'application du concept bévéridgien ne va pas sans mal. En Grande-Bretagne, l'élection d'un gouvernement travailliste en 1964 traduit le désir de davantage d'Etat et d'un meilleur Etat 669 . Si le premier objectif est largement atteint, la réalisation du second s'avère beaucoup plus problématique.
Quant au secteur privé, il tente d'actualiser les modalités de sa responsabilité sociale. En matière d'organisation du travail, les principes fordistes entraînent la rigidification des procédés de production de masse, ce qui augmente d'autant l'attrait du travail en atelier. Le patronat de la grande industrie relève alors le difficile pari du maintien à l'usine de l'ouvrier qualifié alors même qu'il restreint son autonomie. La France développe durant l'entre-deux guerres de nouvelles politiques patronales de stabilisation de la main-d'oeuvre : formation interne, grille de salaires favorisant l'ancienneté, soutien au logement ouvrier en milieu urbain ou périurbain 670 .
L'empreinte croissante de l'Etat en matière économique et sociale suggère corrélativement l'amenuisement de l'influence du secteur privé hors de ses tâches productives. Le raisonnement est pertinent, mais simplificateur. La responsabilité sociale de l'entreprise se transforme par la multiplication des acteurs sociaux qu'elle affecte et par l'évolution des attentes sociales à son égard. Le capitalisme managérial qui s'affirme au XXe siècle distingue le manager du propriétaire, se fait plus imposant et plus ambigu dans ses rapports avec les pouvoirs publics. La croissance en taille de l'entreprise va de pair avec celle de sa visibilité sociale, d'autant plus que certains partenaires de l'entreprise se découvrent un activisme inconnu jusqu'alors. La Crise de 1929 maltraite particulièrement le petit investisseur privé. Si son influence concrète sur les décisions de la direction demeure longtemps encore des plus discrètes, il prend peu à peu conscience de ses droits et de sa force collective. De façon similaire, les premiers groupements de consommateurs américains s'affirment dès les années soixante en tant que partenaires de la grande entreprise. Plus fondamentalement, l'opinion publique n'attend plus de l'entreprise qu'elle supplée aux carences des services publics par un encadrement paternaliste de sa main-d'oeuvre ou par le financement d'infrastructures collectives. Avec l'Etat pour guide et arbitre, le secteur privé est tenu dans l'après-guerre de contribuer au progrès économique et social, au maintien de la paix et de la stabilité sociales 671 .
Le secteur privé ne proteste pas tant contre cette mise sous tutelle, car la croissance économique d'après-guerre dégage les ressources suffisantes à la concomitance du progrès économique et social. L'entreprise répond partiellement aux attentes par le «vieux» compromis fordiste -- l'augmentation conditionnée de la productivité et de la rémunération du travail pour assurer la paix du travail. Sur un plan commercial par contre, Henri Ford ne jouit du reste pas longtemps du sa vision prémonitoire de l'avènement de la société de consommation de masse. Son obsession de la standardisation l'incite à produire une palette très restreinte de modèles et d'exécutions au risque de surestimer l'homogénéité des goûts de consommation. Ford perd son bras de fer commercial avec Alfred Sloan, directeur de General Motors, qui diversifie sa gamme de modèles afin d'élargir sa clientèle. Consolation peut-être pour Ford, Sloan conçoit la responsabilité de l'entreprise dans les termes du compromis fordiste 672 . Certains tentent de l'améliorer. Enrichies de récents travaux de psychosociologie du travail et de l'organisation, de nouvelles techniques managériales visent simultanément à l'efficacité et la satisfaction du travailleur. Les expériences de démocratie industrielle se multiplient, mais interviennent dans une période économique trop faste pour remettre véritablement en question le compromis fordiste. En externe, la grande entreprise polit son image de marque par la qualité de ses produits et son service après-vente.
3° Vers la citoyenneté de l'entreprise (1975-2000)
Le double choc pétrolier des années 1971 et 1973 et le marasme économique ultérieur anéantissent la conception prévalante du progrès : demain ne sera plus forcément meilleur qu'aujourd'hui ; le progrès économique et social ne vont plus nécessairement de pair. La crise n'est pas conjoncturelle mais structurelle. « [L'institution étatique] est le totalisateur des tensions sociales qui traversent les formes structurelles 673 . » L'évolution des politiques publiques témoignent du revirement. Le consensus keynésien s'érode, faute de la croissance économique qui l'a nourri pendant trois décennies. L'effectivité des politiques nationales de relance macro-économique décroît. L'Etat-providence n'est plus un projet porteur ; il n'est plus un guide d'action ou une motivation de puissance 674 . Jusqu'à la fin des années septante, il oeuvre à satisfaction en matière de couverture sociale, d'éducation et de santé. Son action concourt également à la lutte contre le paupérisme, à la réduction des inégalités sociales et à l'intégration socio-économique des citoyens. Dès les années quatre-vingts, les dépenses sociales de l'Etat stagnent puis diminuent, ce qui réduit la couverture sociale publique. L'approche mutualiste de la solidarité sociale perd progressivement du crédit au profit de solutions assurantielles individuelles 675 . Les inégalités sociales s'accroissent durant les années quatre-vingts dans les pays de l'OCDE, et en particulier aux Etats-Unis et au Royaume-Uni 676 . Au prix de lourds coûts sociaux, les programmes de relance du président américain Ronald Reagan et du Premier ministre britannique Margareth Thatcher libéralisent pendant cette période le cadre régulatoire de l'activité économique 677 .
La décennie questionne à nouveau la responsabilité sociale de l'entreprise. Le phénomène affecte d'abord les pays anglo-saxons avant de se diffuser parmi les pays industrialisés 678 . En Europe, les collectivités publiques développent plusieurs types d'action. L'étude approfondie assortie de recommandation en est une, exemplifiée en Angleterre par la publication au début des années nonante des rapports Cadbury et Greenbury. Les dispositions qu'ils préconisent en matière de gouvernance d'entreprise et de gestion de l'environnement sont partiellement relayées par le Combined Code en vigueur actuellement. La réglementation représente une autre réponse possible. En France, une loi de 1977 instaure pour la grande entreprise l'obligation de publier un bilan social aux fins de stimulation du dialogue entre partenaires sociaux 679 . Les lois Auroux de 1982 réitèrent l'obligation de principe -- et non de résultat -- d'un dialogue social au sein de l'entreprise. Dans les enceintes internationales, certains esprits se préoccupent de ménager aux pouvoirs publics une crédibilité et une efficacité d'action suffisantes 680 .
Au Royaume-Uni, le néolibéralisme thatchérien stimule l'activisme de groupements de la société civile qui pressent la grande entreprise à étoffer sa responsabilité sociale et sa transparence opérationnelle. Celle-ci développe ses initiatives sociales en continuité avec la solide tradition philanthropique victorienne. La réflexion sur les normes, la mise en oeuvre, le compte-rendu et le contrôle relatifs à l'impact social et environnemental de l'entreprise est particulièrement avancée. En France, la relation de la grande entreprise avec son milieu se dégrade lentement mais sûrement jusqu'au milieu des années quatre-vingts. Le patronat tente en 1986 d'améliorer son image publique sous la bannière de l'entreprise citoyenne. Il se préoccupe alors davantage de la formation de la main-d'oeuvre et de l'insertion sociale de l'entreprise. Mais la récession économique, la pression financière croissante et la concurrence accrue sur les marchés mondialisés incitent nombre d'entreprises à réviser à la baisse la définition de leur responsabilité sociale 681 . Le Mouvement des entreprises de France (Medef) appelle à présent à une « refondation sociale » synonyme de dérégulation du marché du travail 682 . Certaines entreprises développent nonobstant de belles initiatives sociales 683 , aidées en cela par la sensibilisation, sinon la pression croissantes du grand public.
Somme toute, la grande entreprise souffle le chaud et le froid depuis les années quatre-vingts. Elle considère souvent la dérégulation sociale ou les coupes sombres d'effectifs comme conditions sine qua non du maintien de sa compétitivité. Elle met en oeuvre simultanément des techniques managériales de valorisation de l'humain et de ses compétences. L'entreprise requiert du travailleur davantage de flexibilité, de responsabilité et de productivité 684 . Elle redouble d'attention envers sa clientèle 685 . La philanthropie de l'entreprise se développe dans un sens toujours plus stratégique, finement étudiée dans ses moyens, son ampleur et son groupe social cible 686 . Dans ce contexte naît l'affirmation citoyenne de l'entreprise contemporaine.
Bilan historique
Qualifié selon le groupe social qui l'anime, le capitalisme est financier et marchand dans ses traits préindustriels du XVe au XVIIIe siècles, puis entrepreneurial et industriel au XIXe siècle. Le capitalisme prend un tour managérial durant le XXe siècle pour tendre actuellement vers un caractère financier et institutionnel. Le régime préindustriel marque l'essor de la société marchande. Le travail à façon qui personnalise et contextualise l'acte productif évolue vers une production marchande. Celle-ci distend le lien direct entre le producteur et le consommateur par l'intermédiation du marché. Dans son contexte moderne, la production n'est plus un moyen, mais une finalité qui doit séduire un consommateur peu ou pas défini 687 .
L'activité entrepreneuriale préindustrielle n'énonce pas explicitement sa responsabilité sociale. Elle entend surtout s'affirmer face aux structures économiques et politiques traditionnelles. Elle est trop occupée à développer et structurer son action productive pour comprendre son impact social. Le régime préindustriel pose néanmoins d'importants jalons. L'ordre corporatif, par sa régulation de la production et de la distribution des richesses, établit à une échelle microsociale ce que les institutions modernes tentent d'achever par leurs politiques publiques. Le capitalisme marchand et financier de la Renaissance développe un flamboyant mécénat culturel et social qui inspire le paternalisme et la philanthropie des XIXe et XXe siècles. Il façonne plusieurs traits du capitalisme moderne, tels que le travail salarié, le profit, la production et l'échange 688 .
La responsabilité sociale de l'entreprise occidentale se manifeste sous différentes formes depuis la deuxième industrialisation. Cinq d'entre elles retiennent tout particulièrement l'attention 689 : (i) Le paternalisme précurseur qu'illustrent dans l'Angleterre du début du XIXe siècle les initiatives sociales de Robert Owen, puis en France le patronage leplaysien ; (ii) le paternalisme industriel de la période 1870-1930 ; (iii) la philanthropie ostentatoire du baron voleur américain durant les années 1890-1920 ; (iv) le projet sociétal fordiste formulé au début du XXe siècle dont le compromis productif marque son empreinte la période 1930/1945-1980 ; (v) enfin la citoyenneté de l'entreprise qui s'affirme durant la dernière décennie du XXe siècle. Ces diverses initiatives de l'entreprise tentent de répondre aux défis économiques et sociaux de leur époque. Au-delà de leurs différences formelles et qualitatives, elles expriment toutes une sorte de manifeste politique visant à la réalisation du progrès économique et social.
Pour s'en convaincre, il n'est pas inutile reconsidérer les fondamentaux de l'analyse historique présentée ci-dessus. L'étude de la responsabilité sociale de l'entreprise privilégie comme facteurs explicatifs certaines variables sociotechniques (niveau technique, organisation sociale et technique du travail), des variables politiques (idéologie dominante et ses alternatives, attitude sociale vis-à-vis de l'entreprise), et des variables économiques (structure et degré de concurrence des marchés, conjoncture économique). Le pouvoir explicatif de chacune de ces variables quant à l'occurrence, la forme et l'effectivité des initiatives sociales de l'entreprise varie selon les périodes. Néanmoins, la faculté innovatrice de l'entreprise paraît constituer le facteur déclencheur majeur. Le progrès technique engendre en effet de nouveaux modes productifs qui accroissent la productivité et stimulent la croissance. Il exerce en revanche un effet profondément perturbateur sur l'organisation sociale, notamment par l'accroissement des inégalités. En plus de la philanthropie privée et des politiques sociales publiques, les initiatives sociales de l'entreprise permettent à la croissance économique de se traduire en un véritable développement économique et social. C'est ainsi que l'entrepreneuriat acquiert une triple valeur d'activité économique, d'engagement politique et de source de lien social.
La dynamique capitaliste n'est pas linéaire, mais rythmée par l'alternance de phases d'accélération ponctuées de crises de croissance 690 . Historiquement, les grandes phases de prospérité économique sont concomitantes de vagues d'accélération du progrès technique, alors que les périodes de récession puis de dépression correspondent à leur maturité et leur essoufflement. Schumpeter se fonde sur cette double constatation pour théoriser l'effet d'entraînement de l'innovation sur la dynamique capitaliste. Selon lui, les fluctuations du rythme de croissance reflètent deux moments distincts d'un même cycle économique. Sa théorie des cycles d'affaires résout l'apparente incongruité entre d'une part l'idée de croissance cumulative qui permet le développement et d'autre part l'instabilité foncière de la dynamique capitaliste. Elle repose sur l'interaction de cycles économiques de longue, moyenne et courte durée, dénommés respectivement Kondratiev, Juglar et Kitchin. Le cycle long de Kondratiev est celui qui épouse le mieux les cycles de croissance et de récession.
Schumpeter recense historiquement cinq cycles de Kondratiev, initiés par autant de vagues d'innovation. Le premier cycle débute vers 1785 avec la première industrialisation basée sur l'énergie hydraulique, le textile et le fer ; sa croissance s'infléchit vers 1815. Le second cycle est initié vers 1845 avec la diffusion technique du moteur à vapeur, du rail et de l'acier ; il amorce son déclin vers 1873 en raison de la grande Dépression. Le troisième cycle s'amorce avec la deuxième industrialisation fondée sur l'énergie électrique, le moteur à combustion et la chimie ; il décline entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Le quatrième cycle naît vers 1950 grâce aux progrès des technologies pétrochimiques, électroniques et aéronautiques ; il bute sur les deux chocs pétroliers de 1971 et 1973. Enfin le cinquième cycle aurait débuté au début des années nonante avec la troisième accélération technique basée sur les NTIC, l'informatique et les biotechnologies. Le graphique ci-contre relie ces cycles économiques avec l'occurrence historique des initiatives sociales de l'entreprise :
 Fig. 3 : Cycles économiques et responsabilité sociale de l'entreprise 691
Fig. 3 : Cycles économiques et responsabilité sociale de l'entreprise 691
L'analyse schumpétérienne s'avère précieuse dans l'identification de certaines récurrences historiques en matière de responsabilité sociale de l'entreprise. A noter tout d'abord que la durée des cycles économiques tend à se réduire, d'une soixantaine d'année pour le premier à probablement une trentaine d'années pour le cinquième. La systématisation croissante de la fonction de R&D durant l'histoire industrielle du XXe siècle expliquerait en grande partie ce phénomène, car l'effort d'innovation réduit l'espérance de vie des techniques 692 . L'accélération du progrès technique des phases de croissance découvre de nouveaux modes productifs, réinvente le travail et la relation salariale, cisaille le tissu social. Elle accroît les inégalités socio-économiques si aucune mesure politique corrective ou préemptive n'est prise. L'entreprise affronte alors un vent de contestation sociale dont elle redoute l'impact négatif sur la productivité, les ventes et sur sa réputation. En déficit de légitimité, le secteur privé imagine alors de nouveaux modes d'ancrage social qui réduisent les inégalités sociales et donc son risque opérationnel. Les innovations ainsi produites sont d'ordre organisationnel ou social, non technique. Elles concernent par exemple l'organisation sociale du travail, ou la relation de l'entreprise avec son environnement.
Les deux premiers cycles sont acquis au paradigme de la responsabilité individuelle. L'individu est capable d'actions finalisées et apte à se prendre en charge. Il est responsable de ses actes et de ses faiblesses. Le plus vulnérable peut compter de façon subsidiaire sur la générosité philanthropique du plus aisé. L'inégalité sociale est paradoxalement une source du lien social. Lors du premier cycle, les esprits sont largement acquis au libéralisme. La philanthropie est alors d'essence religieuse et morale, mais traduit un ambigu « Noblesse oblige ! » empreint de conservatisme social. Le patronat n'entreprend rien de significatif en matière sociale, hormis l'expérience sans lendemain d'Owen à New Lanark. La patronage est au milieu du XIXe siècle français une réponse défensive des élites politiques et économiques face à une situation sociale explosive. La diffusion du régime de patronage bénéficie d'une conjoncture économique favorable et de son insertion dans les politiques publiques.
La diffusion du paternalisme industriel durant le deuxième cycle économique répond à des sollicitations contradictoires. Pour une part, le paternalisme industriel contient tant bien que mal la menace socialiste qui s'affirme et prévient l'émergence de dispositions légales contraignantes. D'autre part, la conjoncture économique difficile à la fin du siècle alourdit le coût de l'encadrement paternaliste pour l'entreprise qui s'ouvre à la production de masse. Sa nécessité décroît en raison du développement des politiques sociales. Enfin, l'ouvrier regimbe toujours plus à l'idée d'une tutelle paternaliste. Aux Etats-Unis, le baron voleur n'est guère enclin au paternalisme industriel. Il lui préfère une philanthropie ostentatoire vernissée de morale religieuse.
La seconde industrialisation et le début du troisième cycle d'affaires accrédite au tournant du siècle l'entreprise à la logique de production de masse. Dans un processus plus ancien et plus lent, le paradigme de la solidarité publique émerge. L'Etat relaie peu à peu l'action sociale privée en matière de droit du travail, de protection sociale et de santé publique en s'inspirant des certaines initiatives paternalistes. Le projet sociétal d'Henri Ford représente le chant du cygne du paternalisme. Certes, l'industriel reconnaît l'obsolescence de l'encadrement paternaliste des hommes. Le bon fonctionnement de son système productif nécessite l'adhésion morale de l'ouvrier et l'élévation de son pouvoir d'achat. Mais l'entreprise fordiste reprend et amplifie la fonction institutionnelle de la cité-usine du XIXe siècle. Le compromis salarial fordiste assurerait la paix du travail, et par suite la paix sociale. La nouvelle vie industrielle fonderait une nouvelle société qui bannirait la guerre pour mieux assurer son développement économique et social.
S'il ne voit jamais vraiment vu le jour dans son intégralité, le fordisme marque le XXe siècle de son empreinte. Le compromis salarial fordiste forgé au sein de l'entreprise est un élément essentiel de la configuration institutionnelle du quatrième cycle économique qui s'amorce suite à la Seconde Guerre mondiale. Dans ce paradigme de la solidarité publique, l'Etat national assure par ses politiques la concomitance du progrès économique et le progrès social jusqu'aux chocs pétroliers des années septante. Le dernier quart de siècle est à la recherche d'un nouveau cercle vertueux qui assurerait la richesse et la cohésion des nations. Quant à la philanthropie des milieux d'affaires, elle acquiert durant le XXe siècle un caractère toujours plus stratégique ; elle est un investissement en image publique.
Les temps contemporains suggèrent le retour du paradigme de la responsabilité individuelle, du fait du délitement des solidarités publiques. La citoyenneté de l'entreprise intervient après une phase récessive et dépressive de l'économie mondiale, à laquelle a répondu une libéralisation de la vie économique. L'affirmation citoyenne de l'entreprise présente un caractère fortement philanthropique. Elle s'abreuve également aux sources du paternalisme, dans son ambition politique implicite vis-à-vis de son milieu local. L'entreprise contemporaine affronte également des problèmes sociaux inédits. Plutôt que de créer une cité-usine, il lui est demandé dans les pays industrialisés de soutenir l'action sociale publique en respectant sa prééminence. Vis-à-vis des pays en développement, l'engagement citoyen authentique de l'entreprise s'inspirerait du projet paternaliste dans sa contribution à des infrastructures sociales souvent déficientes. Il s'en éloignerait en revanche par une action sociale moins moralisatrice que formatrice et respectueuse des différences socioculturelles.
La citoyenneté de l'entreprise contemporaine affronte des problèmes d'une complexité inédite. Les groupes sociaux affectés par les activités économique sont bien plus nombreux et divers qu'au XIXe siècle. L'entreprise transnationale compose avec des marchés mondialisés et une grande variété de contextes socioculturels. Elle doit allier la cohérence globale de son action avec le respect des attentes locales. Le paternalisme est une expression de la responsabilité sociale du capitalisme industriel. La citoyenneté globale et locale de l'entreprise transnationale constitue aujourd'hui une des réponses possibles aux défis sociaux contemporains. Il serait faux de déconsidérer l'engagement citoyen de l'entreprise en raison de son caractère stratégique et défensif. Autres stratégies défensives, le patronage et le paternalisme du XIXe siècle n'en ont pas moins effectivement contribué au progrès économique et social. Leurs mises en oeuvre qualitativement très variables reflètent la grande variété de pratiques sociales regroupées sous la bannière citoyenne de l'entreprise. L'expression authentique de la citoyenneté de la société transnationale concilie autant que possible la production de richesse avec la poursuite du bien commun et la préservation de la justice sociale. Confrontée aux nouvelles modalités d'une problématique ancienne, elle considère en somme les fins privées et publiques de son action. La citoyenneté de l'entreprise représente bien un manifeste politique.
III. La citoyenneté de l'entreprise
-- REMARQUES LIMINAIRES
La première partie de la dissertation relie d'un point de vue conceptuel la citoyenneté et la responsabilité sociale de l'entreprise, sans identifier les deux notions toutefois. L'historique de la responsabilité sociale de l'entreprise effectuée dans la deuxième partie démontre que certains enjeux de la citoyenneté de l'entreprise se retrouvent à différents moments historiques, voire figurent au rang de constante dans l'évolution capitaliste. La citoyenneté de l'entreprise examine en substance la dimension politique de l'activité économique au travers de la responsabilité -- ou de l'insertion -- sociale de l'entrepreneur et de l'entreprise.
Le sixième chapitre relie sur un plan conceptuel la citoyenneté et l'entrepreneuriat pour proposer un essai théorique sur la citoyenneté de l'entreprise. Le septième chapitre s'interroge d'abord sur les motivations de l'entreprise à son engagement citoyen. Il analyse notamment le paradoxe soulevé en introduction générale quant à son contexte d'émergence. Puis sont examinées les multiples formes ou modalités de responsabilité sociale de l'entreprise, et tout particulièrement celles qui se rattachent le plus à l'engagement citoyen de l'entreprise tel que le conçoit le monde anglo-saxon. Le huitième chapitre soulève un autre enjeu fondamental de la thématique, à savoir la volonté d'autorégulation de l'entreprise transnationale au travers de l'affirmation de sa citoyenneté. L'audit social constitue à cet égard une forme allégée de contrôle social sur ses activités. Il est un phénomène mené essentiellement par des acteurs privés, censé pallier les déficiences et les lacunes régulatoires de la vie économique mondialisée. Enfin, le neuvième chapitre met la citoyenneté de l'entreprise en perspective interculturelle par l'examen de l'histoire récente du capitalisme japonais. Sur cette base, une étude de cas sur l'économie suisse et genevoise en particulier démontre que la citoyenneté de l'entreprise, conception anglo-saxonne de la responsabilité sociale de l'entreprise, ne représente pas la forme unique et incontournable de sa responsabilité sociale.
La citoyenneté de l'entreprise recoupe un grand nombre de thématiques et de débats contemporains. Il n'est pas possible ni même loisible de les aborder en détail ici. Ainsi par exemple, la gouvernance d'entreprise est un thème important à cet égard. Son analyse nous a semblé cependant trop juridique, trop technique et touffue, trop variable encore selon les dispositions légales nationales pour s'insérer harmonieusement dans la perspective plutôt sociologique qui est la nôtre. Certains de ses aspects sont traités lorsque le cheminement général de la dissertation le suggère. De façon similaire, l'éthique des affaires est abordée ci-après de façon diffuse et ponctuelle. D'autres débats contemporains sont abordés sous un angle d'analyse connexe, telle la transparence organisationnelle par le biais de l'audit social. Le rôle social de l'entreprise transnationale dans les pays en développement constitue un thème difficile à traiter autrement que par une ou plusieurs études de cas. De plus, la grande diversité des réalités socioculturelles que couvre ce thème rend toute généralisation hasardeuse. C'est pourquoi il n'est pas abordé directement ici. Enfin, la citoyenneté ou la responsabilité sociale de l'entreprise n'est en principe pas limitée aux seules grandes sociétés. La présente étude est dédiée à la grande entreprise, car celle-ci est l'auteure de l'affirmation citoyenne. A plusieurs reprises, la thématique est toutefois brièvement étendue aux PME.
6. Entrepreneuriat et citoyenneté
" Theory needs to catch up with those managers who see companies as 'corporate citizens' having specific tasks and responsabilities to fulfill in society, as do other kinds of organizations and individuals 693 . "
Le défi consiste en l'harmonisation des visées entrepreneuriales avec la souci de la durabilité du milieu social, dans la conciliation de l'efficacité économique et de la justice sociale. L'acte d'entreprendre suppose une prise de risque mesurée afin de profiter d'une opportunité d'affaires. Il est une destruction créatrice qui insuffle à la vie économique son dynamisme. L'entrepreneuriat s'insère dans un contexte social, ce qui suppose d'une part des interactions entre son auteur et la société, d'autre part une valorisation sociale attachée à cette action. La manifestation première de la responsabilité sociale de l'entrepreneur est la reconnaissance de son interdépendance avec ses concitoyens. La seconde consiste à harmoniser son action avec les valeurs essentielles de son milieu social.
L'habilité entrepreneuriale consiste à tirer parti des interdépendances d'une vie en société. La confiance permet la réduction et la mutualisation du risque inhérent à l'activité économique. Elle intervient au sein de l'entreprise par la valorisation des potentialités de chaque collaborateur. Vis-à-vis du reste du corps social, elle est possible grâce à l'institutionnalisation complexe de ses rapports avec ses divers partenaires. L'entreprise se conçoit dès lors comme partie d'une configuration d'acteurs sociaux qui concourent à son succès. Le réseau entrepreneurial est souple, modulable. Il permet à l'entreprise transnationale de pallier l'érosion de son potentiel d'innovation. Le réseau permet la minimisation des perturbations sociales générées par l'activité économique et de mieux gagner l'acceptation du coût social du progrès économique. Il fonde enfin la responsabilité sociale de l'acteur économique. C'est dire les finalités privées et publique de l'acte d'entreprendre. L'entrepreneuriat socialement responsable est une activité économique et un acte politique de gouvernance sociétale qui confère à l'entreprise sa légitimité institutionnelle.
A. L'entrepreneur et sa fonction
L'entrepreneur est un personnage insaisissable au vu tant de la grande diversité des profils psychosociologiques de ses personnifications que de l'évolution historique de son rôle économique et social. Dans une définition générique, l'entrepreneur recherche et identifie des opportunités d'affaires et de profit, rassemble les moyens productifs nécessaires, initie et dirige l'activité économique, assure enfin l'écoulement de sa production. Quant à l'acte d'entreprendre, il consiste à " mettre en oeuvre des ressources en vue de créer et de distribuer des biens et des services d'une manière profitable et cumulative, dans un milieu en évolution constante 694 . " La sémantique du mot entrepreneur et la définition précise de sa fonction ont considérablement évolué durant l'histoire. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le terme comporte plusieurs significations, économique, guerrière, juridico-légale et politique. Dans le vocabulaire économique et financier, il désigne celui qui conduit "au hasard" une action d'ampleur considérable. L'action d'entreprendre se réfère tantôt à la réalisation d'un ouvrage d'utilité publique tel un pont, tantôt à l'introduction de nouvelles techniques agricoles ou encore à l'investissement de son propre pécule dans une activité manufacturière. L'entrepreneur remplit une fonction à la fois d'évaluation, de gestion et de direction. Il est un preneur de risque calculé ; il produit une évaluation rationalisante dans un contexte opérationnel fortement entaché d'incertitude 695 .
Lors de la première industrialisation, l'entrepreneur revêt des profils personnels très différents. Il est tantôt homme de science, comme Frédéric Kuhlmann qui développe dans le cadre de son usine les applications industrielles des recherches scientifiques qu'il mène en tant que professeur titulaire d'une chaire de chimie à l'université de Lille 696 . Il est plus fréquemment un homme de métier à forte culture technique tel le maître de verrerie, un négociant comme souvent dans le secteur textile, un capitaliste tel que fréquemment dans les forges 697 . Au-delà de ces nuances fonctionnelles et personnelles, l'entrepreneur des premiers temps industriels se caractérise par la recherche de l'innovation même s'il n'en est pas forcément l'auteur : " suivre l'innovation partout où elle éclôt, et pour cela être informé "de première main" avant ses concurrents 698 . " La sempiternelle quête de l'innovation technique, organisationnelle ou sociale paraît être aujourd'hui encore la marque la plus distinctive de l'entrepreneur.
Quatre types d'entrepreneurs se succèdent dans l'histoire du capitalisme occidental 699 . Au XVIIIe siècle le fabricant-commerçant se caractérise par ses compétences commerciales plus que techniques. Privilégié par la transmission héréditaire de la propriété, l'entrepreneur est fort d'une conception autocratique de son rôle social. Au XIXe siècle, le capitaine d'industrie se distancie quelque peu de la réalité sociale de son usine. Son pouvoir s'exerce soit par la propriété de l'infrastructure productive soit par le contrôle d'une part majoritaire du capital social de l'entreprise. Il soigne sa réputation personnelle et celle de son entreprise par des mesures paternalistes vis-à-vis de ses ouvriers et de leur famille. L'entrepreneur du début du XXe siècle est un directeur salarié qui n'assume pas à titre principal les risques techniques et commerciaux. Souvent intéressé aux bénéfices et sensible à sa réputation personnelle, ce gestionnaire ambitionne avant tout à une meilleure efficacité industrielle de la société qu'il dirige. La crise de 1929 ruine cet idéal technocratique. De nos jours, l'entrepreneur revêt des profils multiples. Il n'est pas rare qu'un chercheur scientifique entreprenne le développement industriel et commercial du produit de ses recherches, à l'instar d'un Kuhlmann au XIXe siècle. Il serait plus souvent ce lanceur d'affaires qui peut se désintéresser de l'avenir de l'entreprise une fois celle-ci mise sur rails, pour dédier ses énergies et ses compétences à d'autres projets 700 . Son sens de responsabilité morale pâtit du caractère gestionnaire de sa fonction, ainsi que des multiples pressions dont il fait l'objet. Dans la grande entreprise, le leader opérationnel est plus un manager qu'un entrepreneur. L'affirmation citoyenne de l'entreprise se réfère néanmoins implicitement à l'entrepreneur, au travers de la valorisation fonctionnelle et humaine du collaborateur et de l'attention accrue portée au milieu social.
1° Théorisations de la fonction entrepreneuriale
Les premières réflexions théoriques sur la fonction entrepreneuriale sont l'oeuvre d'économistes. Dans son Essai sur la nature du commerce en général publié en 1755 701 , Richard Cantillon définit l'entrepreneur comme celui qui achète et vend à des prix incertains. Les physiocrates Turgot et Quesnay insistent pareillement sur l'élément d'incertitude et sur la prise de risque personnel de l'entrepreneur 702 . Pour évidentes qu'elles puissent paraître, ces conceptualisations de l'entrepreneur et de sa fonction témoignent d'une observation attentive et d'une réflexion sagace face à la réalité sociale figée d'Ancien Régime 703 . Le profit récompense la prise de risque. Dans son Traité d'économie politique de 1803, Jean-Baptiste Say perçoit la fonction combinatoire de l'entrepreneur, lequel tire son profit de l'arrangement des facteurs de production 704 . L'économiste français distingue les fonctions entrepreneuriale et capitaliste. Say ne débusque cependant pas la qualité première de l'entrepreneur -- sa faculté d'innovation et de création de capital au-delà de ses compétences gestionnaires. A l'instar des classiques anglais, il n'intègre pas non plus la fonction entrepreneuriale dans un cadre théorique général 705 .
Say est un des très rares économistes des XVIIIe et XIXe siècles à étudier la fonction entrepreneuriale. Encore ne saisit-il pas la contribution de l'action entrepreneuriale au dynamisme économique. Cette lacune perdure tout au long de la période classique. De Cantillon à Say et Frédéric Bastiat côté français, d'Adam Smith à Jeremy Bentham et John Stuart Mill outre-Manche, les économistes classiques et leurs précurseurs tentent de dégager des lois "naturelles" similaires à celles découvertes par les sciences exactes 706 . De telles lois se conçoivent dans une approche systémique relativement fermée et stable. Les économistes marginalistes de l'école de Lausanne, Léon Walras et Vilfredo Pareto en tête, consacrent au début de ce siècle une telle vision théorique par la formulation mathématique d'un cadre macro-économique statique d'équilibre général. L'affirmation du courant marginaliste vis-à-vis des écoles socialistes est complétée par la théorisation des équilibres partiels par Alfred Marshall. Dans ses Principes d'économie de 1891, celui-ci distingue, sans les théoriser, les fonctions capitaliste, managériale et entrepreneuriale 707 .
L'économie politique des XVIIIe et XIXe siècles boude ainsi l'étude de l'évolution économique, de ses origines et de ses processus, de ses acteurs et de leurs motivations. L'entrepreneur bouleverse un ordre établi et met à mal une conception statique ou stable de la vie économique. L'examen de son rôle économique complexifie l'explication théorique par la considération de facteurs historiques, sociologiques et psychologiques. De telles lacunes ne sont pas l'apanage du courant libéral. Dans sa vision évolutive et déterministe de la vie économique, Marx néglige également la fonction entrepreneuriale 708 . Au tournant du XXe siècle, les économistes institutionnalistes américains John Commons et John Clark approfondissent la conceptualisation du risque et du profit entrepreneurial sans ménager à l'entrepreneur de fonction opérationnelle précise au sein de leur cadre théorique 709 . Le courant institutionnaliste influence peu l'école marginaliste qui fonde la science économique contemporaine et son courant dominant néolibéral. Aussi ne faut-il s'étonner que l'entrepreneuriat soit toujours chichement théorisé par la science économique du XXe siècle, avec l'exception notable de Joseph Schumpeter 710 .
L'étymologie du terme " économie " est grecque -- oïko nomos -- et signifie littéralement " la loi de la maison ". L'économie comporte donc l'ambiguïté d'une double acception descriptive et normative : vise-t-elle à décrire ou à prescrire les lois de fonctionnement de la maison 711 ? Les économistes classiques optent pour le premier terme de l'alternative et entendent faire de leur discipline une science exacte, affranchie des pesanteurs de la morale. La philosophie des Lumières fournit le soubassement théorique à leur oeuvre. L'individu est pensé comme l'unité de base de l'organisation sociale, autonome et capable d'une action finalisée. La philosophie du droit exemplifie ce trait de la modernité occidentale en posant l'individu comme responsable de ses actions 712 . Thomas Hobbes notamment distingue la passion de l'intérêt, ce dernier reflétant la motivation rationnelle du comportement économique 713 . La théorie macrosociale des économistes classiques se situerait hors du champ social, fondé qu'elle serait sur des lois de nécessité, des forces hors de l'emprise humaine. Leur théorie microsociale s'émanciperait pareillement de la morale parce que les mécanismes de marché qu'elle décrit prendraient acte des préférences individuelles sans porter de jugement moral sur eux 714 . L'économie politique néolibérale ne s'est guère départie des présupposés des classiques.
L'économie politique est une science sociale. Elle est confrontée à l'étude psychosociologique du comportement de l'individu et du groupe social. Science sociale, l'économie politique comporte un a priori normatif. Celui de la théorisation néolibérale découle de la confiance accordée à la capacité d'autorégulation de l'individu. La liberté d'action individuelle est alors garantie par la différentiation des sphères économique, politique et scientifique et culturelle 715 . L'échange marchand est ainsi épuré, mais dépourvu de toute épaisseur sociale 716 . L'économie de marché est pourtant sous-tendue de normes, de valeurs et d'idéologies qui orientent son fonctionnement et son évolution.
Joseph Schumpeter conforte l'argument. Dès sa Théorie de l'évolution économique de 1912, l'économiste autrichien estime qu'en dépit de sa propension à l'équilibre macro-économique, le capitalisme se caractérise avant tout par son dynamisme 717 . L'évolution capitaliste n'est ni socialement déterminée ni réversible. Elle est mue par la destruction créatrice qu'exerce l'activité économique dans sa quête d'innovation. La destruction créatrice à la fois un ressort de l'évolution capitaliste, une cause de déséquilibre et un outil de remodelage social. L'instabilité notoire de la dynamique capitaliste est due à l'alternance historique de phases de prospérité et de dépression. Le capitalisme instaure un arbitrage entre l'initiative individuelle et la régulation institutionnelle par le biais notamment du crédit, du régime fiscal et la monnaie. Les institutions sont historiquement déterminées et répondent à une nécessité de coordination collective 718 . L'analyse fonctionnelle intra muros d'une institution ne capte que partiellement les enjeux sociétaux qui l'animent. Schumpeter préconise une vision intellectuelle élargie qui inclut des considérations historiques, politiques et sociales 719 .
Malgré ou en raison de son originalité, l'oeuvre de Schumpeter n'a pas suscité d'école de pensée comme Smith, Marx ou Keynes. Inspiré par les premiers économistes institutionnalistes, Schumpeter influence quelque peu le néo-institutionnalisme contemporain 720 . Quant au courant néolibéral, il n'a guère intégré les enseignements ou même les domaines d'intérêt de l'économiste autrichien 721 . L'économie politique schumpétérienne reconnaît son affiliation aux sciences sociales. Elle avalise le potentiel créateur de l'individu dans son milieu social 722 . Elle met en exergue les défis propres aux périodes de mutation sociale accélérée. Schumpeter met à l'honneur l'entrepreneur. Il souligne son rôle d'acteur social et sa fonction innovatrice dans la vie économique. Il souligne l'effet d'entraînement de son activité sur d'autres acteurs sociaux 723 . Le prise de risque indissociable de l'innovation entrepreneuriale est source de profit. Selon lui, l'innovation comporte cinq modalités 724 :
-
Un nouveau produit ou une nouvelle qualité de produit ;
-
Une nouvelle méthode de production ou de commercialisation ;
-
Un nouveau marché d'écoulement des produits ;
-
Une nouvelle source de matière première ou un nouveau bien intermédiaire ;
-
Une nouvelle structure organisationnelle dans un secteur industriel tels que l'établissement ou la perte d'une position monopolistique.
L'entrepreneur schumpétérien pèche par son imprécision conceptuelle. Dans la théorisation de l'économiste autrichien, il n'assume pas toujours l'élément pourtant déterminant de sa fonction -- la gestion durable du risque de production ou du risque opérationnel 725 . Il représente plus un idéal-type qu'une espèce humaine rare et précieuse, car la fonction entrepreneuriale n'est pas toujours en réalité assumée en continu par un seul et même individu 726 . Enfin Schumpeter définit étroitement l'innovation, pensée en termes techniques et par rapport à la fonction productive de l'entreprise. Il néglige le potentiel innovateur du réseau social qui fonde la responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis de ses partenaires. La valorisation commerciale d'une innovation suppose peut-être un coup de génie initial, un éclair de clairvoyance d'un individu. Elle requiert plus sûrement un patient processus d'élaboration et d'affinage dans lequel interviennent de multiples interactions sociales. Pour Paul Engel, l'innovation résulte d'une mise en réseau d'une variété d'acteurs dans un apprentissage collectif et cumulatif :
" Innovation is as a complex, social process -- one occurring among a variety of stakeholders -- rather than as a matter of transfer or dissemination of technologies, knowledge or ideas. [I]t can be understood as a process of unending social enquiry. [...] What social actors do to achieve innovation can be described as networking, building and maintaining relationships with others actors they deem relevant to their purpose 727 . "
2° Traits fonctionnels de l'entrepreneur
Au début de l'industrialisation, l'entrepreneur est un personnage douteux et impénétrable. Au XIXe siècle, certains de ses traits fonctionnels sont appréhendés théoriquement par quelques économistes. Dans Les Misérables, Victor Hugo esquisse en 1862 avec une perspicacité et une prescience remarquables les traits fonctionnels de l'entrepreneur de l'époque. Son "Père Madeleine" est tout à la fois capitaliste et propriétaire de ses moyens de production, gestionnaire du risque opérationnel, inventeur technique et novateur organisationnel, employeur tenu à des obligations sociales envers ses employés, homme d'affaires fortuné qui use de son prestige social pour accéder au poste de maire 728 . Au-delà de certains éléments théoriques ou d'une évocation romanesque, la fonction entrepreneuriale s'éclaircit par la considération des notions d'opportunité, d'innovation et de risque.
L'écriture chinoise convoie les notions d'opportunité et de danger sous le même pictogramme désignant l'idée de crise. L'entrepreneur identifie ou crée et saisit les occasions d'affaires dans l'évolution sociétale. Il considère le changement social comme une opportunité et une chance 729 , non comme une rupture malencontreuse ou indésirable des routines sociales. Dans son action à la fois destructive et créatrice, l'entrepreneur contribue à l'évolution sociale dans un sens favorable à ses intérêts. Si l'impact de son activité sur son milieu est trop peu significatif, l'entrepreneur tâche de tirer le meilleur parti possible de l'évolution sociale. Dans son activité, l'entrepreneur fait preuve de capacité innovatrice, de sens d'anticipation et de vision à large spectre. Rosabeth Moss Kanter résume ci-contre les conclusions d'une étude empirique menée aux Etats-Unis :
" I found that the entrepreneurial spirit producing innovation is associated with a particular way of approaching problems that I call 'integrative' : the willingness to move beyond received wisdom, to combine ideas from unconnected sources, to embrace change as an opportunity to test limits 730 . "
Une opportunité entrepreneuriale est liée à une innovation que l'entrepreneur crée, développe, modifie afin de répondre à une attente de consommation non satisfaite et de se distinguer de ses concurrents. Elle comporte un risque. Une stratégie peut se solder par un échec ou aboutir à un résultat non attendu. Elle peut aussi dégager un profit substantiel pour l'entrepreneur.
La modernité n'invente pas le risque, mais le transforme. Le risque n'a plus guère cette saveur de terra incognita des grandes découvertes. Il découle davantage des conséquences non envisagées de l'activité humaine 731 . L'ère moderne apprend à apprivoiser le risque, et le considérer moins comme un danger qu'un défi et une opportunité 732 . La notion de risque implique l'existence d'au moins deux situations ou actions alternatives. L'acteur les ordonne en une hiérarchie de contingences et leur associe l'éventualité d'un dommage ou d'un événement indésirable. Le risque intervient du côté de la partie affectée par la décision. Il comporte une dimension objective et subjective. L'acteur peut ne pas percevoir le risque encouru ou se sentir immunisé par les conséquences de sa décision. Le risque s'évalue par un calcul probabiliste des conséquences de l'une et l'autre des options 733 . Le risque est un sous-ensemble de l'incertitude. Contrairement à cette dernière, le risque est mesurable. Il est réductible par diverses solutions assurantielles qui autorisent une certaine prédiction de la situation future. Alors que la rémunération du manager d'une entreprise est fixée contractuellement, le profit de l'entrepreneur découle de sa faculté à réduire le risque encouru et à assumer l'incertitude 734 .
Il est un risque systémique, organisationnel et individuel. Le risque systémique compromet la viabilité de l'organisation sociale tout entière par un déséquilibre structurel profond comme le creusement d'inégalités sociales ou par un événement profondément déstabilisateur tel un désastre écologique de grande ampleur. Les systèmes d'assurances sociales élaborés en Europe dès la fin du XIXe siècle tentent de réduire l'agitation ouvrière qui compromet la stabilité sociale propice à l'activité économique. Fondés sur les principes de mutualité et de solidarité, les systèmes d'assurances sociales renforcent la cohésion sociale. Ils permettent la réduction du risque de troubles sociaux. Un tel système assurantiel prouve son efficacité de la fin du XIXe siècle aux chocs pétroliers des années septante 735 . Depuis lors, l'Etat-providence réduit sa couverture sociale alors même qu'augmentent l'incertitude et l'insécurité face à la mondialisation économique. La période de mutation rapide appelle à de nouvelles solutions assurantielles contre le risque social généré par l'activité économique.
Le risque organisationnel a pour principaux enjeux l'efficience productive et la définition de responsabilités individuelles au sein de l'entreprise. La minimisation du risque organisationnel intervient par l'accent porté sur la sécurité dans les processus décisionnels et opérationnels. La réduction des contingences intervient notamment au travers de la définition de principes et de procédures, de l'établissement et du respect de structures hiérarchiques, de modalités de distribution des pouvoirs et des responsabilités 736 . La réduction du risque organisationnel intervient également par la socialisation du risque économique. Des faisceaux de relations croisées entre diverses organisations engendrent des faisceaux d'engagement réciproque qui diminuent d'autant le risque de défection et qui mutualisent les risques opérationnels 737 .
Le risque personnel assumé par l'individu membre d'une organisation peut s'exprimer en termes de réputation. La réputation de l'individu nourrit le degré de confiance qui prévaut dans ses relations sociales. Le risque personnel comporte également une dimension plus objective et palpable. Celui encouru par le collaborateur dépend de la faculté à restreindre l'étendue des conséquences de ses décisions et de ses actions. Ce risque procède également de la capacité individuelle d'adaptation à l'évolution du marché du travail. Ainsi dans la société du savoir qui se dessine, l'enjeu en matière d'emploi s'exprime moins en termes de connaissances spécifiques que de maîtrise d'outils d'acquisition de compétences qui facilitent l'adaptation à de nouveaux contextes sociotechniques, organisationnels et relationnels. Ce savoir méthodologique et polyvalent ne garantit pas à l'individu un emploi. Il assure son "employabilité" (employability), soit les opportunités d'affûter ses compétences 738 .
L'innovation est la mise en oeuvre d'une nouvelle idée dans des modalités fort diverses. Elle concrétise la créativité. Elle résulte d'une recherche d'opportunité de tout type et implique la considération du changement comme une opportunité 739 . L'innovation ne découle pas forcément d'une idée de génie, pas plus qu'elle ne serait une percée technologique -- très risquée dans sa valorisation commerciale 740 . L'innovation peut être techniquement peu novatrice et néanmoins source de nouvelles opportunités entrepreneuriales 741 . L'innovation ne résulte pas non plus d'une quête rationnelle méthodique. Elle est le fruit de tâtonnements, d'essais et d'erreurs qui font également appel à l'intuition, à la passion et au rêve 742 . L'innovation ne se laisse pas capturer dans un laboratoire. Elle jaillit de partout, pour peu que les structures organisationnelles le permettent 743 . Chaque individu possède un potentiel créatif qui éclôt dans des circonstances favorables 744 . L'innovation est moins un objectif fonctionnel que la résultante d'un état d'esprit, d'une culture d'entreprise ouverte à l'idée de changement et orientée vers l'action 745 . " L'enjeu pour les organisations n'est pas seulement de mettre sur le marché de nouveaux produits et de nouveaux procédés qui leur sont associés, mais plus fondamentalement de se "réinventer" 746 . "
L'innovation de nature technique est sociale en essence. A fortiori pour une innovation de nature organisationnelle ou sociale. Celle-ci invente ou réinvente par exemple ses modes et schémas de travail, ses liens objectifs et subjectifs avec son environnement, ses interactions sociales ou même la configuration institutionnelle dont elle fait partie. Les différents types d'innovation sont liés. L'assouplissement des processus décisionnels et la valorisation des ressources humaines ont notamment pour but d'augmenter la capacité d'innovation technique. Enfin l'innovation peut se déceler dans l'environnement social de l'entreprise. Dans les modifications de sa structure, le système social lui-même peut être porteur d'innovation 747 . Le développement au début du XXe siècle de technologies à forte teneur scientifique entraînent l'essor de nouveaux réseaux d'affaires. Ceux-ci entrent rapidement en contact avec le monde scientifique -- universités, instituts de recherche, fondations privées, administrations publiques 748 .
L'innovation gagne en acceptation sociale si elle n'occasionne pas de mutation sociale radicale 749 . La destruction créatrice qu'implique une innovation technique n'en reste pas moins profondément déstabilisatrice. De nature qualitative, l'innovation sociale accompagne le progrès technique. Elle permet d'en optimiser la mise en oeuvre, ainsi que d'en prévenir ou d'en atténuer les conséquences perturbatrices. Elle réduit le risque opérationnel encouru par la création d'interdépendances sociales qui le diffusent et le répartissent. Elle alimente la confiance publique à l'égard de l'action entrepreneuriale ainsi que le capital social local. Tel est le principe sous-jacent au paternalisme du XIXe siècle. Telle peut être également la visée de la citoyenneté de l'entreprise.
3° Traits psychologiques de l'entrepreneur
L'entrepreneur est un personnage fuyant. Sa fonction économique est difficile à cerner et théorisée de façon lacunaire. Elle a considérablement évolué dans l'histoire capitaliste. L'entrepreneur n'en continue pas moins d'alimenter l'imaginaire social par sa réussite matérielle et par son côté rebelle et pionnier. Il est à la fois un mythe social et une idéologie économique 750 qui entretiennent nombre d'idées reçues. Le flou qui nimbe l'entrepreneur est accru par la grande variété de ses personnifications. La littérature théorique et empirique s'accorde cependant sur plusieurs traits de son portrait psychosociologique.
-
Motivations entrepreneuriales
Idée reçue : L'entrepreneur est guidé essentiellement par l'appât du gain. L'entrepreneur ne craint pas de s'engager corps et âme dans le projet qui lui tient à coeur, confiant en ses moyens et disposé à assumer les risques inhérents à sa réalisation 751 . L'aversion des routines et des idées reçues, le désir de création, le goût du défi et le besoin de réalisation personnelle sont ses motivations prépondérantes. L'entrepreneur n'est pas un hédoniste. La dimension onirique du profit en fait un puissant ressort du dynamisme entrepreneurial 752 . Mais l'argent intéresse l'entrepreneur dans la mesure où il permet la réalisation de son projet. Il apprécie le pouvoir en tant que moyen d'obtenir et de conserver son indépendance d'action. Son ambition sociale concerne davantage sa marge de manoeuvre personnelle que son statut social 753 .
Le moyen le plus direct de bénéficier d'une marge de manoeuvre est la reconnaissance publique de l'utilité sociale de son action. La reconnaissance sociale minimale est la confiance. L'entrepreneur n'attend guère de rutilantes décorations pour services rendus à la nation. Il valorise en revanche la confiance publique en ses facultés entrepreneuriales. Il attend la reconnaissance publique de son aptitude à effectuer les bons choix techniques et productifs, du soin qu'il peut porter à en minimiser les conséquences sociales négatives. La considération sociale de l'entrepreneur intervient sous les formes les plus diverses, du succès commercial de ses produits jusqu'à la prise de fonction politique publique, en passant par l'estime de ses pairs. La Société industrielle de Mulhouse démontre au second XIXe siècle l'effet d'émulation en matière d'initiatives sociales qu'exercent des contacts réguliers entre les milieux d'affaires. La multiplication actuelle des réseaux ou clubs d'affaires saura-t-elle s'en inspirer ?
Idée reçue : L'entrepreneur est un risque-tout. L'entrepreneur apprécie le défi plutôt que le risque. Le défi est la première étape de la réalisation du rêve. Il colore la rationalité de passion et d'émotion. Le défi permet l'expression de la créativité et valorise celui qui le relève. Il implique une prise de risque 754 . L'entrepreneur accepte le risque comme élément inhérent à son projet innovateur. Le risque s'évalue, se circonscrit et se réduit autant que possible. Il ne s'évite pas. L'entrepreneur n'est pas tant plus tolérant qu'une autre personne face au risque. Sa perception du risque encouru diffère en revanche. Il minimise le risque objectif par des mesures préventives et par sa confiance en ses moyens 755 . L'entrepreneur tend à surestimer ses facultés de contrôle des événements notamment par le rejet d'une partie de l'information en sa possession. La probabilité associée au risque est donc d'ordre statistique et subjectif 756 .
Idée reçue : L'entrepreneur est foncièrement rationnel dans son action. L'entrepreneur peut être aussi bien rationnel qu'intuitif selon les circonstances. La rationalité de l'entrepreneur est limitée. Très centré sur lui-même, l'entrepreneur définit la rationalité de son comportement par rapport à ses motivations, lesquelles apparaissent à beaucoup comme irrationnelles. Il peut préférer un travail peu lucratif et indépendant à la sécurité et au confort d'un emploi fixe. Ses motivations s'orientent vers la finalité de l'acte d'entreprendre. Aussi la rationalité de l'entrepreneur s'observe-t-elle dans l'efficacité de l'action, non dans son efficience ou sa valorisation sociale. Quant à son intuition et ses sentiments, ils transparaissent notamment au travers de sa faculté d'anticipation des changements dans son environnement 757 . Raison et intérêt d'une part, intuition et passion d'une part, sont indissociables du comportement économique.
4° L'entrepreneur dans l'entreprise transnationale
Dans un ouvrage intitulé Capitalisme, socialisme et démocratie 758 , Schumpeter soutient durant la Seconde Guerre mondiale une thèse des plus étranges. Le capitalisme serait condamné à disparaître, non pas du fait de l'étranglement de ses débouchés comme le prédit l'analyse marxiste-léniniste, mais en raison de l'érosion graduelle du potentiel innovateur de la grande entreprise. La dynamique capitaliste est autodestructrice. Les succès industriels mêmes des grands entrepreneurs tels Vanderbilt, Carnegie ou Rockefeller détruisent les fondements sociaux et moraux du capitalisme et font ainsi le lit du socialisme. L'autodestruction du capitalisme procède de quatre phénomènes 759 :
-
Le crépuscule de la fonction d'entrepreneur. La grande entreprise sclérose l'innovation technique par sa bureaucratisation et perd par-là son dynamisme. La fonction sociale de l'entrepreneur décline en conséquence.
-
La dissociation de la fonction capitaliste et managériale. La propriété ancre le sens de la responsabilité morale. La société commerciale souffre cruellement de l'irresponsabilité du manager salarié et de l'actionnariat.
-
La disparition des moyens et petits propriétaires. La concentration industrielle s'effectue par absorption des petites et moyennes unités productives. Cette tendance est poussée jusqu'à l'excès par une classe de managers soucieuse de rationalisation, mais dépourvue de vision à long terme.
-
L'hostilité sociale envers la grande entreprise. La dynamique capitaliste mine la connivence traditionnelle entre l'aristocratie et la bourgeoisie économique. L'hostilité des intellectuels envers la grande entreprise croît au vu l'ampleur des profits qu'elle réalise. Quant à la classe politique, elle répercute le mécontentement de son électorat victime des bouleversements socio-économiques.
Le capitalisme a démontré sa résilience face aux économies socialistes sans résoudre vraiment ses problèmes internes identifiées par Schumpeter. Les arguments de l'économiste autrichien présentent une pertinence certaine pour l'analyse des défis contemporains.
-
Le crépuscule de la fonction d'entrepreneur
L'abondance de la littérature managériale consacrée à la revitalisation de la fonction entrepreneuriale au sein de la grande entreprise atteste de la justesse de la mise en garde de Schumpeter. Les gourous du management vantent régulièrement une nouvelle potion miracle -- toujours critiquée théoriquement, souvent peu novatrice dans sa substance, parfois infirmée empiriquement 760 . A l'instar de Schumpeter, certains théoriciens estiment que la fonction managériale est par trop routinière pour entretenir un esprit entrepreneurial dans les grandes unités productives 761 . L'entreprise transnationale contribue en effet toujours moins à l'emploi et au progrès technique par rapport à la PME 762 .
Schumpeter voit juste en diagnostiquant le déclin du potentiel d'innovation technique de la grande entreprise. La lourdeur de sa structure organisationnelle et hiérarchique convient mal pour percevoir les opportunités d'affaires et concevoir les innovations marquantes. L'entreprise transnationale est plus efficace en matière de développement technologique. L'économiste sous-estime en revanche la faculté d'innovation organisationnelle et surtout sociale de la grande entreprise. Sa définition très restrictive de la fonction entrepreneuriale néglige la nature collective de l'innovation qui peut transcender les frontières d'une organisation. La grande entreprise peut se revitaliser par la refonte de sa culture d'entreprise et l'assouplissement de ses structures afin de permettre à l'innovation d'éclore hors des laboratoires de recherche.
Schumpeter n'imagine pas que les grandes unités productives se mettent en réseau avec des PME ou les rachètent afin de pallier le déclin de leur potentiel innovateur. L'entreprise transnationale se concentre actuellement toujours davantage sur le marketing et la distribution en confiant la fonction d'innovation à des acteurs économiques de moindre taille. Les PME assument une fonction de sous-traitance de l'innovation. Elles sont parfois créées dans le but explicite d'être rachetées par de grands groupes lorsqu'elles ont pu démontrer leur potentiel innovateur. L'entreprise transnationale peut rénover et développer ses relations avec ses divers partenaires. L'innovation est alors sociale et formule une équation de gouvernance sociétale qui mobilise une variété d'acteurs. A ce titre, le défi contemporain ne se pose pas dans les mêmes termes qu'autrefois. Lors du second XIXe siècle, le défi a consisté à créer les institutions appropriées à l'accélération du progrès économique et social 763 . Aujourd'hui, il s'agit de réinventer fonctionnellement ces mêmes institutions, dont l'entreprise. La démarche nécessite la considération des fins privées et publiques de l'acte d'entreprendre et la reconnaissance de ce que l'entrepreneuriat est à la fois une activité économique et un acte politique de gouvernance. L'idée est exprimée respectivement par Denis Segrestin et Philippe de Woot :
" Entreprendre, c'est mobiliser des moyens pour d'autres fins et selon d'autres voies que celles déjà tracées par la société. C'est du même coup s'extraire des institutions sociales pour en explorer d'autres 764 . "
" Désormais, l'acte d'entreprendre ne peut plus être mis en oeuvre d'une manière isolée. Il s'insère dans un ensemble de politiques, de stratégies et des responsabilités qui contribuent à la fois à le renforcer, à l'orienter et à le contrôler. Par rapport au XIXe siècle, il y a là une dimension nouvelle dont l'entrepreneur doit tenir compte 765 . "
-
La dissociation de la fonction capitaliste et managériale
Selon Schumpeter, la dissociation de la fonction capitaliste et managériale au sein de la société commerciale mine sa responsabilité sociale. Seule la propriété ancre le sens de la responsabilité morale. Or le manager d'une grande entreprise est un salarié, non un propriétaire. Quant à l'actionnaire, il ne possède pas les actifs de l'entreprise au même titre que l'entrepreneur du capitalisme familial 766 . Il manquerait décidément à la grande entreprise un timonier soucieux de sa bonne marche opérationnelle et de sa cohésion interne, ainsi que de la qualité de sa contribution sociale. L'argument paraît teinté d'une vaine nostalgie des temps "héroïques" des capitaines d'industrie du XIXe siècle. Il souligne cependant l'affaiblissement de l'unité d'intérêt entre les différents partenaires de la grande entreprise contemporaine 767 .
Les divergences d'intérêt entre l'investisseur et le manager font l'objet d'une attention récurrente tout au long du XXe siècle. Particulièrement vives lors de crises économiques, ces préoccupations varient considérablement en nature. Peu après le krach boursier de 1929 qui ruine de nombreux petits actionnaires, Adolphe Berle et Gardiner Means s'inquiètent de l'atomisation du capital social de la grande entreprise américaine. Ils estiment que l'actionnaire assume un risque financier sans contrôle sur la gestion de l'entreprise alors que le manager salarié dispose du pouvoir opérationnel sans prise de risque personnelle 768 . Lors des années soixante, John Galbraith affiche une préoccupation assez analogue : il estime insignifiante l'influence de l'actionnariat sur le processus décisionnel de la société commerciale. L'investisseur ne peut influencer les décisions du manager, car la grande entreprise s'insère dans une technostructure industrialo-administrative. Face à cette étroite connivence des secteurs public et privé, les milieux scientifiques et intellectuels au nom de la société civile exercent un pouvoir compensateur (countervailing power) 769 .
Dans les années quatre-vingts, une nouvelle vague de concentration industrielle aiguillée par de nombreuses offres publiques d'achat (OPA) questionne à nouveau la confiance à accorder à l'élite économique 770 . Depuis quelques années en revanche, l'actionnariat pèse davantage sur les options stratégiques et même sur le choix des membres de la direction de la société. Forts de leurs considérables investissements, les acteurs institutionnels -- caisses de pension et caisses mutuelles -- se montrent des plus actifs. L'actionnariat privé tend également à se regrouper. Les pressions exercées sur le management privilégient majoritairement la maximisation de la valeur actionnariale. Une minorité d'associations d'actionnaires oeuvre pour stimuler la responsabilité sociale de l'entreprise envers ses divers partenaires 771 . Les deux tendances s'unissent pour exiger de la direction une plus grande transparence opérationnelle. En dernière analyse, le manager ne paraît guère disposer aujourd'hui d'un pouvoir discrétionnaire. En revanche, les implications sociales de ses décisions sont sans commune mesure avec le passé vu la taille de l'organisation qu'il dirige 772 . Ses contraintes décisionnelles tendraient à augmenter au vu des exigences nouvelles de transparence formulées par l'actionnariat et le reste du corps social. Le manager se doit d'être socialement responsable, mais seulement dans les limites légales et sociales qui lui sont imposées.
-
La concentration industrielle
La vague de concentration industrielle contemporaine représente une facette d'un phénomène plus complexe de scissions, d'alliances stratégiques et de re-engineering 773 . La concentration industrielle est largement dictée par la recherche d'une nouvelle taille critique dans des marchés mondialisés. La mondialisation des marchés requiert également des structures flexibles, afin de faciliter leur adéquation continuelle avec un environnement d'affaires en mutation. La flexibilité se concrétise par la spécialisation de la production, la concentration sans centralisation de puissance et la réinvention discontinue de la dimension institutionnelle 774 . La spécialisation productive implique le recentrage sur les activités de base sur les compétences premières de la société. La concentration sans centralisation se traduit par la prolifération d'alliances souples. Celles-ci caractérisent notre époque au même titre que les fusions-acquisitions 775 .
Le re-engineering exprime pour une part la destruction créatrice inhérente à l'activité économique. L'entreprise se réforme pour accroître sa compétitivité sur les marchés mondiaux. Les restructurations internes sont souvent préemptives, c'est-à-dire qu'elles interviennent lorsque la santé financière de la société est bonne. Leur coût économique et social permet de sauvegarder la compétitivité future de l'entreprise. Par ailleurs, une partie des restructurations attestent du manque d'imagination et de vision à long terme des managers et des financiers. Le rendement économique de ces opérations est aussi limité que sont lourds leurs coûts sociaux 776 . Le constat n'est pas inédit, car les vagues antérieures de fusions ont abouti elles aussi à des résultats économiques très mitigés 777 . Du reste, l'obsession managériale du " bigger is better " perd du terrain face au " small is beautiful ". En plus d'une forte pression actionnariale, les plus grandes sociétés connaissent de sérieuses difficultés organisationnelles face à la concurrence mondiale d'entreprises plus petites et néanmoins très performantes. L'euphorie boursière pour les fusions-acquisitions s'est récemment bien tempérée 778 .
Une partie des pratiques contemporaines de re-engineering comporte un objectif financier plutôt que productif -- la réalisation d'une substantielle plus-value boursière. Même en tenant compte que l'accès aux capitaux constitue pour la société commerciale une des conditions de son succès futur, cette plus-value boursière assure davantage la rémunération de l'investisseur que la durabilité et la responsabilité sociale de l'entreprise. Autre élément d'explication, Walter Powell et Paul DiMaggio soulignent la tendance à l'isomorphisme d'organisations similaires qui ont tendance à se prendre mutuellement pour cadre social de référence. La diffusion de l'innovation procède soit par apprentissage soit par mimétisme. Le mimétisme tend à l'emporter, car il réduit l'incertitude générée par l'effet déstabilisant d'une pratique novatrice 779 . On en déduit que le re-engineering procède parfois d'un comportement moutonnier plutôt que d'une évaluation économique précise et spécifique. L'argument est conforté par l'homogénéisation qu'exerce l'enseignement des business schools sur les futurs cadres de sociétés commerciales. Leur enseignement uniformise plutôt leurs compétences gestionnaires qu'elles ne développent leur créativité.
-
L'hostilité sociale envers la grande entreprise
La contestation sociale envers l'entreprise transnationale est en recrudescence. Son symbole le plus manifeste est la mise en examen public de la plus grande société du monde, Microsoft. Celle-ci multiplie les donations philanthropiques 780 . La destruction créatrice qu'implique le progrès économique ne s'accompagne s'effectue pas d'un progrès social correspondant pour l'ensemble des partenaires de l'entreprise. Certains bouleversements contemporains sont créateurs à terme de richesse et d'emploi, d'autres sont essentiellement destructeurs. Le grand public tend à amalgamer les deux stratégies pour rejeter en bloc l'activité de l'entreprise transnationale. Celle-ci n'est pas responsable de l'intégralité des mutations sociales du moment. Ceci dit, l'entreprise transnationale tire parti des nouveaux espaces ouverts par la mondialisation et réalise des profits dont l'ampleur déclenchent l'ire sociale, alors même que sa contribution à l'emploi diminue. Les restructurations de la vie économique mondiale qu'elle stimule occasionnent de lourds coûts sociaux. Plus grave, le phénomène est en partie guidé par des motivations d'ordre spéculatif, et non entrepreneurial. Il profite pratiquement aux seuls investisseurs et hauts cadres des entreprises. Il représente en quelque sorte une " destruction destructrice ", non pas une destruction créatrice du tissu économique et social.
Le déficit de légitimité de la grande entreprise concerne également sa communication et son dialogue avec ses partenaires. Difficile, la tâche n'en paraît pas moins nécessaire 781 . Elle fait appel à la troisième dimension de l'impératif de flexibilité posé à la grande entreprise, soit la réinvention continue de sa dimension institutionnelle. Au travers de son affirmation citoyenne, l'entreprise prend conscience de son déficit de légitimité institutionnelle et entend y remédier par le renforcement de son ancrage social global et local.
* * *
Au bilan, la fonction entrepreneuriale se définit comme suit. L'entrepreneur perçoit, anticipe ou même crée les besoins de consommation et y répond de façon innovatrice. Il s'établit ainsi des compétences distinctives qui constituent son avantage comparatif 782 . L'entrepreneur arbitre les dysfonctionnements du marché en saisissant les opportunités. Il assume une fonction d'innovation technique, organisationnelle et sociale. Il remplit un rôle de leadership par l'effet d'entraînement de ses succès. L'entrepreneur contemporain n'assume pas forcément le risque financier pas plus qu'il n'est forcément féru de technique. Il assume par contre durablement le risque opérationnel lié à la production 783 . Son habileté première consiste à réunir -- géographiquement ou par une mise en réseau -- les ressources nécessaires à la réalisation du projet entrepreneurial 784 . La grande entreprise ne tue pas nécessairement l'esprit d'innovation. Pour assurer son développement et sa durabilité, elle doit réinventer ses structures et ses processus sans renier les valeurs fondamentales qui charpentent son action 785 . Son dynamisme dépend également de sa capacité à s'ouvrir sur son environnement et à tisser un réseau de liens souples avec ses partenaires.
B. Le réseau entrepreneurial
Les deux premiers chapitres ont insisté sur la dimension institutionnelle de l'entreprise. L'approche institutionnelle pèche par sa tendance au fonctionnalisme : même dépourvues de fonctionnalité pour l'entreprise ou pour la société, le freinage au travail, des luttes intestines de pouvoir ou une pollution environnementale peuvent émailler la vie d'une entreprise. Le fonctionnalisme tend en outre au statisme ; il explique mieux l'ordre que le changement social. Afin de pallier cette double faiblesse conceptuelle, il paraît judicieux de tenir compte de statuts, de pratiques et de comportements individuels ou collectifs qui, quoique non institutionnalisés, n'influencent pas moins le fonctionnement de l'organisation 786 .
L'entrepreneuriat représente une importante source d'évolution des sociétés. Il n'en est pas la seule, aujourd'hui moins qu'autrefois. Le capitalisme industriel a connu ses heures de gloire à l'époque des Carnegie, Rockefeller ou Ford aux Etat-Unis, des Cadbury, Rowntree ou Fry en Angleterre, des Schneider, Wendel ou Renault en France, des Siemens, Thyssen, Krupp en Allemagne ou encore des Mitsubishi, Mitsui ou Sumitomo au Japon 787 . Les initiatives sociales de certains de ces grands entrepreneurs ont préparé l'avènement de l'Etat-providence. Depuis 1915, l'évolution économique et sociale est plus guidée par des réalisations collectives qu'individuelles 788 . Du reste, l'entrepreneuriat n'émerge pas d'un vacuum social. Dès son plus jeune âge, l'entreprise s'insère dans un tissu économique et social ; la qualité de ce milieu et sa réceptivité à l'action entrepreneuriale conditionne grandement son succès futur 789 . L'explication théorique idoine rend compte du rôle de l'entrepreneur dans l'évolution économique, mais également de l'institutionnalisation complexe de ses rapports avec ses partenaires. Le niveau d'analyse approprié est ainsi mésosocial et la clé conceptuelle le réseau. Ce dernier permet de comprendre à la fois les facteurs de dynamisme et les enjeux sociaux de l'activité économique.
1° Définition et caractéristiques fonctionnelles
Un réseau est un ensemble de relations sociales faiblement institutionnalisées entre des individus ou des groupes sociaux qui perpétue et consolide leurs intérêts mutuels. L'horizontalité du principe organisationnel du réseau et son caractère informel sont gages de souplesse. Le réseau contraste avec les rigidités hiérarchiques sans s'affranchir toutefois des relations de pouvoir qui caractérisent toute action collective 790 . On distingue deux types d'analyse : le réseau comme outil managérial ; le réseau comme forme de gouvernance 791 .
Outil managérial, le réseau s'adresse à l'efficience organisationnelle. Il est soit une métaphore décrivant les liens informels internes à l'organisation soit un outil d'analyse de la structuration de l'organisation et de son environnement 792 . Le réseau souligne l'importance des relations interpersonnelles dans et hors de l'organisation. Dans la grande entreprise, cette conception du réseau décrit par exemple la coordination horizontale des diverses unités productives, l'organisation de cellules de travail autonomes et l'effet stimulant sur la créativité de la communication. La fonction économique du réseau est explorée par la littérature managériale qui met en exergue son dynamisme et sa souplesse d'application ainsi que sa contribution à la motivation et à l'expertise de ses membres.
Forme de gouvernance, le réseau concerne la légitimité institutionnelle. Il charpente la vie économique par les liens interpersonnels et surtout inter-institutionnels tissé à long terme 793 . Ce type de réseau décrit les nombreuses alliances stratégiques en matière de R&D, de production, de formation en emploi ou de commercialisation. Il rend également compte des relations de l'entreprise avec les pouvoirs publics et la société civile. Le réseau a ici pour fonction sociopolitique la minimisation et la ventilation sociale des coûts, des bénéfices et des risques découlant de l'innovation technique. Cette perspective reste encore relativement méconnue aussi bien sur un plan théorique qu'empirique.
Les deux approches théoriques s'accordent sur plusieurs points essentiels. Elles considèrent le réseau tant comme une source de contrainte que d'opportunité pour l'action individuelle et collective étant donné l'imbrication, la réciprocité et l'interconnexion de ses composantes. Opportunité, le réseau coordonne souplement par exemple les diverses unités productives et stimule par-là le dynamisme industriel régional. Contrainte, le réseau peut remplacer la régulation marchande ou administrative par les notions de confiance, de tolérance et de réputation. Enfin, les deux conceptualisations conçoivent l'identité individuelle comme une construction sociale complexe. L'action de l'individu s'apprécie par la considération de ses rôles sociaux multiples et de leur interaction mutuelle 794 . Le réseau-gouvernance intègre le mieux l'idée d'une interaction de l'entreprise avec ses partenaires et d'une conception sociale de l'innovation. Le processus d'innovation représente implique souvent une variété d'acteurs dans un apprentissage collectif et cumulatif.
La mise en réseau des divers partenaires suppose une forme de régulation sociale de leur interaction. Elle prend pour postulat la perception mutuelle de l'interdépendance des acteurs et pour métaphore le contrat social. Concrètement, le fonctionnement politique d'un réseau social s'observe sous une triple perspective. Le réseau résulte d'une convergence graduelle des intérêts des acteurs qui permet l'action collective. Alternativement, le réseau est une coalition de ressources en vue d'une performance conjointe. Enfin le réseau entrelace divers canaux communicationnels d'échange d'idées et d'information. Loin de s'autoréguler, ces formes d'organisation sociale soulèvent des questions aiguës de leadership et de gouvernance 795 . Le mode de régulation du réseau est spécifique -- ni hiérarchique ni marchand. Il se distingue du principe hiérarchique par la relative autonomie et l'interdépendance de ses membres. Il se différencie du marché parce qu'il panache les principes de coordination et de compétition 796 . La confiance arbitre ce moyen terme entre hiérarchie et marché et réduit ainsi les risques opérationnels et relationnels 797 .
La confiance lubrifie les relations sociales par sa logique solidaire 798 . Elle réduit le risque interpersonnel et exprime des qualités morales de vertu et de responsabilité individuelles Au niveau mésosocial, la confiance facilite la coordination et le contrôle en situation de forte incertitude et de grande complexité. Elle génère la légitimité de l'entreprise qui la promeut. Mark Granovetter souligne combien un réseau économique faiblement institutionnalisé peut générer de la confiance 799 . Celle-ci s'épanouit lorsque les accords économiques s'insèrent dans une structure élargie de relations personnelles et de réseaux sociaux. Le réseau social augmente le coût de défection pour ses membres par l'effet de réputation. Il renforce les normes de réciprocité, facilite la communication et l'information. Le réseau réduit davantage le risque social qu'un lien fortement institutionnalisé tel le contrôle interne, l'incitation pécuniaire ou encore l'instrument contractuel ou légal.
2° Evidence historique et pertinence contemporaine
La conception du réseau en tant que forme de gouvernance a trouvé une évidence empirique au travers de l'explication du dynamisme de certains tissus régionaux de PME au niveau technologique et à la productivité élevés. Dans The Second Industrial Divide 800 , Michael Piore et Charles Sabel soulignent le dynamisme économique régional ou local d'Italie du nord (Emilie-Romagne), du Sud-ouest allemand (Baden-Wurtemberg), de la France (Alsace, Lyon, Roubaix), d'Allemagne (Solingen) et des Etats-Unis (New York, Philadelphie). Ces succès industriels régionaux ou locaux ont en commun la mise en réseau d'acteurs économiques. Ils sont le fruit d'un heureux mixage de stratégies coopératives et compétitives des firmes, de flexibilité et d'institutionnalisation de leurs relations, de solidarités religieuses, intra- ou inter-ethniques. Les pouvoirs publics locaux jouent un rôle important de stimulation et d'encadrement soit par la mise à disposition de l'infrastructure productive et de services, soit en facilitant la coordination des différents groupes ou encore par des structures institutionnelles d'accompagnement des mutations du marché du travail 801 .
L'évidence empirique d'un tel dynamisme régional a donné naissance aux théories de la spécialisation flexible, des clusters ou des districts industriels. Le district industriel 802 est davantage qu'une simple concentration géographique d'unités productives. Il consiste en un réseau de PME liées par leur proximité géographique ainsi que la nature similaire ou complémentaire de leurs activités. La coopération entre les entreprises découle de la perception de leur interdépendance mutuelle. La compétition concerne les prix, la qualité et le design des produits ainsi que la rapidité et la flexibilité de l'exécution. La productivité du travail dépend grandement des compétences techniques et de la flexibilité de la main-d'oeuvre, ainsi que du climat de confiance interpersonnelle qui se dégage d'une saine émulation 803 . Le district industriel représente une sorte d'alternative de modèle fordiste de production dans son mode de génération de l'innovation. Alors que la grande entreprise fordiste s'efforce de contrôler la dynamique innovatrice pour sa production de masse, la faible institutionnalisation du district industriel facilite la souplesse et la permanence de l'occurrence de l'innovation 804 .
Le dynamisme économique des districts industriels se confirme dans les temps récents 805 . A en croire Maxine Berg, la vitalité des PME trouve de nombreux antécédents historiques dès le XVIIIe siècle. Cette vitalité aurait été plutôt inégale au cours de l'histoire industrielle anglaise, avec pour temps forts les phases de mutation des structures productives. Alfred Chandler estime qu'au-delà de ses fluctuations temporelles et géographiques, la contribution des PME au développement des sociétés industrielles a été substantielle. Vis-à-vis des plus grandes unités productives, les PME ont développé des stratégies tantôt compétitives tantôt coopératives, faisant valoir leur souplesse organisationnelle et leur forte capacité d'innovation :
" Innovation in product was often more rapid in the pygmies rather than the giants of an industry. For a number of industries, there is a strong case for arguing that there was a period during the eighteenth and nineteenth centuries when more market power was held by smaller and medium-scale firms than before or after 806 . "
" Others forms of entreprise [than large-scale firms] have been also essential to economic progress. Small and medium-sized firms have probably been of more significance than large ones in stimulating growth in labor-intensive and service industries. Furthermore, [...] small firms have been vital ingredients in the clusters and networks organized around large industrial firms in the capital-intensive industries 807 . "
Le réseau économique se concrétise, outre à travers les grappes de PME organisées en districts industriels, dans les liens d'affaires qui unissent les petites et les grandes unités productives ou encore dans l'organisation interne de la grande entreprise. Dans leur étude historique des relations industrielles, Piore et Sabel identifient quatre types de réseau particulièrement dynamiques 808 :
-
Le district industriel, dénommé également conglomérat ;
-
L'entreprise fédérée, aux fortes interdépendances ;
-
L'entreprise "soleil", autour de laquelle gravitent diverses firmes satellites ;
-
L'entreprise manufacturière, organisée en une variété de petits ateliers.
Le keiretsu japonais exemplifie l'entreprise fédérée 809 . Quant aux modèles de l'entreprise "soleil" et manufacturière, ils décrivent la structure organisationnelle de l'entreprise transnationale occidentale. Celle-ci se revitalise par des alliances souples de partenariat. Elle combine le dynamisme innovateur des PME avec les ressources financières et humaines de la grande firme. L'entreprise transnationale occidentale s'inspire en outre du modèle de l'entreprise manufacturière par la décentralisation de sa structure productive.
Depuis deux décennies, le réseau a crû en importance comme en variété. Son objet concerne aussi bien des questions financières, la R&D ou la production. La coopération peut être désormais aussi bien intra- qu'intersectorielle, revêtir la forme tant d'une alliance stratégique que d'un partenariat social avec un acteur public ou une ONG. Une même firme peut être engagée dans un ou plusieurs réseaux de coopération. Le réseau stimule le dynamisme innovateur de la grande entreprise et réduit ses coûts d'adaptation par la détection précoce des modifications de goûts, des avances technologies et des nouveaux produits ainsi que par l'ajustement rapide des processus productifs. L'essor contemporain du réseau confirme le déclin du modèle fordiste caractérisé par l'intégration verticale de la chaîne productive dans une structure organisationnelle monolithique. L'avenir de l'entreprise, quelle que soit sa taille, semble se décliner en une variété de partenariats stratégiques avec des acteurs privés ou publics 810 . La durabilité de l'entreprise suppose l'ouverture de celle-ci à ses divers partenaires.
3° La théorie des partenaires de l'entreprise
La considération de partenaires de la société commerciale autres que l'investisseur a une origine américaine. Dans l'entre-deux guerres, elle paraît prématurée à Berle et Means 811 . Elle bourgeonne dans les années soixante, puis s'épanouit durant la décennie quatre-vingts au travers de l'approche politologique et sociologique de l'entreprise 812 . La théorie des partenaires d'entreprise (stakeholder theory) est une vue systémique de la firme et de son environnement social qui postule la complexité et le dynamisme de leur interaction. Elles comporte deux variantes 813 :
La théorisation est sociologique et normative lorsqu'elle se base sur le jeu effectif des relations sociales et sur leur soubassement philosophique. Les partenaires de l'entreprise sont définis par l'effectivité et la légitimité de leur lien avec celle-ci. L'entreprise est dès lors moralement tenue de faire preuve de responsabilité et de comptabilité vis-à-vis de ses différents partenaires.
La théorisation est managériale et empirique si elle se focalise sur l'entreprise et sur sa comptabilité sociale. L'entreprise identifie elle-même par des critères qui lui sont propres les groupes sociaux dont elle entend tenir compte. Les canaux d'information et de dialogue ou les partenariats que l'entreprise établit avec ses partenaires s'inscrivent dans un but stratégique de réduction du risque social qu'elle encourt dans ses activités.
La première approche se rattache au concept anglais de responsability, alors que la seconde exprime l'idée de responsiveness. L'affirmation citoyenne de l'entreprise est éminemment morale en essence, ce qui la rattache à l'approche théorique normative. Celle-ci définirait dès lors l'idéal vers lequel tend l'approche managériale qui reflète la réalité économique. L'entreprise interagit en permanence avec un environnement socialement hétérogène. Elle est partiellement apte de choisir ses interlocuteurs et de définir les relations qu'elle entretient avec eux. L'entreprise s'ouvre sélectivement aux attentes sociales et aux contraintes exercées par la configuration institutionnelle dont elle fait partie. Ces contraintes s'actualisent dans la vie de l'entreprise au travers des stratégies personnelles ou groupales de ses partenaires 814 .
Le partenaire de l'entreprise influence l'activité de l'entreprise comme il est influencé par celle-ci. Il est un relais entre l'organisation et l'environnement social large. Il informe l'entreprise des attentes du groupe social qu'il représente tout comme il véhicule les intérêts de l'organisation dans la société. " Bras allongés de l'environnement face à l'organisation, les relais sont aussi les agents de celle-ci dans l'environnement 815 . " Il contribue à la création de valeur et à la réduction du risque opérationnel. Le partenaire assure l'utilité organisationnelle par la mise à disposition de ressources tangibles ou intangibles en vue de la création d'une plus-value. Il contribue également à la légitimité institutionnelle par son soutien politique, médiatique ou moral. Ces deux contributions permettent la réduction du risque opérationnel dans ses dimensions respectivement économique et sociale. Le tableau en page suivante synthétise les contributions principales des partenaires de l'entreprise à sa durabilité.
| Tabl. 3 : La contribution des partenaires de l'entreprise |
| |
Création de plus-value |
Réduction du risque opérationnel |
| Actionnaire et créditeur |
Capital financier |
Participation au capital social et aux liquidités en capital |
| Manager |
Compétences managériales, leadership |
Gestion et réduction du risque opérationnel |
| Collaborateur |
Force de travail, savoir-faire |
Fidélisation de la main-d'oeuvre
et augmentation de la productivité |
| Acheteur et consommateur |
Pouvoir d'achat |
Sécurisation des débouchés commerciaux |
| Relations d'affaires |
Matières premières, biens intermé-diaires, savoir-faire |
Sécurisation des filières productives |
| Communauté locale |
Infrastructure physique, légale et sociale |
Soutien politique, médiatique et moral |
| Pouvoirs publics na-tionaux et grand public |
Infrastructure physique, légale et sociale |
Soutien politique, médiatique et moral |
| Environnement naturel et générations futures |
Ressources naturelles |
Durabilité de l'activité économique |
La prise en compte des intérêts des divers partenaires de l'entreprise satisfait des visées morales et managériales. Elle témoigne de la responsabilité sociale de l'entreprise et assure la réduction du risque opérationnel qu'elle encourt. La démarche suppose autant que possible la conciliation, mais surtout à la hiérarchisation des diverses attentes sociales. Elle s'effectue en quatre temps : l'identification des partenaires de l'entreprise selon les critères de leur légitimité et de leur force politique ; la considération des valeurs, des attentes et des intérêts de ces groupes sociaux ; le choix des moyens de communication et des modalités de dialogue avec ceux-ci ; enfin le déploiement de stratégies en vue de satisfaire au mieux ces groupes sociaux 816 .
Quant aux modalités d'interaction de l'entreprise avec ses différents partenaires, elles s'inscrivent dans un objectif de durabilité des ressources et de l'activité économique. Le développement durable assure la couverture des besoins actuels sans compromettre celle des générations futures. Le développement durable vise à l'efficience économique, sociale et écologique en tirant parti de l'interdépendance de ces trois dimensions. La notion est ainsi beaucoup plus riche que la prise en compte de la finitude des ressources naturelles. Elle comporte en effet pour principes cadre l'efficience économique, la prudence écologique, la justice sociale, la solidarité intergénérationnelle, la diversité culturelle, l'aménagement équilibré de l'espace, la citoyenneté et la concertation. Dans sa mise en oeuvre, le concept suppose notamment la coopération entre les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile ainsi que la responsabilisation individuelle et collective 817 .
L'entreprise interagit avec son milieu selon trois axes, économique, politique et social. L'entrepreneuriat comporte une dimension économique dans sa fonction de création de richesse au travers de ses relations d'affaires et dans son rapport avec sa clientèle. L'entrepreneuriat est un acte politique par sa transparence opérationnelle et son dialogue avec ses partenaires, en particulier les pouvoirs publics et les syndicats. Enfin l'entrepreneuriat comporte une finalité de cohésion sociale exprimée vis-à-vis de la société civile. La figure ci-après illustre la triple vocation de l'entrepreneuriat.
 Fig. 4 : Entrepreneuriat et citoyenneté de l'entreprise
Fig. 4 : Entrepreneuriat et citoyenneté de l'entreprise
* * *
L'entrepreneuriat allie deux clés de la psychologie humaine, le goût du risque et le besoin de sécurité. Il valorise la créativité, l'opportunisme, la capacité d'innovation, la tolérance du risque, le sens du leadership. Dans sa fonction de gestion durable du risque opérationnel, l'entrepreneur recourt à toutes les ressources disponibles pour réinventer sans cesse l'organisation. La valorisation du capital humain et social permet la production et l'entretien du savoir collectif. La démarche mobilise chaque collaborateur dans ses capacités techniques, ses facultés d'apprentissage, son intelligence émotionnelle et son savoir-faire relationnel. Elle favorise l'établissement d'un climat de confiance au sein des collaborateurs qui rejaillit sur sa réputation publique et consolide ses relations institutionnelles. L'entreprise peut également innover dans les modalités et la qualité du dialogue avec ses partenaires. Elle socialise la prise de risque opérationnel par des liens coopératifs qui font contrepoids à la concurrence sur les marchés. En cela, l'entrepreneur est moins défini par sa fonction que par un état d'esprit 818 . L'entreprise transnationale compte potentiellement autant d'entrepreneurs que de collaborateurs et même de partenaires.
Le succès de l'entrepreneur dépend de la force et de la qualité des valeurs fondamentales qui orientent son activité. Si la forme de l'organisation évolue au gré des exigences contextuelles, les valeurs clé de la culture d'entreprise sont inaliénables, car elles assurent la continuité de l'action et la durabilité de l'entreprise. La réussite de l'entrepreneur repose ensuite sur l'adéquation de ses propres valeurs avec celles de son milieu social. S'il n'a qu'une emprise limitée sur la perception publique de son activité, il peut prendre connaissance des attentes sociales à son égard, les harmoniser et les incorporer autant que possible dans son projet entrepreneurial. Le succès de l'entrepreneur dépend encore de sa capacité à minimiser et justifier les perturbations sociales induites par son action. La valorisation sociale de l'entreprise suppose que tous ses partenaires bénéficient sous des formes et à des degrés divers de son activité économique. L'entrepreneuriat nécessite en outre un cadre institutionnel adéquat. Celui-ci incite à la prise de risque productif notamment par des fonds de capital-risque. Il facilite la mutualisation de ce risque en facilitant la mise en réseau d'acteurs sociaux. Il régule par des mesures fiscales les bénéfices de cette prise de risque. Il stimule enfin l'innovation qui nourrit le développement économique et social.
La vie économique actuelle consacre l'explosion du nombre et de la variété des réseaux. Le partenariat dynamique entre grandes et petites unités productives comporte trois caractéristiques : un dynamisme technologique soutenu, une combinaison de coopération et de compétition, un point d'insertion dans une structure sociale 819 . Ce dernier point souligne l'importance de l'ancrage local de l'entreprise transnationale. Du fait de la complexité et de l'évolution rapide de ses structures organisationnelles, la grande société contemporaine ne peut plus guère concevoir son activité en vase clos et planifier au plus rigide ses processus opérationnels. Elle se doit d'embrasser une vision élargie de la fonctionnalité et de l'impact social de son activité. La délimitation entre l'entreprise et son environnement physique, économique et social perd en clarté et en pertinence 820 .
La citoyenneté est le symbole par excellence du sens d'appartenance à une communauté. Par son engagement citoyen, l'entreprise transnationale s'inspire du dynamisme et de la cohésion des districts industriels. Elle entend ressusciter l'esprit d'innovation qui l'a transformé d'un petit atelier artisanal à une PME puis à la dimension internationale 821 . Le manager de l'entreprise transnationale est entrepreneur s'il incorpore et pondère en amont de l'action productive les attentes exprimées à son égard. La hiérarchisation et le panachage d'intérêts permet l'établissement de divers partenariats plus ou moins institutionnalisés avec des acteurs privés ou publics. L'entreprise tire ainsi le meilleur parti économique des diverses contributions de ses partenaires. La pondération des objectifs d'efficacité et d'efficience, d'innovation et de durabilité fonde la responsabilité sociale de l'entrepreneur et atteste de la citoyenneté de son entreprise. L'entrepreneur socialement responsable considère les finalités privées et publiques de son action et enrichit son objectif économique de la considération du bien commun. Acte responsable de gouvernance politique et porteur de lien social, l'entrepreneuriat se fait citoyen.
7. Motivations et modalités citoyennes
La mondialisation contemporaine occasionne une reconfiguration institutionnelle. L'accroissement des flux transnationaux de capitaux, de biens et services malmène l'Etat national dans ses frontières et sape son pouvoir politique. Ses capacités financières réduites ne satisfont pas l'intégralité des besoins sociaux. La mondialisation économique s'accompagne de la diffusion plus rapide des idées qui stimule la vitalité de la société civile internationale. Pour sa part, l'entreprise transnationale jouit d'une liberté d'action nouvelle dans un espace économique global. Cette nouvelle équation de gouvernance suggère le renforcement de l'implication publique de l'entreprise transnationale et de la société civile. Sous un autre angle, la transition rapide d'un modèle de société industrielle à une société de l'information et de la connaissance, l'accélération de la mondialisation des marchés et la compétition accrue remodèlent profondément la vie économique et appellent à la compétitivité plus affûtée de ses acteurs.
La grande entreprise peine à satisfaire simultanément l'élévation des attentes sociales et des exigences compétitives. L'affirmation de sa citoyenneté constitue une possible réponse à ce défi, pour peu qu'elle ne se limite pas à quelques initiatives philanthropiques. Les motivations de l'entreprise sont de nature politique, sociale, économique, voire morale. La palette des modalités d'action citoyenne ne sont pas moins diverses, donc complexes et hybrides. Les initiatives sociales de l'entreprise font appel à ses ressources financières, matérielles et humaines. Elles concernent principalement les activités de base, l'engagement social et la philanthropie ainsi que le dialogue politique. Elles abordent des thèmes aussi variés que la protection du milieu naturel, les droits de l'homme et du travail, la gouvernance d'entreprise, la qualité et la sécurité des produits, l'éducation de base et la formation, la vie associative, sportive ou culturelle. Le choix d'un programme regroupant une ou plusieurs de ces modalités d'action citoyenne s'effectue selon un schème élaboré par l'entreprise, affiné par la considération des sensibilités et des besoins locaux.
A. Motivations citoyennes
Alors que les marchés financiers pèsent plus fortement que jamais en faveur de la maximisation de la plus-value actionnariale, certaines entreprises affirment leur citoyenneté, donc une forme de responsabilité sociale qui appelle à la pondération des intérêts de ses divers partenaires. La simultanéité des deux phénomènes est plutôt paradoxale. L'affirmation citoyenne de l'entreprise prend pour toile de fond une relecture critique de la fonction sociale de l'entreprise. Le nouveau contrat implicite qui la lie à la société appelle à un développement durable, soit la production de biens et de services accomplie dans un souci d'éthique comportementale, de conscience écologique et de justice sociale. Cet objectif est d'autant plus impératif que se délitent dans les sociétés occidentales les solidarités institutionnelles et interpersonnelles.
L'Etat-providence a produit depuis le dernier quart du XIXe siècle des mécanismes assurantiels destinés à compenser les mutations et les inégalités sociales découlant de l'activité économique. Ses prestations sociales reposent sur la mutualisation du risque social, principe qui sous-tend les solidarités jadis assumées par les réseaux corporatifs, de parentèle, de fratrie ou de proximité. La mutualité a pour corollaire obligé le sens de la responsabilité personnelle 822 . La solidarité sociétale promue par l'Etat-providence n'a pas empêché l'érosion des solidarités traditionnelles locales. L'essor de l'individualisme dans les sociétés occidentales dévalorise la responsabilité personnelle et la solidarité, au profit d'une approche probabiliste et assurantielle du risque individuel 823 . Les difficultés financières des collectivités publiques affaiblissent aujourd'hui les mécanismes institutionnels producteurs de solidarité. On assiste donc à une double crise des solidarités institutionnelles et interpersonnelles.
L'activisme de la société civile contemporaine à l'égard de l'entreprise s'est considérablement élargi et diversifié lors de ces dernières décennies. Au XIXe siècle, il visait par le militantisme syndical étroitement la défense des intérêts du travailleur 824 . Il s'attache désormais tant à la revitalisation de la sociabilité de proximité qu'à la défense des consommateurs ou encore à celle des producteurs des pays en développement. La citoyenneté de l'entreprise opère la réhabilitation de la conception civique de la solidarité conçue par la philosophie des Lumières par la promotion du potentiel cohésif de la société civile. Né de la libre association des citoyens, le secteur associatif tisse des réseaux de solidarité qui complètent les politiques publiques et la philanthropie privée. La société civile dans son ensemble n'en demeure pas moins découpée selon de multiples lignes de fracture. Par la promotion de ses buts, toute association de citoyens représente un groupe de pression qui influence plus ou moins directement le jeu politique. Si louables soient-elles, les activités d'un groupement ne sauraient ainsi prétendre à la défense du bien commun, dont la définition suppose l'interrelation complexe des multiples intérêts individuels et collectifs 825 . L'engagement citoyen de l'entreprise répond à cette variété d'attentes et de pressions sociales, sur des considérations de nature politique, sociale, économique et morale.
1° Motivations politiques
Par son engagement citoyen, l'entreprise développe sur la base de la législation en vigueur des initiatives qui tombent généralement sous la coupe des pouvoirs publics. Cette privatisation de l'action publique tend à redéfinir la frontière entre l'action privée et publique. Le défi posé au politique consiste à ménager un champ d'action à l'action privée qui complète judicieusement les politiques publiques plutôt qu'elle ne les prévient ou les contrecarre. A cet égard, le respect des dispositions légales constitue un premier garde-fou. Dans un second temps, le politique peut presser ou inciter le secteur privé à développer diverses initiatives dans le champ social défini au préalable. C'est dire la nécessité d'une consultation publique qui renseignent les autorités sur les souhaits, la volonté et les capacités du secteur privé, ainsi que les attentes et les besoins de la société civile. La démarche facilite la levée des réticences, ainsi que la définition des objectifs communs et des rôles respectifs des acteurs. Concrètement, ce dialogue est difficile à mener, car les pouvoirs publics disposent aujourd'hui d'une marge de manoeuvre restreinte à l'égard des milieux d'affaires. Ils sont plus demandeurs que souverains vis-à-vis de l'entreprise transnationale qui peut définir sa responsabilité sociale strictement selon les requis légaux, voire même exercer un chantage à la délocalisation si elle n'obtient pas les aménagements souhaités. De même, les mesures publiques d'incitation à l'engagement citoyen ne sont pas aisées à déterminer et moins encore à mettre en oeuvre. Elle peuvent revêtir la forme de subventions ou de tarifs, d'exonérations fiscales, de récompenses officielles ou encore de l'attribution de marchés de monopole. D'impact limité, ces mesures incitatrices sauraient se substituer complètement à des dispositions législatives contraignantes.
L'engagement public de l'entreprise dans le processus politique est de deux types. Direct, il concerne l'élaboration des dispositions légales. Indirect, il a trait à leur inspiration ou à leur mise en oeuvre. La distinction est fragile, comme est mince la délimitation entre l'association licite et la participation illicite de l'entreprise au processus politique. Ces deux cas de figure n'en définissent pas moins les extrémités d'un continuum au long duquel s'échelonnent les diverses stratégies politiques de l'entreprise. Tout d'abord, la stratégie politique la plus directe de l'entreprise consiste à influencer la définition des obligations légales qui lui sont opposées. Le lobbying est la stratégie la plus connue. D'autres pratiques plus occultes, telles la fraude ou la corruption, sont largement répandues et souvent efficaces dans la vie économique contemporaine. Deuxièmement, l'entreprise peut exercer un rôle consultatif défini par le processus politique, et tenter par-là d'influencer le législateur dans le sens de ses vues. Elle fait alors valoir son expertise technique dans un domaine qui la concerne et qui lui est familier. De façon plus neutre, l'entreprise peut communiquer ses expériences au politique afin d'inspirer la formulation des politiques publiques. Parmi les stratégies indirectes d'implication politique de l'entreprise figurent la collaboration ponctuelle ou le partenariat durable avec les pouvoirs publics ou la société civile. Dans une forme négative, l'implication indirecte prend le visage du freinage. Celui-ci consiste en une panoplie de stratégies dilatoires, d'esquive ou de violation de la législation en vigueur.
Le tableau se complexifie à l'analyse des initiatives sociales de l'entreprise. Celles-ci constituent parfois des expériences pilote qui inspire positivement les politiques publiques, comme l'usine de New Lanark dirigée par Owen au début du XIXe siècle en Angleterre, puis les expériences de patronage et de paternalisme industriel en Alsace-Lorraine lors du second XIXe siècle. De façon plus ambiguë, ces initiatives peuvent viser à prévenir la promulgation de dispositions légales plus draconiennes. Elles s'accompagnent alors souvent de pressions politiques destinées à maintenir à leur niveau actuel les dispositions légales. La double stratégie s'est vue parfois lors du second XIXe siècle ; elle conserve sa pertinence de nos jours 826 . L'engagement politique direct de l'entrepreneur en tant qu'élu parmi ses pairs n'est pas univoque non plus. L'histoire sociale du XIXe siècle démontre que la carrière politique de l'industriel a servi tantôt à promouvoir les idées et les réalisations sociales privées pour mieux les relayer à l'échelon public, tantôt à s'opposer à tout développement législatif contraire à ses intérêts propres. La même ambiguïté entache l'affirmation citoyenne de l'entreprise contemporaine.
Quoi qu'il en soit, les pierres d'achoppement entre les milieux d'affaires et le politique sont multiples. La société par actions résulte de l'exercice du principe démocratique de la liberté d'association. Son existence et son activité renforcent en principe l'Etat de droit par l'exercice des libertés civiles 827 . En pratique, la société commerciale se heurte souvent à la puissance publique. Aucun système juridique ne reconnaît à la personne morale des droits identiques que ceux attribués par la citoyenneté à la personne physique. Certaines grandes sociétés américaines de la fin du XIXe siècle revendiquent pourtant les mêmes droits civiques, droit de vote mis à part, que ceux garantis par la Constitution au citoyen américain. Leur argumentation est validée en 1886 par la Cour suprême américaine. Celle-ci leur reconnaît le statut juridique de «person» au regard du 14e Amendement à la Constitution, promulgué initialement pour protéger les esclaves noirs nouvellement émancipés après la guerre de Sécession 828 . Un demi-siècle plus tard, un recensement de la jurisprudence découlant de ce 14e Amendement établit que moins d'un demi pour-cent des décisions de la Cour suprême concerne son but initial, alors que plus de la moitié de la jurisprudence concerne le statut de citoyenneté revendiqué par la société par actions. Si la Cour suprême américaine révise sa jurisprudence en la matière lors du New Deal, les droits politiques accordés par le droit américain à la société par actions croissent durant le dernier quart du XXe siècle 829 .
On pourrait penser que l'affirmation citoyenne de l'entreprise contemporaine ravive une telle ambition. La fin des XIXe et XXe siècles atteste de vagues de concentration industrielle qui questionnent la légitimité de la grande entreprise. Son rapport au politique devient alors ambigu : son poids économique ne sape-t-il pas l'autorité et la force publiques ? Autre indice troublant, les deux périodes témoignent aux Etats-Unis de l'activation des lois antitrust. L'administration fédérale américaine dissout au début du XXe siècle la Standard Oil et sanctionne American Tobacco. Elle ordonne en 1982 le démantèlement de la société AT&T et prend tout récemment une décision identique à l'encontre de Microsoft 830 . L'élément n'est pas pertinent en l'espèce, car les lois antitrust ne régulent pas stricto sensu la relation de l'entreprise avec les pouvoirs publics. Elles réglementent la vie économique en sanctionnant l'abus de position dominante. Les lois antitrust sanctionnent non pas l'existence d'une entreprise dominante sur un marché, mais d'éventuelles manoeuvres qui entravent le principe de libre concurrence en vue d'asseoir et de conserver sa suprématie. Le rapport de la grande entreprise au politique n'a pas évolué significativement non plus. Les Etats-Unis reconnaissent à l'entreprise le droit d'influencer le débat politique 831 . En cela, la citoyenneté de la grande entreprise ne change rien à la situation existante.
La capacité d'influence de l'entreprise transnationale sur l'élaboration et l'application des politiques publiques nationales et locales n'est pas neuve non plus. Le risque est particulièrement élevé dans les pays en développement au vu de la fragilité de leurs institutions politiques et du poids économique conséquent de l'entreprise transnationale. Ce risque existe dans les pays plus avancés également. Les Etats-Unis représentent probablement un cas limite quant à l'implication publique des milieux d'affaires en matière de santé, d'enseignement ou encore de recherche scientifique 832 . Les pays d'Europe continentale ne définissent pas aussi largement l'engagement public du secteur privé. Du reste, l'aspect crucial est moins la limite exacte entre l'action publique et privée que les modalités précises et des dispositifs de contrôle de l'engagement public de l'entreprise. Le risque de privatisation d'une politique publique est minimisé par l'établissement de partenariats interinstitutionnels qui impliquent la société civile 833 . En somme l'engagement authentiquement citoyen de l'entreprise est moins une usurpation de pouvoir politique que l'expression de sa capacité d'action face aux lacunes institutionnelles, aux besoins sociaux et à la nécessité de protection des ressources naturelles. La citoyenneté de l'entreprise prend pour cadre institutionnel la réglementation et les incitations des politiques publiques. Elle a pour moteur et pour garde-fou l'action de la société civile.
2° Pressions sociales
La société civile occupe l'espace médian entre les secteurs privé et public d'une société démocratique. Elle se compose d'un enchevêtrement d'institutions et de groupes sociaux formés sur la base juridique de la liberté d'association, tels l'organisation non gouvernementale (ONG), l'école, l'université, le club, le syndicat, les médias, l'oeuvre de bienfaisance ou l'Eglise 834 . L'atout stratégique principal de la société civile est celui de sa souplesse -- qualité qui a pour source la diversité d'origine, l'indépendance, le caractère interchangeable et la grande rapidité de mobilisation des individus et des groupes sociaux 835 . La société civile a pour faiblesse majeure son manque de cohésion qui complexifie une action collective à grande échelle. Aussi est-il relativement malaisé de définir une attente sociale uniforme et globale à l'égard de la grande entreprise. Les diverses associations de la société civile ont néanmoins un poids politique croissant, tant sur le plan de leur nombre 836 que par l'effet d'amplification de leur influence obtenue par le biais des médias. Leur pression sur le comportement du secteur privé définit une nouvelle forme de régulation sociale, une gouvernance civile 837 .
Des attentes sociales insatisfaites sont susceptibles de déclencher l'activisme social. Dans une chaîne causale indicative, les attentes sociales d'hier sont les problèmes politiques d'aujourd'hui, les exigences légales de demain et les pressions sociales ou même les procès d'après-demain 838 . Les groupes de pression disposent d'une batterie de stratégies pour infléchir le comportement de l'entreprise : la sensibilisation de l'opinion publique, l'influence du processus décisionnel, l'action directe positive et l'action directe négative 839 . Premièrement, la sensibilisation de l'opinion publique est un travail de fond et de longue haleine. Il s'effectue principalement par un travail d'information basique. La démarche est essentielle pour comprendre l'éveil de la sensibilité du public à l'égard de la grande entreprise 840 . Deuxièmement, l'influence du processus décisionnel s'opère auprès des membres du conseil d'administration. Il s'agit de manoeuvres discrètes qui ont généralement pour but le règlement de divers problèmes de gouvernance telle une meilleure transparence managériale 841 . Troisièmement, l'action directe positive consiste en une pression concertée exercée en amont des options stratégiques par un collectif d'actionnaires lors de l'assemblée générale. Elle peut viser aussi à une meilleure transparence managériale, mais soulève plus souvent des questions plus spécifiques. Quant à l'action négative ou le boycott, elle intervient en aval de décisions stratégiques pour sanctionner un comportement désapprouvé. Stratégie la plus médiatisée, elle se prête le mieux à une action à bref délai et très ciblée 842 .
Il est au moins quatre moments de critique intense envers la grande entreprise dans l'histoire industrielle américaine. A la fin du XIXe siècle, la première vague de défiance envers le pouvoir de l'entreprise se traduit par la promulgation des lois antitrust. Le New Deal des années trente tire un deuxième coup de semonce. Enfin les années soixante et surtout septante marquent l'émergence d'une gouvernance civile par l'activisme croissant de groupements écologistes, féministes, pacifistes et anticonsuméristes 843 . L'anticonsumérisme de l'époque critique l'idée d'une croissance économique illimitée 844 , pointant du doigt l'irréversibilité des dégâts écologiques qu'elle occasionne. De ce courant critique dérive le mouvement de protection des consommateurs dont les idées pénètrent aussi bien la société civile que l'administration publique. La déclaration sur les droits des consommateurs du président Kennedy en 1962 est source d'un corpus législatif conséquent. Forts des premiers jalons posés en 1965 par Ralph Nader et son célèbre Unsafe at any Speed, les groupements de défense des consommateurs adoptent et conservent jusqu'à nos jours pour principaux chevaux de bataille la qualité et surtout la sécurité des produits 845 .
Le mouvement critique renforce les thèses de courants intellectuels tiers-mondistes qui, comme l'école latino-américaine de la dependencia, dénoncent dès les années soixante la connivence trouble de la société multinationale avec les élites économiques et politiques des pays moins avancés et l'effet disruptif de son activité sur le tissu social local. Ces points d'inflexion historiques redéfinissent chacun à leur manière les attentes sociales envers la grande entreprise. Sa perception publique est donc fluctuante, oscillant entre fascination et rejet. Lors des années quatre-vingts, la grande entreprise est un mastodonte trop sclérosé pour se revitaliser. La décennie suivante reconnaît mieux l'effet d'entraînement économique de la société multinationale par ses investissements directs, son capital technique et son savoir-faire 846 .
La vague critique actuelle s'apparente par sa forte composante civile avec celle des années septante. En revanche, les temps contemporains formulent également plus distinctement une exigence accrue en matière de transparence opérationnelle de la grande entreprise. Cette exigence découle du principe démocratique selon lequel l'exercice légitime du pouvoir suppose un droit de regard public sur celui-ci. La forte médiatisation d'accidents opérationnels ou de pratiques troubles dans les milieux d'affaires, les vives réactions sociales face à l'ampleur des marges bénéficiaires réalisées par l'entreprise dans un contexte social difficile sont autant de signes qui accréditent la thèse de l'érosion de la légitimité de la grande entreprise. Deuxièmement, l'activisme social des mouvements de défense des consommateurs a fait des émules parmi une grande variété de groupes sociaux. La conciliation par l'entreprise de leurs attentes tient alors de la quadrature du cercle. Troisièmement, la société civile occidentale agit aujourd'hui de façon plus directe envers l'entreprise. Pour une part le phénomène se déduit de l'intermédiation amoindrie des pouvoirs publics. En outre, la maturation de la culture démocratique et l'affaiblissement des solidarités traditionnelles produisent une structure sociale définie en de multiples réseaux électifs. De tels groupes sociaux ne disposent souvent pas de tribune politique formelle. Leurs revendications trouvent alors une meilleure caisse de résonance dans des stratégies d'action directe soigneusement ciblées dans leur objectif et peaufinées dans leur mise en oeuvre 847 . La large médiatisation de ces actions résulte du caractère toujours plus transnational de la vie associative ainsi que des progrès des technologies de l'information et de la communication.
Les manifestations publiques de la gouvernance civile assumée par les réseaux d'ONG interviennent essentiellement dans les pays occidentaux. Elles concernent pourtant très souvent le comportement de sociétés multinationales dans les économies en développement. L'incidence de ce décalage géographique est ambigu. Pour une part la gouvernance civile permet de pallier le déficit institutionnel et la faiblesse de la société civile qui caractérisent la plupart des pays en développement. Sous un autre angle, la gouvernance civile comporte le risque d'un biais culturel dans l'appréciation des problèmes sociaux de ces pays. Le travail des enfants exemplifie cet aspect. Moralement intolérable, il n'en a pas moins une indéniable fonction économique qui doit être prise en compte dans l'élaboration de solutions. Le biais culturel d'une action de gouvernance civile émanant des pays occidentaux est réduit par la mise en réseau d'ONG internationales et locales.
La gouvernance civile prend apparemment un tour moins conflictuel depuis quelques années. De nombreux partenariats entre organisations internationales ou ONG et sociétés multinationales voient le jour en matière de droits de l'homme, d'environnement, de santé, de développement ou d'aide humanitaire 848 . On assiste à l'amélioration parfois spectaculaire du profil environnemental et social de plusieurs grands groupes à partir d'un incident social ou d'un dommage environnemental 849 . L'initiative d'un partenariat vient plutôt du secteur privé, pour qui une collaboration avec par exemple le Worldwide Fund for Nature (WWF) constitue une belle carte de visite en matière environnementale. L'avantage comparatif d'une grande entreprise accorde une importance croissante, outre à la réputation de ses produits, à la qualité de son image institutionnelle. Pour les ONG, un partenariat conclu avec une société multinationale fournit une caisse de résonance à sa cause et occasionne un effet de domino au sein du secteur d'activité économique considéré.
La floraison des partenariats comporte plusieurs limites d'importance. La collaboration ne tient cependant pas toujours ses promesses et peut discréditer l'un ou l'autre de ses protagonistes. Le choix du partenaire est crucial. Ensuite, un partenariat conclu avec le secteur privé peut réduire considérablement l'indépendance d'opinion et d'action d'ONG ou d'organisations intergouvernementales. Pour les milieux d'affaires, le partenariat étoufferait alors la critique sociale par son endogénéisation ou préviendrait tout développement législatif non conforme à ses intérêts. L'implication croissante de la grande entreprise dans les activités de l'ONU est à considérer également sous cet angle, d'autant plus que les difficultés financières des diverses agences de l'organisation sont de notoriété publique. Malgré de tels risques et réserves, la tendance au partenariat entre le secteur privé et la société civile s'affirme aujourd'hui et se confirmera selon toute vraisemblance dans le futur.
3° Incitations économiques
La responsabilité sociale de l'entreprise lui est-elle économiquement rentable ? La réponse tient de la bouteille à encre. La majorité des études réalisées depuis un quart de siècle concluent à une corrélation positive entre les deux variables 850 . Une relation corrélative, même forte, n'implique pas forcément de lien de causalité. Aussi l'incidence positive d'initiatives sociales sur les résultats financiers n'est-elle pas établie statistiquement, pas plus que la causalité inverse 851 . La responsabilité sociale ne paie ni ne coûte forcément à l'entreprise. La relation entre les deux variables dissimule trop de facteurs mal identifiés pour qu'émerge un lien causal limpide. La considération de la vie économique et sociale n'est pas plus éclairante. L'esprit cynique relève que si une responsabilité sociale affirmée était économiquement rentable, le secteur privé l'aurait intégré davantage dans ses pratiques d'affaires. Pourtant les fonds d'investissement dit «éthiques» offrent des rendements similaires aux titres des sociétés socialement moins responsables 852 . Le débat idéologique y relatif délivre au moins une certitude : la conception néolibérale dominante considère le social essentiellement comme un coût économique, donc nie tout lien positif de causalité entre les deux variables. Dès lors, le fardeau de la preuve incomberait plutôt aux partisans de la compatibilité entre les performances économique et sociale de l'entreprise.
Les explications et les solutions sont ailleurs. Le mécanisme de marché le marché n'incorpore pas dans son calcul de performance l'intégralité du prix des ressources utilisées par l'entreprise telles que l'air, l'eau et même l'humain. Il ne considère qu'imparfaitement la finitude des ressources naturelles et les externalités sociales négatives qui découlent de l'activité économique. Par ailleurs le mécanisme de marché néglige la question de la durabilité de l'entreprise et de son milieu social. Enfin le marché n'assure ainsi pas à lui tout seul la sanction ou la récompense financière d'un comportement économique socialement responsable. L'appréciation de la performance économique et sociale de l'entreprise est fonction de la valorisation sociale de son activité par divers groupes sociaux et par suite de leur poids politique respectif. La relation entre la performance économique et sociale de l'entreprise pose donc un problème complexe de durabilité et de gouvernance sociétale que la considération de quelques variables économiques et sociales ne saurait capturer intégralement.
Conséquemment, la validation d'un lien de causalité entre la performance économique et sociale de l'entreprise dépend du rôle social attribué à l'entreprise. L'approche de la shareholder value infirme cette relation en se focalisant sur la rémunération à court terme de l'investisseur. Les initiatives citoyennes de l'entreprise représentent alors un nice-to-have ou un «luxe.» L'approche de la stakeholder value considère une responsabilité sociale élargie et la notion de durabilité. Les pratiques citoyennes contribuent ainsi à la réalisation de meilleurs résultats financiers à moyen terme.
-
Les pratiques citoyennes comme «luxe» financier. La féroce compétition économique réduit les marges bénéficiaires des entreprises et par suite ses ressources financières pour des initiatives sociales. Leur mise en oeuvre se heurte en outre à des difficultés de définition des objectifs et d'identification des groupes sociaux visés et plus encore d'évaluation précise des résultats obtenus. Il est difficile de justifier de tels programmes dans une optique de maximisation de la valeur actionnariale. Si elle voit le jour, la programmatique d'actions citoyennes est conçue comme une opération stratégique de marketing institutionnel au détriment d'une approche philanthropique. Son ampleur est fluctuante, reflétant celle des résultats financiers de l'entreprise.
-
Les pratiques citoyennes comme plus-value économique. « La performance se constate tous les jours ; elle se construit dans la durée 853 . » La compétitivité d'une entreprise prend racine dans la relation à long terme qu'elle entretient avec son milieu social. Les retombées économiques d'un degré élevé de responsabilité sociale s'apprécient par l'incorporation dans l'équation de facteurs intangibles comme la réputation et la légitimité de l'entreprise, la confiance et la motivation des collaborateurs. La difficulté de mesure de ces variables ne présage en rien de leur neutralité financière. Elles assurent la durabilité de l'entreprise, si bien qu'il convient d'en tenir compte dans la définition des stratégies opérationnelles.
Dans son expression authentique, la citoyenneté de l'entreprise se fonde sur l'approche stakeholding. La citoyenneté de l'entreprise conçoit la responsabilité sociale de l'acteur économique comme une manifestation entrepreneuriale et comme un acte de gouvernance. Son postulat est business in society et non business and society 854 , alors que son objectif est le développement durable. Elle s'intéresse moins à la performance qu'à l'efficience de l'activité économique. La citoyenneté de l'entreprise prévient par le dialogue avec ses partenaires les problèmes sociaux découlant de son activité et non à réagir tardivement à leur occurrence 855 . Elle assure la qualité et la stabilité du milieu social de l'entreprise et par-là ses performances économiques 856 . Elle permet l'efficience écologique, économique et sociale de son activité. Elle valorise ses ressources intangibles. Vision et valeurs, connaissances et compétences, réseaux relationnels et réputation organisationnelle sont pour l'entreprise des facteurs de réussite économique de plus en plus reconnus empiriquement 857 . Le dilemme entre les performance économique et sociale de l'entreprise n'a pas l'acuité qu'il y paraît de prime abord. Il est rentable à terme pour l'entreprise d'être socialement responsable, car il n'est pas de profit durable sans une croissance qui permette un développement économique et social.
* * *
L'essor contemporain de l'investissement éthique appuie l'argumentation ci-dessus, puisque il démontrerait la compatibilité du profit avec des considérations morales, sociales et environnementales. Le terme « investissement éthique » est un peu abusif, suggérant que les autres types d'investissement ne seraient guidés par aucune considération morale. Voilà une appréciation bien exagérée et radicale. L'investissement éthique s'inscrit cependant en faux contre la logique financière dominante qui considère le profit comme l'aune unique d'évaluation de la qualité d'une entreprise. A cet égard, le rapport entre le profit et l'éthique s'est ainsi inversé depuis Calvin. Alors que le réformateur légitimise au XVIe siècle le profit en vertu de sa compatibilité avec l'éthique religieuse, les temps actuels s'efforcent de démontrer la compatibilité de l'éthique avec le profit et la logique économique. En fait, l'évolution des marchés financiers témoigne davantage de l'irrationalité que de la logique de ses protagonistes. Les attentes de gain dans les activités liées à la nouvelle économie défient le bon sens, même si elles se sont récemment réduites. Le différentiel entre la valeur présente (le solde du bilan annuel d'exercice) et la valeur attendu future (la capitalisation boursière) atteint parfois des proportions aberrantes 858 . La vitesse de rotation du capital social est très élevée, particulièrement pour les sociétés de la nouvelle économie 859 . L'économie réelle pâtit du caractère largement spéculatif des transactions boursières. Le phénomène est amplifié par l'intégration des places financières grâce aux NTIC, par des innovations financières telles que les produits dérivés et par la formidable expansion des fonds institutionnels 860 .
Aux Etats-Unis, les caisses de pension n'hésitent pas à peser de tout leur poids d'actionnaire sur la définition des objectifs financiers des entreprises cotées, afin de maximiser leur investissement. En leur grande majorité, elles ont pour objectif premier la maximisation de la plus-value actionnariale. Les stratégies des fonds d'investissement éthique comportent des objectifs sociaux plus amples. Ces fonds pratiquent souvent une discrimination négative à l'encontre des entreprises qu'elles considèrent comme socialement trop peu responsables 861 . La tendance qui s'esquisse actuellement ne se contente pas d'exclure les «mauvaises» sociétés, mais vise à stimuler leur responsabilité sociale. L'achat d'une part du capital social permet à l'investisseur une prise de parole et un droit de vote lors de l'assemblée générale des actionnaires, soit un droit de regard sur le fonctionnement et les orientations de l'entreprise. L'investissement dépasse même le simple exercice des droits de l'actionnaire. Il est prétexte à dialoguer avec l'entreprise et l'inciter à une responsabilité sociale plus affirmée.
Le phénomène de l'investissement éthique représente une forme de pression sociale ou de gouvernance civile, ce que démontrent en Suisse la stratégie d'investissement de la fondation Ethos et les activités de l'association d'actionnaires ACTARES. La fondation Ethos gère d'importants fonds, d'origine surtout institutionnelle, selon des critères financiers, sociaux et environnementaux. Elle démontre la compatibilité de la responsabilité sociale et de la rentabilité financière, puisque les rendements de ses portefeuilles de titres sont similaires à ceux du reste du marché. Quant à l'association ACTARES, elle regroupe des personnes privées soucieuses de stimuler la responsabilité sociale de l'entreprise en usant de leurs droits d'actionnaires. Somme toute, Ethos et ACTARES intègrent comme composante importante, sinon essentielle, de leur action le dialogue constructif avec les entreprises dont elles sont actionnaires 862 .
L'investissement éthique a bonne presse, vu tout particulièrement la floraison des fonds «verts» ou environnementaux 863 . Il ne faudrait toutefois pas exagérer son impact ou son potentiel, car il représente une faible proportion des montants totaux investis 864 . L'essor du phénomène risque de toucher à certaines limites structurelles, telles que la forte liquidité des marchés de capitaux ou la gouvernance d'entreprise. L'intégration des marchés boursiers accroît en effet la palette de titres offerts à l'investisseur et réduit ses coûts de recomposition de son portefeuille. Il lui est ainsi très facile de choisir les titres les plus rentables à court terme et peu onéreux de modifier rapidement son choix. D'où l'idée parfois avancée d'une forme de taxation des transactions et/ou des gains de capital, du type de celle proposée par l'économiste Tobin 865 .
Les réticences politiques à l'idée d'une telle taxe sont très fortes : les désavantages l'emporteraient largement sur ses désavantages. En faits, les enjeux politiques sont aussi importants que les sommes que rapporteraient une telle taxe aux collectivités publiques. Une telle taxe réduirait pourtant la pression spéculative sur les entreprises. Autre limite de l'investissement éthique, l'implication active de l'actionnariat dans la vie des entreprises dépend évidemment des droits légaux dévolus à l'actionnaire. Ceux-ci sont bien limités. De toute manière, l'investisseur « éthique » est constitue une voix très minoritaire dans les décisions prises en assemblée générale des actionnaires. Pour son essor futur, le phénomène de l'investissement éthique nécessiterait entre autres mesures une certaine régulation internationale des flux de capitaux, tout comme des réformes et une harmonisation internationale des dispositions légales en matière de gouvernance d'entreprise.
4° Raisons morales
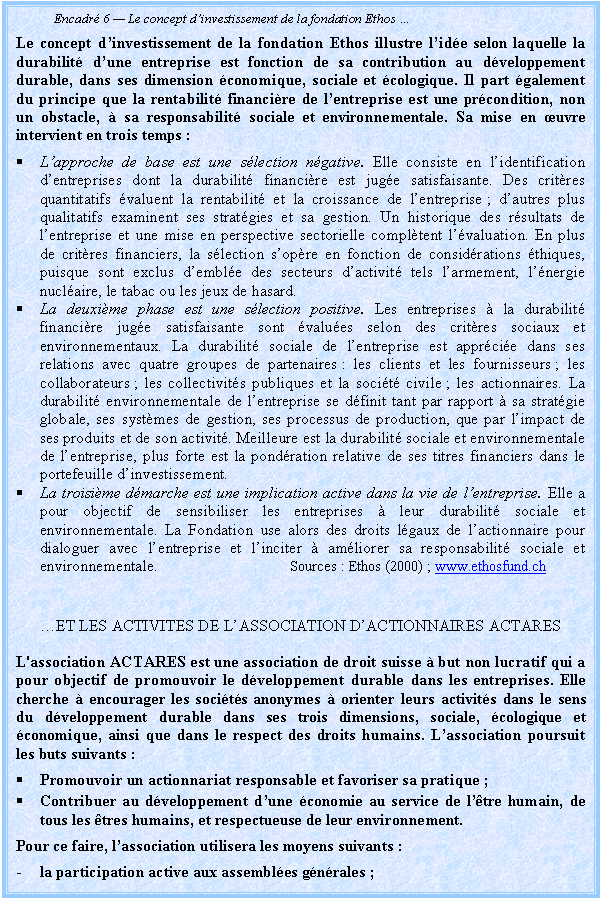 Encadré 6 : Le concept d'investissement de la fondation Ethos
Encadré 6 : Le concept d'investissement de la fondation Ethos
L'analyse a considéré jusqu'ici les seules sources externes de pression ou d'incitation au comportement citoyen de l'entreprise -- pouvoirs publics, société civile ou forces du marché. Une telle impulsion peut provenir également du coeur de l'entreprise par les convictions personnelles de ses membres et au travers de leurs interactions. Du reste et indépendamment de la source de la pression sociale, les modalités du changement sont essentiellement l'affaire de l'organisation et des hommes qui la composent. Construit social 866 , l'entreprise est un collectif d'individus et un noeud de relations sociales plus ou moins formalisées. L'entreprise s'insère dans un enchevêtrement de relations sociales. Le collaborateur participe à la vie de groupes sociaux dont les objectifs et les valeurs, la forme et le fonctionnement diffèrent. Il assume des rôles sociaux multiples par ses statuts de salarié d'une entreprise, de citoyen politique, de membre d'une famille, d'une communauté religieuse ou de divers groupements associatifs.
Le rôle social assumé par l'individu ne représente pas seulement une facette de ses activités, mais également un indicateur de ses points de contact avec divers réseaux sociaux 867 . Ses valeurs et son comportement dépendent dès lors de sa personnalité tout comme de facteurs contextuels tels ses besoins et ses désirs ou les valeurs, les objectifs et les contraintes du groupe dans lequel il se meut 868 . L'individu ne s'identifie toutefois pas totalement aux objectifs d'une seule collectivité. Il panache et optimise le fonctionnement et le bien-être des divers réseaux sociaux auxquels il appartient 869 . La délimitation effective entre ces divers réseaux sociaux est aussi souple que leur frontière est perméable.
La pluri-appartenance collective de l'individu peut produire sur son comportement un effet tant mutuellement renforçateur et stimulant que conflictuel et inhibiteur. Par exemple, le sens civique ou les convictions religieuses de l'individu dynamisent sa motivation au travail s'il le conçoit comme utile tant à l'entreprise qu'à la société 870 . De même la qualité de la coopération interindividuelle et la vigueur des processus d'innovation dans l'entreprise peuvent grandement bénéficier des contacts personnels et des échanges d'idéesqu'entretiennent ses employés dans leur vie extraprofessionnelle 871 . A l'inverse, l'action individuelle peut être inhibée par des conflits de valeurs qui découlent de ses appartenances multiples. Si la productivité et la motivation au travail chancellent suite à des réductions d'effectif, c'est aussi en raison du malaise qui habite le collaborateur «survivant» quant à la qualité de la responsabilité sociale de l'entreprise.
La citoyenneté de l'entreprise exprime l'idée de rôles multiples assumés par ses membres. Elle représente pour ceux-ci l'opportunité de conjuguer leurs responsabilités professionnelles avec leur sens civique 872 . Dans ce contexte, l'importance du leadership paraît établie. Pour réussir, une innovation organisationnelle et sociale comme la citoyenneté de l'entreprise nécessite des moyens financiers, mais aussi et surtout un champion 873 . Celui-ci assume une fonction symbolique et effective de meneur d'hommes, de catalyseur de leurs compétences et de stimulant de leur énergies. Le manager d'un grande société contemporaine ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire que Berle et Means croyaient identifier dans les années trente 874 . Son pouvoir est important au vu des implications sociales de ses décisions ; il l'est beaucoup moins au vu des fortes contraintes qui les accompagnent 875 . Pour la citoyenneté de l'entreprise cependant, le leadership résiderait moins strictement dans les attributs fonctionnels d'un poste directorial que dans une attitude dynamique et responsable fondée sur d'authentiques préoccupations sociales et d'intimes convictions personnelles.
* * *
Au bilan, il est une mixité de motivations à la citoyenneté de l'entreprise. Ces initiatives sociales ne présentent pas le caractère volontaire et discrétionnaire qu'on leur prête parfois. Elles procèdent principalement de pressions et d'incitations sociopolitiques dans lesquelles la société civile joue un rôle clé. Le partenariat avec la société civile offre une incitation importante à l'entreprise qui se prémunit ainsi de critiques ultérieures. Le partenariat permet la constitution d'un climat de confiance entre ses protagonistes dont l'effet profite à l'activité économique. Le mécanisme de marché offre des signaux mixtes. Il ne récompense ni ne sanctionne immédiatement et irrémédiablement le degré de responsabilité sociale de l'entreprise, car il valorise mal les facteurs intangibles comme la réputation de l'acteur ainsi que la notion de durabilité. Sous un autre angle, il contribue à la diffusion des pratiques socialement responsables (best practices). Reste les considérations morales. Une entreprise est un collectif d'individus citoyens dont la productivité est aussi fonction de la satisfaction tirée de travailler pour une entreprise socialement responsable. Il est ainsi des passerelles entre la performance économique et sociale. Par des actions citoyennes, l'entreprise contemporaine peut simultanément augmenter ses performances économiques et de démontrer sa responsabilité sociale. Elle encore plus sûrement assurer sa durabilité d'acteur économique et celle de son milieu social.
B. Modalités citoyennes
Le premier chapitre a établi l'orientation principalement, mais non exclusivement, externe de l'engagement citoyen de l'entreprise. Celui-ci est une manifestation possible, mais pas l'unique, de sa responsabilité sociale. Dans sa relation avec son milieu social, l'entreprise dispose de multiples modalités d'action citoyenne. Elles se distribuent au long de trois vecteurs :
-
Les activités de base de l'entreprise visent à la couverture des besoins sociaux en biens et services par des modes de production qui respectent des critères éthiques, légaux, sociaux et environnementaux. Les initiatives à caractère social élaborées tout au long de l'axe productif ont un caractère hautement stratégique, servant son intérêt commercial direct à court terme.
-
Le dialogue politique consiste en un partage d'informations, d'expériences et de compétences avec les pouvoirs publics et la société civile afin d'assurer la valorisation politique des attentes, des intérêts et des besoins de l'entreprise. Les activités politiques de l'entreprise servent ainsi l'intérêt commercial à moyen et à long terme de l'entreprise.
-
Les initiatives sociales s'entendent comme la contribution de l'entreprise à la vitalité et à la cohésion de son environnement social, tant pour disposer d'un milieu opérationnel de qualité que pour renforcer sa propre légitimité. L'implication sociale de la firme sert son intérêt élargi à moyen et à long terme et ainsi que celui de son milieu social.
La plupart des actions citoyennes de l'entreprise supposent l'établissement d'un partenariat avec un ou plusieurs acteurs sociaux. Le partenariat est une collaboration de l'entreprise et d'une collectivité dans une approche mutuellement bénéficiaire. Son caractère formel et stratégique est variable. Fortement stratégique, il implique la coopération entre ses acteurs dans la phase d'élaboration, de décision et de réalisation. Le partenariat peut s'envisager aux niveaux local, national ou international. Il peut impliquer d'une part un groupe d'entreprises, des chambres de commerce ou des confédérations d'industrie, d'autre part une coalition composite d'ONG, d'organisations internationales et d'administrations publiques. La vie économique actuelle connaît une explosion de la variété et du nombre de partenariats telles les alliances stratégiques en matière de R&D, de production ou de commercialisation. Même si le principe de coopération économique n'est pas neuf en essence, sa prégnance contemporaine l'est certainement.
 Fig. 5 : Modalités de la responsabilité sociale et de la citoyenneté de l'entreprise
Fig. 5 : Modalités de la responsabilité sociale et de la citoyenneté de l'entreprise
Le graphique n'établit pas de distinction entre la responsabilité sociale et la citoyenneté de l'entreprise. Il reflète l'hypothèse énoncée en introduction selon laquelle que les deux notions peuvent en pratique se superposer et se confondre si l'engagement citoyen de l'entreprise est authentique. Le développement durable constitue un possible cadre d'action aux initiatives citoyennes de l'entreprise. Celles-ci s'échelonnent au long des trois axes, économique, politique et social. Leur position reflète le caractère plus ou moins hybride de leur nature. Ainsi la contribution de l'entreprise au niveau technologique et aux compétences de son milieu social présente des implications des plus composites. Cette modalité de l'engagement citoyen de l'entreprise a des répercussions sur le capital économique, humain et social de la société ainsi que sur la définition des politiques publiques. Il en va de même pour la transparence opérationnelle qui a des implications aussi bien économiques que politiques et sociales. Toutes les manifestations de la responsabilité sociale et de la citoyenneté de l'entreprise ne sont pas analysées en détails ci-dessous. La plupart de celles qui concernent les activités de base et le dialogue politique sont abordées, directement ou indirectement, à d'autres points de la dissertation. L'accent est mis ici sur les modalités les plus usuelles de l'engagement citoyen de l'entreprise, c'est-à-dire le volet philanthropique des initiatives sociales.
Sur l'axe des activités de base de l'entreprise figurent les relations qu'elle entretient avec ses partenaires d'affaires tels que sous-traitants, fournisseurs et revendeurs. En l'espèce, la citoyenneté de l'entreprise suppose une éthique d'affaires comme le respect de la libre concurrence, des droits de propriété intellectuelle et des engagements contractuels. La politique environnementale de l'entreprise comporte de multiples facettes telles l'usage responsable des ressources non renouvelables et des matières premières, la gestion et le recyclage des déchets. Vis-à-vis des détenteurs de son capital social, l'entreprise socialement responsable valorise leur investissement et leur prodigue une information régulière et fiable sur sa marche et sa santé. L'actualité donne à penser que l'objectif financier est souvent mieux honoré par les entreprises que celui concernant la transparence de leurs activités. La dignité, la santé et la sécurité au travail constituent une autre modalité essentielle de la citoyenneté de l'entreprise. Le droit du travail est considérablement développé, ce qui n'empêche pas des initiatives sociales dans ce domaine. La santé et la sécurité du consommateur sont assurées par la qualité des produits. L'information sur la teneur et le mode de réalisation de ceux-ci est certes définie par des dispositions légales. Elle reste perfectible au vu des stratégies publicitaires à la déontologie parfois douteuse ainsi que des controverses au sujet du développement des biotechonologies dans l'agro-alimentaire.
La contribution de l'entreprise aux recettes fiscales et au revenu national sont des modalités citoyennes au caractère aussi bien économique que politique. La capacité d'action de l'Etat dépend grandement de la santé des finances publiques qui sont alimentées directement par les recettes fiscales et indirectement par l'état de la richesse nationale. La dimension politique de l'engagement citoyen de l'entreprise suppose l'effectivité du dialogue syndical. Celui-ci est le gage de la qualité du climat de travail sinon celui de la paix du travail. La fonction politique de l'entreprise est assurée également par sa participation à l'élaboration de normes de droit privé comme un label social. Cette démarche suppose un travail concerté avec les divers groupes de la société civile concernés 876 . Autres modalités citoyennes de l'entreprise, le non-recours à la fraude et à la corruption ainsi que l'avis consultatif en matière d'élaboration législatif suppose le respect du processus démocratique et de la prééminence de la puissance publique dans la vie sociale. Troisième axe de la citoyenneté de l'entreprise, l'initiative sociale se diffracte en deux activités principales, la philanthropie et l'engagement social.
1° La philanthropie
La philanthropie vise en principe à la promotion du bien commun par le soutien de la vie sociale dans ses manifestations les plus diverses. Elle suppose une donation, que ce soit sous forme financière, de biens et services ou encore de mise à disposition de compétences. L'idéal philanthropique est désintéressé, c'est-à-dire qu'il suppose en principe aucune contrepartie de la part de l'institution récipiendaire autre qu'un compte-rendu discrétionnaire sur l'usage des ressources allouées. La philanthropie se distingue en cela de l'investissement ou du sponsoring qui comportent pour leur auteur un objectif économique explicite. Elle tranche également avec les pratiques corruptrices ou frauduleuses aux visées illicites et occultes. La donation peut être soit directe soit indirecte. Dans ce dernier cas, l'action philanthropique de l'entreprise facilite et stimule les donations de ses collaborateurs par l'organisation de l'action caritative ainsi que par son don de valeur équivalente (matching gift). Les initiatives philanthropiques des sociétés commerciales s'adressent à des projets éducatifs, des oeuvres caritatives ou des manifestations artistiques ou sportives. La philanthropie peut concerner encore des projets économiques de soutien à l'entrepreneuriat par le biais de capital-risque ou de microcrédit.
La forme la plus simple de la philanthropie est la donation en espèces. Celle-ci consiste en un versement ponctuel d'argent à une association ou une manifestation d'intérêt public sans implication directe de l'entreprise dans l'usage des fonds ni valorisation active de son image. Le mécénat consiste également en un versement de fonds, mais il s'inscrit dans une perspective temporelle plus étendue et adjoint un objectif discret de valorisation de l'image du donateur. Le soutien en nature se rapproche un peu des activités de base puisqu'il consiste en la fourniture de biens et services ainsi qu'en des actions de volontariat et d'expertise. Il comporte un caractère stratégique plus marqué d'image institutionnelle. La donation, le mécénat et le soutien en nature constituent les trois modalités principales de la philanthropie.
La fondation d'entreprise représente le véhicule le plus formel d'action philanthropique. Elle a pour objectif générique le financement de projets d'intérêt public. La structure fonctionnelle des fondations d'entreprise se décline en trois types 877 . Certaines se dédient uniquement au financement de projets qui leur sont soumis, d'autres financent, conçoivent et dirigent des programmes opérationnels et le solde combine les deux approches. Le degré d'indépendance fonctionnelle et financière de la fondation vis-à-vis de l'entreprise varie de cas en cas. Il arrive que les fondations d'entreprise soient également récipiendaires de fonds publics ou qu'elles se regroupent à l'échelon national afin de mieux coordonner leur action. L'importance effective de telles fondations dans les manifestations de responsabilité sociale du secteur privé varie considérablement suivant les contextes nationaux. Les Etats-Unis figurent à cet égard un peu comme le pays de cocagne. Le nombre des fondations privées -- d'entreprise et familiales -- y a doublé depuis le début des années quatre-vingts 878 . Le Canada, l'Australie, le Japon, la plupart des pays européens et beaucoup de pays en développement offrent également des conditions favorables 879 . Les dégrèvements fiscaux dont bénéficient les fondations d'entreprise font parfois dire qu'elles permettent d'exonérer des bénéfices tout en conservant le contrôle de leur allocation ultérieure. D'autres critiquent l'allocation des ressources par les fondations d'entreprise : cette allocation serait insuffisante par rapport aux réserves disponibles, trop fragmentée dans ses montants et trop dispersée dans ses domaines d'attribution 880 . Vu ainsi, la fondation ne profite pas pleinement ni à la société ni à l'entreprise vu que son caractère philanthropique l'interdit de l'associer trop étroitement à des stratégies commerciales.
L'idéal philanthropique est désintéressé, mais ses manifestations le sont moins. La générosité philanthropique est largement fonction des usages sociaux, des pressions et incitations sociales, politiques et économiques 881 . Légalisée durant les années cinquante, la philanthropie d'entreprise atteint aujourd'hui aux Etats-Unis des montants considérables 882 . Le phénomène jouit, il est vrai, de solides antécédents historiques avec la philanthropie du baron voleur de la fin du XIXe siècle 883 . Les deux types d'initiative sociale visent à l'amélioration de l'image du donateur. La philanthropie contemporaine se différencie de celle du baron voleur par son caractère plus stratégique qu'ostentatoire. Elle a pour enjeu la réputation de la firme ou de la marque, et non pas celle d'un seul homme. Elle donne lieu à une soigneuse analyse des coûts et des bénéfices escomptés, alors que cette analyse était autrefois laissée à l'appréciation personnelle et subjective du magnat industriel. Les initiatives philanthropiques contemporaines recherchent également un effet amplifié et plus rapide sur la réputation de leur auteur. En conséquence la donation en espèces, trop peu stratégique, et le mécénat, trop discret et à long terme, perdent quelque peu de leur importance. La nature du don évolue également. La donation financière diminue au profit du soutien en nature -- parfois une forme élégante pour l'entreprise de se débarrasser de ses stocks d'invendus. Dans un souci de visibilité, la donation est destinée de préférence aux associations bien établies et reconnues. En parallèle la fonction de relations publiques se décentralise dans l'organigramme afin de s'adapter plus finement aux sensibilités locales. Ainsi la philanthropie contemporaine s'apparente de plus en plus à l'engagement social et au marketing institutionnel 884 .
2° L'engagement social
L'engagement social de l'entreprise (corporate community investment) désigne un programme d'action sociale, mené le plus souvent en faveur de la communauté locale en collaboration avec un ou plusieurs acteurs sociaux 885 . L'entreprise non seulement met à disposition de la communauté locale des capitaux, des biens et services ou des compétences, mais s'implique activement dans l'élaboration et l'exécution du projet. L'engagement social est destiné à bénéficier directement à la communauté locale et indirectement à l'entreprise. Il procède de l'intérêt à long terme de l'entreprise d'oeuvrer dans un environnement social sain et dynamique. Il recherche la valorisation des compétences centrales de l'entreprise dans des partenariats mutuellement bénéfiques qui renforcent son ancrage local. Cette stratégie de bon voisinage s'inspire du paternalisme industriel du second XIXe siècle et début du XXe siècle. L'engagement social comporte un caractère stratégique plus affirmé qu'une action philanthropique, mais moindre que celui du marketing institutionnel. Le tableau ci-dessous démontre son évolution historique.
| Tabl. 4 : L'évolution historique de l'engagement social 886 |
| |
1ère vague
(1950-1970) |
2ème vague
(1970-1980) |
3ème vague
(1980-1990) |
4ème vague
(1990-2000) |
| Objectif |
Philanthropie |
Philanthropie stratégique |
Investissement social local |
Qualité/compétitivité du milieu opérationnel |
| Motivation |
Moralité |
Intérêt à long terme |
Intérêt à long terme
Intérêt direct |
Intérêt direct propre |
| Stratégie |
Ad hoc |
Systématique |
Stratégique |
Intégrée |
| Initiateur |
Administrateur |
Manager |
Entrepreneur,
Consultants |
Tous niveaux de management |
| Rapport aux activités de base |
Détachée |
Distincte, mais liée |
Partie |
Intégrée |
| Initiative |
Passive |
Réactive |
Proactive |
Intégrée au processus décisionnel |
| Formes de contribution |
Capital financier surtout |
Capital financier et technique |
Capital économique, technique |
Toutes formes
De capital |
| Principes directeurs |
Discrétionnaire |
Spécifiques |
Harmonisés avec la stratégie productive |
Part de la stratégie opérationnelle |
| Suivi |
Aucun |
Assistance à des questions spécifiques |
Soutien et contrôle par des ONG |
Incorporé aux objectifs managériaux |
L'engagement social est à l'origine une simple médiation entre l'entreprise et ses partenaires locaux (1ère et 2ème vagues). Lors des années quatre-vingts, il devient plus professionnel dans sa conception, plus démocratique dans sa mise en oeuvre et plus transparent dans ses résultats (3ème et 4ème vagues) 887 . L'engagement social consiste en la mise à disposition de moyens financiers, de biens et services et de compétences professionnelles. Trois de ses modalités sont examinées ici : le volontariat de salariés, la co-gestion de projet social et le marketing social et éthique.
-
Engagement social des collaborateurs
L'entreprise peut ainsi promouvoir l'engagement social ou le volontariat de l'employé (employee community involvement). La démarche consiste en une implication active et volontaire du collaborateur dans des actions sociales qui bénéficient à la communauté locale 888 . L'engagement social de l'employé s'effectue soit pendant le temps de travail (secondment) soit en dehors de celui-ci (volunteering) 889 . Cette dernière variante est bien sûr la plus coûteuse à l'entreprise. L'engagement du collaborateur dynamise et affermit la cohésion de la communauté locale. Il valorise la multiplicité des rôles sociaux assumés par le salarié. Il fidélise le collaborateur, contribue à sa motivation et à son sens de responsabilité morale, exerce en outre ses aptitudes au travail en groupe et stimule enfin son sens de l'initiative et sa faculté d'adaptation 890 . Il rehausse bien sûr la réputation de l'entreprise. Inauguré par Levi Strauss dans les années septante, le volontariat aujourd'hui est aujourd'hui une pratique des plus courantes dans le monde anglo-saxon en particulier. Ceci dit, le volontariat du collaborateur n'exprime guère la responsabilité sociale de l'entreprise s'il est effectué en marge de son temps de travail. Dans ce cas, l'entreprise est tout au plus un facilitateur de l'action philanthropique de sa main-d'oeuvre.
-
Co-gestion de projet social
Le projet social implique une action concertée entre l'entreprise et au moins un autre acteur social. Les partenaires élaborent et gèrent en commun un projet à vocation sociale. Le projet social vise généralement à l'amélioration des compétences éducationnelles et professionnelles de la main-d'oeuvre locale. Il a parfois des ambitions sociales plus larges telles que la stimulation de l'entrepreneuriat, la lutte contre la pauvreté, la prévention du sida et de la délinquance, la régénération urbaine et la protection de l'environnement. La tâche nécessite alors une approche concertée qui dépasse l'échelon local et qui implique parfois une collaboration avec une organisation internationale. Les entreprises peuvent également se regrouper pour mieux cibler et valoriser l'impact de leur action. Dans tous les cas, la mise en oeuvre de programmes d'action nationaux ou internationaux est adaptée aux sensibilités locales 891 . La co-gestion de projet social exprime au mieux l'essence de la citoyenneté de l'entreprise, soit l'intérêt stratégique éclairé du sens des responsabilités collectives. Elle permet l'implication responsable de l'entreprise dans la vie sociale et valorise les partenariats win-win avec divers acteurs sociaux.
Le marketing institutionnel est une activité de promotion commerciale de l'image de l'entreprise. Dans une orientation purement commerciale, la promotion peut aussi lier l'image de l'entreprise à une manifestation ou un personnage célèbre (sponsoring). Dans une orientation plus philanthropique, le marketing institutionnel s'effectue soit au travers d'un partenariat avec un acteur social (marketing social) soit par un lien symbolique avec une «cause» à forte teneur morale (marketing éthique) 892 . L'opération de marketing social ou éthique séduit le consommateur par son caractère moral et se solde par l'accroissement des ventes de l'entreprise dont les bénéfices sont partagés avec son partenaire. L'opération est hautement stratégique : très ciblée dans le choix de son thème, de son partenaire et de son groupe social cible, généralement limitée dans sa durée. Elle peut concerner aussi bien la prévention et la lutte contre le sida que la lutte contre le travail des enfants. Le marketing social et éthique se situe ainsi à mi-chemin entre la philanthropie et les activités de base. Si son origine historique est récente 893 , le marketing institutionnel rencontre les faveurs croissantes du secteur privé 894 . Il est sujet à controverse lorsqu'il tend à l'opportunisme et au sensationnalisme 895 . Son succès tend à éroder le caractère non lucratif des activités de certaines ONG. De plus, il entraîne la régression de formes plus authentiques d'investissement social de l'entreprise, comme l'engagement social et la philanthropie. Surtout, il ne saurait occulter les formes élémentaires de la responsabilité sociale de l'entreprise, à savoir sa contribution à l'emploi de qualité, ainsi que la fiabilité de ses produits.
3° Déterminants des pratiques citoyennes
La responsabilité sociale de l'entreprise transnationale répond à des incitations ou des pressions. Les incitations économiques sont synthétisées par le tableau en page suivante. L'engagement citoyen de l'entreprise implique souvent un partenariat. Celui-ci suppose l'identification d'un domaine d'intérêt commun aux différentes parties. La collaboration suppose la définition des rôles des parties, de l'origine et de l'allocation des ressources. Elle implique l'évaluation périodique des résultats et la mise en oeuvre des correctifs nécessaires 896 . Le partenariat requiert l'aménagement des procédures organisationnelles de l'entreprise. L'engagement authentique et visible de la direction dans le projet est crucial à cet égard. Il crédibilise la démarche auprès des collaborateurs et stimule son implication active. Une culture d'entreprise privilégiant la consultation et la communication représente un autre atout de choix, car elle facilite le processus d'apprentissage requis par l'engagement citoyen. Ceci pour introduire l'essentiel : le sens de la continuité et du long terme dans l'appréciation des résultats de l'opération 897 .
| Tabl. 5 : Modalités et plus-value des pratiques citoyennes 898 |
| Motivation |
Objectifs et caractéristiques de l'activité |
Plus-value pour l'entreprise |
| Promotion du bien commun |
Actions philanthropiques destinées à améliorer la réputation de l'entreprise, notamment par :
Donations directes par l'entreprise ;
Facilitation de donation par ses partenaires. |
Pas de résultat directement mesurable. Néanmoins, légitimité renforcée. |
| Intérêt stratégique à moyen et à long terme |
Engagement social destiné à créer un bon climat opérationnel, notamment par :
Programmes de scolarisation et de formation professionnelle/académique ;
Cogestion de programmes sociaux au niveau local :
Logements et conditions de vie des employés et de leurs famille. |
Bénéfices mesurables à moyen et long terme et à un certain degré en matière de :
Qualité de l'environnement social et physique de l'entreprise ;
Opportunités, qualité et durabilité des relations d'affaires ;
Qualité du recrutement, fidélisation, absentéisme, motivation et identification des employés avec la firme. |
| Intérêt stratégique à court et à moyen terme |
Marketing social ou éthique afin de réaliser divers objectifs d'affaires, notamment par :
Développement de produits par des instituts de recherche ;
Campagnes d'éducation sanitaire ou de prévention de la délinquance urbaine ;
Campagne de promotion de droits de l'homme ;
Sponsoring à large échelle d'activités culturelles et sportive. |
Bénéfices mesurables à court et moyen terme dans les domaines suivants :
Réputation et reconnaissance de la marque ;
Qualité et durabilité des relations d'affaires ;
Facilité et qualité du recrutement, fidélisation du collaborateur ;
Volumes de vente et valeur actionnariale. |
| Intérêt commercial à moyen et à long terme |
Dialogue politique constructif afin de faire connaître aux pouvoirs publics les intérêts et les besoins du secteur privé. En particulier :
Echanges d'informations, d'expériences et de compétences ;
Non-interférence directe dans les décisions politiques. |
Bénéfices mesurables à moyen et long terme en matière de :
Adéquation et souplesse d'application du cadre légal et régulatoire;
Soutien public et privé à l'entrepreneuriat ;
Réputation et reconnaissance de la marque. |
| Intérêt commercial à court et moyen terme |
Activités de base qui respectent des critères éthiques, sociaux et environnementaux. En particulier :
Dignité, santé et sécurité au travail ;
Préservation du milieu naturel ;
Qualité et sécurité des produits ;
Formation et emploi ;
Respect des minorités. |
Bénéfices mesurables à court et moyen terme dans les domaines suivants :
Volume des ventes et valeur actionnariale ;
Qualité du recrutement, fidélisation et absentéisme du collaborateur ;
Qualité des relations d'affaires ;
Réputation. |
Les modalités d'engagement citoyen de l'entreprise impliquent souvent un partenariat. Celui-ci suppose l'identification d'un domaine d'intérêt commun aux différentes parties, puis la définition d'une communauté d'intérêt -- du moins la perception partagée de l'impact mutuellement bénéficiaire de la collaboration. Le succès du partenariat dépend ensuite de la définition claire des rôles des parties, ainsi que de l'origine et l'allocation des ressources. Sa viabilité suppose enfin l'évaluation périodique des résultats et la mise en oeuvre des correctifs nécessaires 899 . Une autre source du problème est l'entreprise elle-même. La mise en oeuvre d'initiatives citoyennes implique une certaine modification des routines organisationnelles de l'entreprise. L'engagement authentique et visible de la direction de l'entreprise dans le projet constitue un facteur crucial à cet égard. Il crédibilise la démarche auprès des collaborateurs et simule son implication active. Une culture d'entreprise privilégiant la consultation et la communication représente un autre atout de chois, car elle facilite le processus d'apprentissage requis par l'engagement citoyen. Ceci pour introduire l'essentiel : le sens de la continuité et du long terme dans l'appréciation des résultats de l'opération 900 .
La forme et la vigueur de l'engagement citoyen de l'entreprise dépend à un certain degré du secteur d'activité, ainsi que de la visibilité publique de ses activités de base. Le secteur pharmaceutique vise par ses initiatives citoyennes à inspirer au consommateur une image de confiance et d'intégrité qui rassure le consommateur. L'industrie électronique et informatique définit sa contribution sociale par son formidable potentiel de croissance et de progrès technologique, dont les retombées sociales sont susceptibles de bénéficier à l'ensemble de la société. Dans le secteur des services et de la vente de détail de biens de consommation courante, le succès commercial est grandement tributaire du degré de satisfaction de la clientèle. Les initiatives sociales sont dès lors conçues en vue d'une visibilité maximale pour celle-ci. Plus distantes du consommateur, les industries de production de biens intermédiaires sont moins enclines à des réalisation citoyennes, en raison de la faible visibilité sociale de leurs produits. Elles ont néanmoins tout à gagner à soigner la qualité des compétences professionnelles de leurs employés et celle de leurs relations d'affaires 901 .
* * *
Au bilan, les motivations et les modalités de l'engagement citoyen de l'entreprise transnationale se prêtent assez mal à toute généralisation péremptoire. Parmi les motivations ressortent la volonté du secteur privé d'inspirer, d'influencer ou de prévenir les politiques publiques ; la pression sociale, voire la perspective de gain financier. En dernière analyse, les deux motivations principales paraissent être en l'occurrence la volonté d'influencer et de prévenir l'élaboration normative d'une part, la nécessité de répondre de façon très visible aux pressions sociales d'autre part. La mondialisation laisse en effet apparaître un déficit normatif en matière sociale tout particulièrement. Le secteur privé est largement hostile à une approche contraignante du respect des normes universelles en matière de droits humains et sociaux. Dans ce contexte, l'affirmation citoyenne de la grande entreprise donne à penser qu'il s'agit surtout d'une stratégie de prévention d'élaboration normative, du type « je suis déjà socialement responsable ! » Le message serait également destiné à légitimer socialement la grande entreprise par l'amélioration de son image de marque auprès de l'opinion publique. La généralisation absolue de cette interprétation serait abusive, car des motivations plus authentiques guident certaines initiatives sociales du secteur privé. A l'image du paternalisme du second XIXe siècle, l'engagement citoyen de l'entreprise contemporaine est à double face. Il y a cependant des raisons de penser que la première tendance domine.
L'engagement citoyen de l'entreprise transnationale est jusqu'à présent orienté vers des actions philanthropiques et l'engagement social. Il intervient plutôt en parallèle ou en palliatif d'une stratégie de maximisation du profit qui occasionne de lourds coûts sociaux. Cette orientation ambiguë répond à une conception anglo-saxonne et plus encore américaine de l'entrepreneuriat, héritée des barons voleurs de la fin du XIXe siècle. Cette conception n'épouse pas forcément les attentes sociales des sociétés non anglo-saxonnes.
La citoyenneté de l'entreprise est une forme authentique de sa responsabilité sociale si elle permet une meilleure insertion sociale de l'entreprise et des hommes qui la composent. Les modalités de cet ancrage social connaissent d'importante variations socioculturelles, si bien que la citoyenneté de l'entreprise ne représente en aucun cas la forme unique et universelle de la responsabilité sociale du secteur privé. Des invariants interculturels existent cependant : la contribution de l'entreprise à l'emploi de qualité, une production fiable, le respect de l'environnement naturel comme celui de la prééminence du politique constituent des manifestions les plus élémentaires et les plus probantes de la responsabilité sociale de l'entreprise. Quelques initiatives de type philanthropique, si bonne soient-elles, ne sauraient les substituer ; elles les complètent tout au plus.
En pratique, la nature, l'ampleur et la qualité des actions citoyennes varient beaucoup d'une entreprise, d'un secteur d'activité ou même d'une région à l'autre. De telles initiatives sont aussi tributaires de la conjoncture économique. Les différentes modalités citoyennes tiennent tant aux ressources disponibles à l'entreprise qu'aux besoins exprimés ou latents de la société. Leur ampleur dépend des sollicitations sociales et du cadre institutionnel. Elle fluctue également selon la conjoncture économique et les résultats financiers de l'entreprise. En somme, l'engagement citoyen de l'entreprise est largement tributaire de son rapport objectif et subjectif avec son milieu opérationnel ainsi que du type de ses activités 902 . Son concept global regrouperait trois idées force que Rosabeth Moss Kanter désigne par «les trois C 903 » : un Concept central innovateur ; des Compétences organisationnelles bâties sur un processus d'apprentissage ; enfin de nombreuses Connections entre l'entreprise, les collectivités publiques et la société civile.
L'engagement citoyen de l'entreprise n'émerge pas d'un vacuum. Il est stimulé par l'existence d'un cadre institutionnel favorable, par de nombreuses points de contact avec la société civile ainsi que par l'exemple de firmes concurrentes. La citoyenneté de l'entreprise requiert encore plus fondamentalement une vision accompagnée d'une volonté de bousculer les routines organisationnelles et d'explorer des pistes nouvelles. Pour s'exprimer et se concrétiser, cette volonté doit être partagée au sein de l'organisation, à tous niveaux hiérarchiques ; pour qu'elle soit partagée, il faut une culture interne de communication et de dialogue. Cette réflexion interne préalable permet de donner du sens à l'action citoyenne et de l'harmoniser avec l'activité de base et la culture d'entreprise. Pour leur mise en oeuvre, les actions citoyennes requièrent des moyens financiers et surtout des compétences. L'engagement social des collaborateurs constitue la meilleure carte de visite pour l'entreprise. Il constitue également un enrichissement individuel et collectif que n'assurent pas des donations de capitaux, de biens ou de services. A cet égard, l'engagement social doit être laissé largement à l'initiative des collaborateurs. Imposé par la direction de l'entreprise, il équivaudrait à un nouveau paternalisme.
L'engagement citoyen authentique de l'entreprise exprime sa prise de responsabilité publique qui reflète également ses intérêts propres. Il est partie intégrante d'une stratégie managériale d'optimalisation de l'efficience organisationnelle et de création de synergies avec son milieu opérationnel. On peut déplorer le rapport instrumental entretenu par l'entreprise avec son environnement social, considéré comme un élément de sa propre compétitivité. On peut y voir plus positivement la reconnaissance des interdépendances de l'entreprise et de son milieu social. On doit surtout veiller à ce que l'affirmation citoyenne de l'entreprise soit effective dans le champ socio-économique et limitée dans ses ambitions politiques. Faute de quoi, on assisterait à la privatisation de l'action publique au profit d'une minorité sociale.
8. L'audit social
La citoyenneté de l'entreprise repose sur l'interdépendance de trois notions. Au vu l'importance des ressources et des compétences qu'elle mobilise, la grande entreprise manifeste sa responsabilité à l'égard de ses partenaires par la qualité intrinsèque de ses actions (responsibility) ainsi que par un compte-rendu (accountability) de ses activités et de leur impact social 904 . Ensuite le partenaire de l'entreprise jouit d'un droit à l'information 905 , car il est concerné par l'existence et la vie de l'organisation. La firme est ainsi invitée à une certaine transparence quant à ses objectifs et ses procédures, ses résultats opérationnels et leur incidence sociale. Enfin la responsabilité sociale de l'entreprise suppose un dialogue effectif entre l'institution et ses partenaires (inclusivity) 906 , afin d'assurer sa légitimité sociale et d'orienter ses progrès en la matière.
Le présent chapitre se focalise sur la manière dont l'entreprise rend compte publiquement de ses activités et engage un dialogue avec ses partenaires. L'information sociale et environnementale publiée par l'entreprise transnationale est de nature discrétionnaire. Elle répond aux attentes sociales quant à la transparence de ses activités. L'information sociale et environnementale contribue également à l'amélioration de l'image publique de l'entreprise et de la motivation de sa main-d'oeuvre. Ce double enjeu met en cause la qualité de l'information publiée. Une forme de vérification indépendante de cette information paraît nécessaire pour s'assurer de sa fiabilité. De nombreuses initiatives privées impliquant une coalition d'acteurs se dessinent actuellement. Elles assortissent une forme d'autorégulation de l'entreprise -- par un code de conduite notamment -- à un contrôle indépendant de son effectivité. Ces initiatives privées se formalisent parfois par l'attribution d'un label à l'entreprise. Dans tous ces cas, l'audit social indépendant de l'entreprise garantit la qualité de la démarche.
A. Equivoque citoyenne
Les notions de compte-rendu d'activité et de transparence organisationnelle renvoient aux politiques de communication interne et externe de l'entreprise. La publication d'information financière à l'intention de ses actionnaires et du grand public est sujette à une réglementation légale ou contractuelle. En revanche la publication de données non financières -- sociales ou environnementales -- est actuellement laissée à l'appréciation de l'entreprise dans la plupart des pays. De nature discrétionnaire, celle-ci rend compte de la responsabilité sociale de l'entreprise et contribue à la diffusion des pratiques citoyennes parmi le secteur privé. La démarche n'est pas franche d'ambiguïtés. La transparence organisationnelle peut être plutôt factice. Le volume de l'information sociale publiée ne garantit aucunement sa qualité ; une information pléthorique majore même le risque de son manque de rectitude. Deuxièmement l'information peut rendre compte très imparfaitement des activités de l'entreprise et distordre ainsi son image publique. Quelle que soit sa forme et son public cible, la communication externe de l'entreprise tend à véhiculer une image flatteuse d'elle-même 907 . Enfin et indépendamment de sa qualité intrinsèque, sa ventilation publique peut comporter des objectifs internes tels que le renforcement de la culture d'entreprise et la motivation du personnel. La problématique comporte des enjeux managériaux et publics auxquels s'adresse le social reporting.
Le social reporting est le procédé par lequel l'entreprise rend compte publiquement de ses activités. Véritable instrument de gestion, il ne s'assimile pas à une simple opération de relations publiques. Il requiert une réflexion sur les valeurs et la conception de la responsabilité sociale de l'entreprise. Il amène au dessin d'une stratégie, de moyens d'implémentation et de suivi. Il suppose ensuite la mesure notamment par un audit des résultats obtenus ainsi que la mise en oeuvre de mesures correctives. Enfin le social reporting rend compte publiquement des différentes phases par une communication externe et par un dialogue avec les partenaires de l'entreprise. Ainsi donc, la publication d'informations non financières ou l'audit social de l'entreprise représentent des éléments distincts, mais interconnectés au sein d'une démarche plus large de social reporting.
1° L'information non financière
De nature quantitative comme qualitative, l'information non financière diffusée par l'entreprise est le plus souvent incorporée dans le rapport d'activité annuel, plus rarement consignée dans une publication spécifique. Des principes d'affaires, un code de conduite interne ou un label représentent d'autres formes d'information non financière. La publication peut être l'oeuvre interne à l'entreprise (employés) soit celle d'un acteur externe engagé temporairement par la firme (consultants) soit encore d'une instance indépendante (administration publique, organisation internationale, ONG, groupe d'intérêt). L'information peut être produite à des fins tant internes (note, circulaire ou rapport internes) qu'externes (publication périodique ou occasionnelle de brochure ou de rapport). L'information dont il est question ci-dessous est réalisée par un employé ou par un consultant à des fins de diffusion externe 908 .
La publication d'information non financière est une pratique récente dont les origines historiques sont largement anglo-saxonnes. Au cours des années septante, l'information publiée volontairement par l'entreprise concerne essentiellement les conditions de travail et la qualité des produits 909 . Ce type d'information acquiert dans certains cas le caractère d'obligation légale contraignante 910 . La tendance est mise en sourdine par l'orientation très libérale des politiques publiques anglo-saxonnes du début des années quatre-vingts. Face à l'hostilité croissante émanant de la société civile, l'entreprise fait preuve de davantage de transparence en matière sociale et surtout environnementale 911 . La tendance se confirme lors de la première moitié des années nonante 912 . Une telle prééminence des informations environnementales s'explique aisément. Les préoccupations sociales quant à l'impact environnemental de l'activité économique se cristallisent dès 1972 lors de la Conférence de Stockholm et par la publication du célèbre rapport du Club de Rome. Elles sont réitérées en 1987 par le rapport de la Commission Brundtland aux Nations Unies et prennent corps dans l'Agenda 21 défini lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992. Si la notion de développement durable inclut le développement social des populations, la définition de standards environnementaux a progressé plus rapidement du fait du meilleur consensus international en la matière. La concorde internationale en matière de droits de l'homme et du travail est bien moindre puisqu'elle achoppe sur de considérables enjeux politiques.
L'information non financière publiée par l'entreprise a beaucoup augmenté en volume ces deux dernières décennies. Sa qualité demeure inégale au vu de certains thèmes et de certains partenaires. De telles variations s'expliquent par des considérations économiques et politiques. Parmi les facteurs économiques, le concept stratégique de l'entreprise définit la nature et l'étendue de sa communication externe. Son poids économique l'amène également à faire preuve de davantage de transparence du fait de sa visibilité accrue.Le type d'activité de l'entreprise constitue un troisième déterminant. Souvent taxées de «pollueuses», les industries d'extraction et d'exploitation de ressources naturelles (mines, pétrole et gaz en particulier) affichent une meilleure transparence de leurs activités et privilégient l'information environnementale. L'information ventilée par l'industrie chimique tend à rassurer les populations locales sur le risque de dommage environnemental qu'elles encourent. Les industries de biens finaux qui comportent un danger leurs consommateurs -- alcool et cigarettes en particulier -- pratiquent une politique de communication particulièrement ouverte axée sur des questions sociales 913 . Enfin un incident social ou d'un dommage environnemental impliquant une société peut occasionner un revirement spectaculaire de sa politique de communication. Dans une explication de nature politique, le volume et la qualité de la communication externe reflète la nature du dialogue instauré entre l'entreprise et ses partenaires, les rapports de force respectifs entre les partenaires ainsi que l'issue de leur marchandage.
La publication d'information non financière est facilitée si l'entreprise dispose d'un cadre d'action qui définissent des thèmes et des procédures types et qui lui ménage une marge de manoeuvre suffisante. Le Global Reporting Initiative (GRI) représente la tentative la plus complète et la plus récente à cet égard. Initié en 1998 par la Coalition on Environmentally Responsible Economies (CERES) en conjonction avec diverses organisations 914 , le GRI est un outil à disposition de l'entreprise pour rendre compte volontairement de sa contribution à un développement durable dans ses dimensions environnementale, sociale et économique 915 . En phase d'essai pilote, le GRI a rencontré beaucoup d'intérêt parmi les spécialistes. S'il est trop tôt pour évaluer le retentissement de cette initiative, il convient de la mettre à sa juste place. Le GRI est une initiative de reporting. Elle privilégie le compte-rendu public (accountability) de l'entreprise sans s'intéresser beaucoup à la mise en oeuvre proprement dite de son concept de responsabilité sociale.
Le degré de transparence d'une institution reflète sa perception publique, laquelle varie selon les cultures et les moments historiques 916 . La publication d'information non financière de l'entreprise est très souvent une stratégie réactive face à des pression externes et traduit une volonté de pallier son déficit de légitimité 917 . Les réticences des milieux d'affaires sont de deux types. Dans un sens, la transparence opérationnelle contredit une règle d'or des pratiques d'affaires, soit la discrétion voire le secret face à la concurrence. En effet, la visibilité accrue de l'entreprise qui découle d'une politique ouverte de communication externe peut prêter le flanc à des critiques sociales d'autant plus acerbes qu'elles sont bien informées. Sous un autre angle, la transparence accrue de l'entreprise influence favorablement sa perception publique et sa légitimité politique, subséquemment le volume de ses ventes. Certaines sociétés qui usent de technologies controversées -- telles les biotechnologies -- communiquent de façon toujours plus proactive et préventive afin de participer aux débats de société qui concernent directement leurs activités.
2° Les enjeux stratégiques de l'information non financière
L'affirmation citoyenne de l'entreprise est dictée largement par des attentes sociales accrues à son égard. Les réactions de la firme aux attentes sociétales s'échelonnent d'une conception minimaliste rivée au strict respect des requis légaux à une approche maximaliste qui considère l'esprit de la loi pour élaborer des solutions innovatrices conciliant des objectifs économiques et sociaux 918 . L'humain n'est guère prône au changement. Collectif d'individus, l'entreprise présente la tendance comportementale similaire. On peut dès lors définir trois stratégies qui s'ordonnent en un continuum croissant de changement organisationnel 919 :
-
Politique de relations publiques qui vise à influencer par l'information et l'éducation la perception qualitative publique de l'activité économique. Cette dernière demeure inchangée.
-
Stratégie de marketing institutionnel qui vise à modifier les critères symboliques d'évaluation qualitative de l'activité économique. Celle-ci demeure toujours inchangée.
-
Redéfinition effective des objectifs et des performances économiques de l'entreprise afin qu'ils concordent mieux avec les attentes sociales.
La citoyenneté de l'entreprise peut tenir des trois stratégies, étant bien entendu que la qualité de sa mise en oeuvre diffère de cas en cas. Elle relève le plus directement du deuxième, voire du troisième scénario. L'émergence du discours citoyen de l'entreprise est à relier au glissement de principes managériaux intervenu principalement dans les années quatre-vingts. D'une conception bureaucratique et impersonnelle, l'organisation est vue désormais par tout un corps de la littérature managériale comme une sorte d'organisme vivant, mû par les valeurs et par la créativité de ses membres. La transition implique une sorte de collectivisation de la gestion, chacun étant davantage responsable de ses actes. Le défi du management contemporain consiste dès lors à diriger et à motiver des collectifs souvent dispersés géographiquement, d'où le large recours au management par les symboles 920 . La stratégie managériale n'est pas foncièrement nouvelle, car elle modernise en somme la symbolique paternaliste du XIXe siècle.
Le management symbolique recherche à définir culturellement l'entreprise, ainsi qu'à communiquer cette identité culturelle au collaborateur et au marché. Une culture d'entreprise est une construction idéologique censée refléter l'«âme» de l'organisation. Elle se charpente autour de valeurs qui sont autant de guides d'action pour les membres de l'organisation. Le management symbolique met en cohérence les stratégies de marché, de marketing et de ressources humaines dont les enjeux sont respectivement le positionnement sur le marché, l'image publique et l'identité culturelle de l'entreprise. Avec la culture d'entreprise pour base de communication interne et externe, le management symbolique agit simultanément au long de ces trois axes stratégiques 921 .
La citoyenneté de l'entreprise représente une affirmation symbolique aux consonances vertueuses et aux résonances aussi bien internes qu'externes. Comme toute stratégie de management symbolique, l'affirmation citoyenne comporte un risque de manipulation et de séduction 922 . L'affirmation citoyenne peut ainsi potentiellement différer de sa mise en oeuvre. Cette distorsion serait le fruit principalement de deux stratégies managériales : en externe, la politique de relations publiques et en particulier le marketing institutionnel ; en interne, la gestion des ressources humaines et plus précisément la motivation du personnel. Toutes deux participent à l'amélioration de la performance globale de l'entreprise.
La communication externe discrétionnaire répond souvent à une atteinte ponctuelle à l'image de marque de l'entreprise. Elle peut s'adresser à un problème d'image plus fondamental et durable. La plupart des sociétés américaines de chemin de fer disposent dès les années 1830 d'une politique de relations publiques de nature informative destinée à soutenir leur légitimité institutionnelle. A l'aube du XXe siècle, la grande firme managériale américaine généralise la communication de masse afin de contrer l'impopularité de ses pratiques jugées monopolistiques. A la tête de la Standard Oil, Rockefeller recourt à un spécialiste des relations publiques pour améliorer son image d'« homme le plus détesté de l'Amérique 923 . » Les années soixante consacrent aux Etats-Unis l'émergence de mouvements de consommateurs. Face à leurs critiques parfois acerbes, la grande entreprise développe une politique de relations publiques non plus seulement informative, mais aussi stabilisatrice et même manipulatrice de son image de marque 924 .
La fonction de relations publiques est aujourd'hui partie intégrante du concept de marketing. Le marketing intégré vise à une meilleure synergie entre la promotion des produits et celle de l'image de marque, entre le marketing commercial et institutionnel. Le marketing institutionnel associe l'image de marque à la production de biens publics socialement désirables tels que le contrôle de la pollution, la préservation du milieu naturel, le respect des minorités ou la qualité de vie de la communauté locale 925 . La firme vend alors des valeurs et une philosophie d'affaires qui sont peut-être siennes, mais qui sont plus sûrement appréciées par son milieu social. Le marketing intégré combine ainsi la communication commerciale, financière et institutionnelle.
Le marketing institutionnel est une communication de crise qui s'est beaucoup développée dès la seconde moitié des années quatre-vingts 926 . Face aux fortes turbulences économiques et sociales, l'entreprise a tendance à jouer les caméléons pour mieux se protéger et assurer sa légitimité politique. Le marketing institutionnel vise en externe à la satisfaction ponctuelle, médiatisée et souvent cosmétique des attentes sociales envers l'entreprise. Au coeur de l'organisation, il renforce l'esprit de corps de l'entreprise. La communication institutionnelle distille en externe un message d'adaptation de l'entreprise à son milieu opérationnel alors qu'elle scande en interne un credo identitaire en termes de valeurs refuge 927 .
Le but ultime de la communication non financière de l'entreprise est de nature commerciale. A ce titre, le marketing contemporain, quel que soit son type, tente de renforcer le lien qui unit l'entreprise et ses produits au consommateur. D'une stratégie conçue pour satisfaire le plus grand nombre, le marketing évolue en effet vers une approche individualisée, caradaptée aux besoins, aux désirs et aux valeurs du consommateur 928 . Le marketing tente ainsi de fidéliser le consommateur en suggérant l'identité ou du moins la compatibilité des valeurs de celui-ci avec celles véhiculées par l'entreprise et ses produits. L'individu opère ses choix de consommation non seulement selon des critères objectifs et directement comparables comme la qualité ou le prix du produit. Il considère également des paramètres subjectifs tels que ses besoins émotionnels, ses préoccupations en termes de santé et de bien-être, des postulats sur la fiabilité et la commodité des produits par rapport à ses besoins 929 . La satisfaction du consommateur, condition sine qua non de sa fidélisation, est ainsi très liée à l'image qu'il a ou qu'on lui projette du produit et de l'entreprise 930 .
-
Motivation du collaborateur
Le contexte et la signification sociale du travail ont profondément changé depuis la première industrialisation. Une frange appréciable de la population active des pays industrialisés ne se satisfait pas des seules motivations pécuniaires comme stimulant de son ardeur à la tâche. Les potentialités de réalisation personnelle comptent de façon significative dans cette appréciation. Ceci étant, l'évolution récente signifierait plutôt un renversement de tendance, par la précarisation des conditions de travail et la diffusion de la rémunération au mérite. Quoi qu'il en soit, les théories et les méthodes de motivation au travail paraissent inadéquates pour résoudre la crise contemporaine de la motivation au travail 931 . Ces théories sont récentes -- elles datent pour la plupart d'une quarantaine d'années. Elles paraissent avoir insuffisamment évolué durant ce laps de temps.
Les politiques d'encadrement du personnel demeurent longtemps tributaires de leur conception tayloriste. Au début du XXe siècle, le taylorisme postule la tendance «naturelle» de l'humain à la paresse et à l'indolence. A cette faiblesse humaine ne peuvent remédier qu'un système disciplinaire intransigeant et des incitations pécuniaires. Le fordisme ne se départit pas vraiment de ce postulat, en dépit d'une politique novatrice de rémunération 932 . Cette prémisse de paresse humaine n'est invalidée que dans les années trente par l'école des relations humaines 933 . La psychologie du travail persiste longtemps encore dans l'idée qu'un salaire élevé représenterait la source par excellence de motivation au travail. Dans les années cinquante, Abraham Maslow ébranle cette idée reçue en soutenant que l'ardeur à la tâche de l'individu est tributaire de la satisfaction de ses divers besoins physiologiques et psychologiques, besoins qu'il serait possible de hiérarchiser 934 . Or la rémunération matérielle du travail ne satisfait que partiellement ces divers besoins. La motivation au travail est également fonction du contenu qualitatif de l'activité et notamment de sa variété. Dans les années soixante, Frederick Herzberg est plus incisif encore par la distinction du contenu du travail et de son contexte. Le contenu du travail est influencé par des facteurs «motivateurs» (responsabilité, promotion, réussite, intérêt pour le travail), alors que le contexte du travail dépend de facteurs d'«hygiène» (politiques de rémunération et de ressources humaines, qualité des conditions matérielles, opérationnelles et sociales de travail). Selon Herzberg, l'efficacité d'une politique efficace d'encadrement du personnel dépend des facteurs motivateurs comme la responsabilisation du travailleur, et non pas des facteurs d'hygiène tel le salaire 935 .
Les années soixante voient également l'élaboration de divers modèles cognitifs qui taillent en pièces l'idée d'une rationalité unique qui sous-tendrait la motivation au travail 936 . La perception qu'a l'individu de son environnement professionnel influence considérablement sa motivation. Cette perception est influencée par des variables psychologiques, situationnelles et temporelles. Récemment, on a pu démontrer l'importance de l'effet de but -- soit le désir d'atteindre un certain niveau de performance -- dans la motivation de l'individu au travail 937 . La force de cet effet de but n'est forcément liée à une rémunération, pas plus qu'elle ne requiert la réalisation effective de l'objectif. Elle découle de la nature de l'objectif ainsi que de la force psychologique associée à sa réalisation.
Les méthodes d'encadrement du personnel et de stimulation de sa motivation sont restées très proches des vues tayloristes durant le premier XXe siècle. La gestion des ressources humaines en tant que sous-discipline de la gestion d'entreprise n'émerge que dans les années cinquante aux Etats-Unis avec pour objectif la valorisation du facteur humain 938 . Face aux succès commerciaux de l'entreprise japonaise, la gestion professionnelle des ressources humaines se développe durant les années septante parmi les firmes américaines puis européennes. Le savoir-faire de l'employé est reconnu comme un avoir à gérer rationnellement et un investissement à faire fructifier. Conformément aux conclusions d'Herzberg, l'employé est davantage responsabilisé dans son travail, ce qui permet de relâcher les tâches improductives de contrôle 939 .
Lors de la décennie quatre-vingts, la gestion des ressources humaines devient toujours plus stratégique. Elle épouse les exigences de nouvelles méthodes d'organisation sociale du travail fortement inspirées du modèle japonais, tels les cercles de qualité, le contrôle total de la qualité ou la participation des employés à certains types de décision en matière de production. La politique de motivation du personnel est mieux associée aux options générales de l'entreprise 940 . La tendance actuelle vise à un idéal d'excellence de la qualité, d'autogestion de cellules de travail, d'enrichissement des tâches et d'aplatissement des hiérarchies. Un tel concept de travail est pensé pour valoriser le travail à tous niveaux hiérarchiques. Même à un échelon subalterne, il fait appel à davantage de compétences cognitives actives, tout comme il multiplie les opportunités de contact social. La responsabilisation accrue de l'employé est censée renforcer sa motivation. Elle peut induire l'effet contraire, vu l'augmentation de la charge nerveuse subséquente 941 . En tout état de cause, l'impact effectif de ces techniques de motivation du personnel est loin d'être démontré empiriquement 942 .
Le bref survol théorique effectué plus haut permet de comprendre le fondement de ces incertitudes. Les thèses de Maslow et d'Herzberg suggèrent que la motivation au travail procède de l'adéquation entre d'une part les besoins et les aspirations des collaborateurs, d'autre part les conditions de travail et la politique d'encadrement du personnel. Sous un angle plus cognitif et psychologique, l'élément perceptif et l'effet de but de l'individu au travail concourent à soutenir sa motivation. Les méthodes actuelles de gestion des ressources humaines tiennent compte de la satisfaction des besoins matériels et dans une certaine mesure des aspirations à la réalisation personnelle de l'individu. Le contexte sociopsychologique du travail paraît toutefois manquer d'un élément essentiel : la sérénité. Le travail contemporain, s'il procure un sens élevé de responsabilité à l'individu, s'effectue dans un contexte de stress difficilement supportable. L'élévation de la productivité du travail, l'irrégularité des horaires, la précarisation de l'emploi et la désolidarisation des carrières 943 tendent les relations professionnelles et érodent la motivation du collaborateur. Faute de sérénité, l'individu ne peut faire sien un objectif productif défini par la direction. Il se perçoit comme doublement victime de l'évolution contemporaine du contenu et du contexte du travail. Il subit pour une part le durcissement des conditions d'exercice de son activité professionnelle. Relais social entre l'organisation et son milieu, il enregistre d'autre part l'accroissement de l'hostilité sociale envers l'entreprise. Membre d'une organisation socialement contestée, l'employé peine à se motiver dans son travail, taraudé qu'il est par l'incompatibilité qu'il perçoit entre les objectifs productifs assignés et de sa sensibilité de citoyen.
Les politiques de ressources humaines tentent de résoudre quelque peu le dilemme vécu par le collaborateur. Les actions philanthropiques en faveur des communautés locales visent bien au renforcement du lien symbolique et concret qui unit l'entreprise à la société. L'employé se fait au travers de son engagement communautaire le héraut d'une stratégie d'amélioration de l'image de marque. L'engagement citoyen de l'entreprise serait alors une stratégie intégrée de gestion de ressources humaines et de marketing institutionnel. Au sein de l'organisation, la référence citoyenne émet un message réflexif suggérant l'égalité sociologique des collaborateurs en dépit de leurs différences statutaires et fonctionnelles. En externe, la citoyenneté de l'entreprise exprime un message transitif qui claironne sa responsabilité et son appartenance sociales 944 . L'affirmation citoyenne de l'entreprise n'est pas ambiguë parce qu'elle comporte des objectifs commerciaux et stratégiques. Elle l'est davantage si le discours se traduit peu ou pas en actes. En l'espèce, les deux fils rouges de l'engagement citoyen seraient d'une part le respect du collaborateur et l'attention portée à la définition qualitative de son travail, d'autre part le souci d'une insertion véritable de l'entreprise dans son environnement social.
B. Les solutions de droit privé
La formulation de normes internationales contraignantes relatives aux entreprises transnationales fait long feu durant les années septante. Le processus est victime des clivages politiques Nord-Sud qui enterrent également l'idée d'un nouvel Ordre économique international (NOEI) plus favorable aux pays du Sud. Depuis lors, la régulation comportementale publique de l'entreprise transnationale privilégie l'incitation et la pression, et implique une consultation plus directe du secteur privé dans son élaboration. C'est dire que ces règles tiennent à la fois de la régulation et de l'autorégulation dans un contexte de gouvernance tripartite entre les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile. Les principes cadre ou les lignes directrices (guiding principles) adoptés depuis lors par différents fora intergouvernementaux présentent un caractère non contraignant pour les entreprises. Les Etats signataires attendent et promeuvent cependant le respect de ces principes 945 . Leur champ thématique est tantôt très étendu tantôt très spécifique 946 . Leur contenu est négocié entre représentants de gouvernements et implique souvent une procédure de consultation des milieux d'affaires et d'ONG.
Les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales illustrent ce cas de figure. Récemment révisé 947 , l'instrument demeure non juridiquement non contraignant vis-à-vis de l'entreprise transnationale, mais exprime de claires attentes comportementales à son égard. Il fournit un cadre d'action à sa citoyenneté globale et locale 948 . Son champ élargi aborde à présent les thèmes suivants : transparence opérationnelle, lutte contre la corruption et respect de la concurrence, R&D et transfert technologique, protection de l'environnement, qualité des relations de travail et défense des consommateurs. Sa révision a impliqué des négociations entre des délégations gouvernementales, des représentants du secteur privé et de la société civile. Dans son application, les pouvoirs publics assument une fonction de médiation entre les entreprises et les ONG au sein d'un point de contact national (PCN) 949 .
En parallèle à de tels instruments intergouvernementaux de promotion de la responsabilité sociale de l'entreprise se multiplient depuis quelques années les solutions de droit privé. Ces initiatives privées émanent de la société civile ou du secteur privé. Elles impliquent dans leur élaboration et leur application très souvent une pluralité d'acteurs y compris les collectivités publiques. Les obligations comportementales qui en découlent pour l'entreprise sont de nature contractuelle et morale. Celle-ci formalise alors ses engagements par l'adoption de principes d'affaires ou d'un code de conduite, voire souscrit à une procédure de certification en vue de l'obtention d'un label. A l'instar d'un rapport social ou environnemental, ces différents instruments «normatifs privés» constituent un mode d'information publique de nature non financière. Ils représentent diverses solutions de droit privé à la régulation de la vie économique.
L'opinion publique occidentale est plutôt suspicieuse envers la grande entreprise et ses dirigeants 950 . Pour une part, l'activisme de certains groupes sociaux contribue à la prolifération de solutions de droit privé. D'autre part, la société civile dans son ensemble est davantage informée et sensibilisée qu'autrefois et se montre plus critique vis-à-vis de l'information publiée 951 . En somme, cette information participe à une forme d'autorégulation de l'entreprise. Affirmer sa responsabilité sociale en la justifiant par l'information publique revient à revendiquer une autonomie comportementale. Mais les sociétés au profil social affirmé ne sont pas forcément les plus socialement responsables 952 . L'évaluation d'une affirmation la crédibilise publiquement. L'audit social répond partiellement à cette exigence. L'évaluation du discours et des pratiques sociales de l'entreprise butte aujourd'hui encore sur le manque de fiabilité et surtout d'universalité des méthodes et des critères d'audit, en dépit de progrès considérables accomplis depuis trois décennies.
1° L'audit social
L'audit social collecte et vérifie à des fins publiques des données sociales et environnementales relatives à l'activité de l'entreprise. Il évalue le bien-fondé et la qualité des principes, procédures et performances de celle-ci. Il requiert un certain degré d'indépendance vis-à-vis de l'entreprise. L'audit social comprend deux variantes. Il peut être l'oeuvre d'un consultant permanent ou temporaire et rédigé sous la forme d'un rapport de consultance destinée au management. Alternativement, il est effectué par une instance externe et indépendante de l'entreprise et produit à des fins publiques 953 . L'audit social effectué par le consultant offre un degré d'indépendance moindre que la vérification externe. L'information non financière publiée par l'entreprise est l'oeuvre d'un salarié permanent (collaborateur) ou temporaire (consultant). Salariés de l'entreprise, le collaborateur ou le consultant sont mandatés par l'organisation pour une fonction d'information publique. Dans les termes d'une relation d'agence, l'employé ou le consultant est l'agent du respect du droit à l'information dont jouit le principal, soit les partenaires de l'entreprise. Or cet agent n'est pas indépendant de l'entreprise vu le rapport monétaire qui unit les deux parties. D'où le risque que l'information publiée reflète imparfaitement les faits 954 . L'information crédible est complète, fiable, vérifiable, cohérente, comparable et compréhensible 955 .
Lors du premier XXe siècle, l'audit évalue aux Etats-Unis essentiellement la responsabilité financière des managers vis-à-vis de l'actionnaire ou du créditeur et s'effectue par l'engagement ponctuel de consultants. L'idée d'un audit social est contemporaine du New Deal rooseveltien et naît des perturbations sociales induites par une période d'industrialisation intense. L'audit social interroge alors largement la capacité de l'entreprise à satisfaire les besoins sociaux sans développer réellement d'outil méthodologique d'évaluation. La relecture critique du rôle social de l'entreprise à la fin des années soixante marque l'essor des techniques d'audit social. Celui-ci prend un tour comptable et évalue l'impact social de l'entreprise par un ratio coûts/bénéfices. Cette approche quantitative de l'audit social connaît un brusque coup d'arrêt à la fin des années septante, victime la complexité de sa mise en oeuvre et de la subjectivité de ses critères d'analyse 956 .
L'approche sociologique et politologique de l'audit social qui se développe au cours des années quatre-vingts fonde la notion de citoyenneté de l'entreprise. L'audit social se veut alors un outil décisionnel pour le manager d'évaluation des programmes concrets. Il se focalise sur le dessin des stratégies managériales ainsi que les processus de leur mise en oeuvre. Il recherche l'identification des partenaires de l'entreprise plutôt que la mesure de l'impact social de l'activité économique 957 . L'audit social considère, outre les aspects financiers et les contrats formels, le degré de confiance et de loyauté entre les partenaires ainsi que l'effectivité de leur dialogue au sein de l'entreprise 958 . En pratique, l'audit social se concrétise à la fin des années quatre-vingts surtout par sa dimension environnementale 959 . Les années nonante confirment la tendance en y adjoignant une composante éthique 960 .
L'audit social comporte une incontournable composante normative. Il évalue la responsabilité sociale de l'entreprise au regard d'un référentiel normatif et corrélativement de sanctions de nature éthico-légale. L'audit social permet le regard de la société sur les activités de l'entreprise et représente un mécanisme de contrepoids à sa puissance 961 . Il permet en retour à l'entreprise de suppléer à son déficit de légitimité. La concomitance n'est pas fortuite entre d'une part la crise de confiance envers l'entreprise, d'autre part l'essor de la publication d'informations non financière et des techniques d'audit social 962 . Mais l'audit social a-t-il vocation de contrôle policier ou de critique constructive ? Considérer la consultance comme une critique constructive et la vérification indépendante comme un contrôle policier serait par trop simpliste et caricatural. L'audit social est un ensemble complexe et paradoxal de surveillance et de confiance 963 . Contrôle policier, il manquerait singulièrement d'effectivité vu le faible pouvoir contraignant de ses conclusions. Critique constructive, il accorde sa confiance à l'entreprise pour qu'elle améliore son impact social. L'entreprise jouit en quelque sorte d'une liberté conditionnelle dont l'audit représente le garant.
L'audit a lui-même à prouver sa légitimité, faute de quoi il est vide de sens ou exprime une démarche policière. Son principe et ses modalités doivent être acceptés par le principal (le lectorat public du rapport d'audit) et par l'agent (l'entreprise auditée). L'effectivité de l'audit social représente une autre difficulté majeure. Elle dépend pour une bonne part du degré d'indépendance de l'instance de vérification. Dans les termes de la relation d'agence exposée plus haut, l'effectivité de l'audit est fondamentalement viciée du fait que le vérificateur est mandaté non par le principal (le lectorat public du rapport d'audit), mais par l'agent (la firme auditée). L'audit risque donc d'être trop complaisant de vis-à-vis de l'entreprise examinée. Si le rapport de consultance commandé par le management comporte bien sûr un tel risque, la vérification indépendante d'information non financière publiée par l'entreprise n'en est pas exempte non plus. Une récente étude documentaire des meilleurs rapports environnementaux publiés au Royaume-Uni conclut que la moitié de ces documents sont en fait des rapports de consultance destinés au management et réécrits dans un second temps à des fins de communication externe pour évoquer une vérification indépendante 964 . De telles pratiques profitent également au Big Five 965 . Les plus grandes sociétés d'audit et de conseil étendent en effet leur prestations du domaine financier aux questions sociales et environnementales 966 . Rares sont en effet les entreprises qui recherchent hors de leurs murs un service soit de conseil, soit d'audit. Elles souhaitent une approche intégrée de ces deux volets d'expertise externe.
La responsabilité sociale des entreprises fait l'objet de toute une gamme de pratiques qui s'échelonnent de la rhétorique générale à une démarche rigoureuse d'action et de contrôle en passant par l'engagement ponctuel. La rhétorique vise à préserver l'entreprise des pressions sociales et à écarter l'éventualité de régulation publique contraignante. Le décalage entre le discours et la pratique sociale intervient également dans le sens inverse, car certaines entreprises préfèrent un engagement citoyen discret 967 . En tout état de cause, ce décalage porte préjudice tant à la société parfois trompée par un discours lénifiant qu'à l'entreprise dont les pratiques sociales sont ternies par un climat de méfiance généralisée. Seuls des outils fiables et sûrs d'évaluation de la responsabilité sociale de l'entreprise paraissent à même de lever l'équivoque.
2° Les principes cadre et le code de conduite interne
Les solutions de droit privé à la régulation de l'activité économique prolifèrent depuis quelques années. Indépendamment de leur qualité intrinsèque, elles varient considérablement en nature et en caractère. L'énoncé de principes cadre, le code de conduite et le label social expriment un continuum croissant de contrainte imposée à l'entreprise.
Les principes cadre et le code modèle sont des instruments non contraignants. Ils sont élaborés soit au niveau intergouvernemental soit au sein du secteur privé et de la société civile. Ils ont pour vocation commune de servir de cadre d'action à l'activité de l'entreprise et de référence lors de l'élaboration d'un instrument plus spécifique. Ils sont particulièrement utiles aux PME qui ne disposent pas des ressources financières pour le développement complet d'un outil de ce type. Les principes cadre issus du secteur privé sont relativement nombreux. Leur élaboration répond à deux considérations. Ils expriment un message collectif fortement politisé envers les collectivités publiques et la société civile, et exprime à cet égard une stratégie souvent réactive face à un climat social plutôt défavorable. Ils promeuvent en outre les meilleures pratiques d'affaires parmi les entreprises (internal benchmarking) 968 . De caractère essentiellement déclaratoire, l'instrument peut ultérieurement servir de base à des programmes concrets d'action individuelle ou collective 969 . Il inspire souvent l'élaboration de normes sectorielles 970 , de labels de produits et de codes de conduite. Les principes cadre élaborés par la société civile sont légion. Ils sont tantôt à vocation générale, tantôt plus spécifique 971 . Les entreprises transnationales leur reconnaissent généralement une valeur de référence externe (external benchmarking) pour l'établissement de leurs propres instruments, surtout si elles ont été associées à leur élaboration. Ce type d'instrument favorise par ailleurs la mise au point de codes de conduite modèle ou de labels proposés au secteur privé souvent par des collectifs hybrides 972 . Il peut également inspirer une entreprise pour la rédaction de ses principes d'affaires, de sa charte éthique ou de son code de conduite interne.
Le code de conduite interne, la charte éthique ou les principes d'affaires représentent diverses formes d'une même déclaration publique et discrétionnaire de l'entreprise. L'instrument explicite les valeurs et principes qui orientent son activité et ses relations avec ses divers partenaires 973 . Il représente en interne la garantie de ses meilleures pratiques sociales, garantie consolidée par leur publication externe. L'entreprise définit au travers du code de conduite le niveau et la forme de responsabilité sociale qu'elle entend atteindre et respecter. Un tel engagement public de l'entreprise vise à éviter que son image de marque ne soit associée à des pratiques socialement désapprouvées, tel le travail des enfants, le travail forcé, les violations des droits de l'homme ou la dégradation inconsidérée de l'environnement naturel. Le code de conduite interne est essentiellement un engagement comportemental de nature morale. L'entreprise solennise ainsi la publication discrétionnaire d'information non financière. L'engagement comportemental de l'entreprise peut devenir contractuel et plus contraignant s'il implique un autre acteur dans sa mise en oeuvre et son contrôle.
Les premiers codes de conduite modernes sont élaborés au début du XXe siècle. Ils concernent d'abord la publicité et la commercialisation des produits puis s'étendent lors dans les années soixante et septante aux pratiques de gestion interne. A cette époque sont proposés aux entreprises les premiers codes de conduite à consonance sociale et munis d'un dispositif de vérification 974 . Leur caractère relativement contraignant et la spécificité de leur objet leur interdit tout succès d'ampleur. Sous la pression sociale croissante, les codes de conduite prolifèrent durant les années quatre-vingts et nonante en particulier sur les marchés anglo-saxons. Les codes de conduite varient fortement en leur substance. Ils énoncent majoritairement des principes généraux d'éthique économique sans préciser par exemple les conditions de travail ou les critères de sélection de partenaires d'affaires. Quant aux codes plus explicites, ils demeurent souvent très spécifiques : le document considère une thématique très médiatisée, un sous-ensemble des partenaires de l'entreprise, une portion du procès productif ou commercial. Les codes de conduite au spectre élargi à l'ensemble des partenaires et de la filière productive sont encore relativement peu nombreux 975 .
Le code de conduite interne constitue souvent une réponse ad hoc aux pressions médiatisées émanant de la société civile et de collectivités publiques. Si tous les secteurs économiques connaissent l'essor des codes de conduite, la visibilité sociale de l'activité productive ainsi que la proximité du produit par rapport au consommateur déterminent grandement l'ampleur du phénomène. La majorité des codes concernent ainsi les industries du textile, de l'habillement et de la chaussure (THC). Le commerce alimentaire de détail, l'industrie du jouet, la chimie ou encore la foresterie sont particulièrement avancés en la matière. Fort logiquement, le choix des thèmes abordés dans les codes de conduite reflète souvent les préoccupations sociales véhiculées par les médias. Ainsi les industries THC abordent souvent les thèmes du travail des enfants et du travail forcé, alors que l'industrie chimique et du jouet se focalisent sur la santé et la sécurité du travailleur et du consommateur. La sensibilité publique face à ces problèmes sociaux représentent une autre explication. Elle est particulièrement élevée dans le monde anglo-saxon. Les grandes sociétés américaines et anglaises ont abondamment souscrit au principe d'un code de conduite 976 .
Il est quatre types de base normative à un code de conduite : l'autodéfinition par l'entreprise, la référence à des normes sectorielles, nationales ou internationales. L'autodéfinition est prépondérante. La législation nationale est la seconde source normative en importance, suivie par la norme sectorielle. La plupart des codes reflètent en l'espèce les obligations minimales légalement ou collectivement définies. En queue de liste interviennent les normes, principes et valeurs définis à l'échelon international 977 . Si la non-discrimination au travail est fréquemment mentionnée, la liberté syndicale et le droit à la négociation collective sont largement passés sous silence 978 . Beaucoup de codes de conduite n'assurent ainsi pas le respect des droits fondamentaux du travailleur 979 .
Le code de conduite interne comporte plusieurs travers potentiels. Tout d'abord, le manque de précision de la nature et de la portée des engagements qu'il contient les rend difficilement évaluables et comparables entre eux, surtout par le consommateur non averti 980 . Ensuite le contenu du code ne reflète pas toujours sa mise en pratique, d'autant plus que les contrôles indépendants sont rarissimes. Le contrôle d'application du code satisfait rarement aux deux exigences fondamentales pour sa validité, à savoir l'indépendance par rapport à l'entreprise de l'instance de vérification ainsi que le caractère inopiné de la démarche de contrôle. En pratique la plupart des firmes font contrôler l'application par un auditeur externe de leur choix qu'elles rémunèrent. Enfin le contenu voire l'existence du code de conduite sont méconnus des employés de l'entreprise. Pour son effectivité, un code suppose des procédures de gestion et de formation interne. Celles-ci paraissent insuffisamment développées et dotées en ressources humaines et financières 981 . Cette lacune est particulièrement criarde dans les pays en développement 982 où le code de conduite n'est pas toujours traduit dans la langue nationale. Cet instrument peut alors manquer son objectif premier, soit l'homogénéisation relative parmi les filiales étrangères de la société multinationale des conditions de travail et de l'attitude envers la communauté locale.
La mise en oeuvre de codes de conduite rencontre d'autres difficultés. Tout d'abord les meilleurs codes de conduite internes traitent de l'ensemble des partenaires de l'entreprise et du processus productif et commercial. Or la mise en oeuvre et plus en encore le contrôle d'application de tels codes sont particulièrement difficiles et complexes pour une multinationale globale en raison du nombre élevé de ses partenaires et de la brièveté de certaines relations d'affaires 983 . Ensuite les codes de conduite ne s'adressent en général pas au travail à domicile -- forme d'activité des plus répandues dans les pays en développement. Enfin un code de conduite interne, si bon soit-il, ne saurait se substituer des principes d'affaires définis par consultation et négociation avec les partenaires de l'entreprise ou par les collectivités publiques. Le collaborateur -- des pays en développement tout particulièrement -- est encore trop peu impliqué dans l'élaboration des codes alors qu'il représentent le partenaire le plus concerné par sa mise en oeuvre. Trop de codes de conduite n'envisagent pas le développement humain, notamment par le capacity building, des collaborateurs auxquels ils s'appliquent.
Par un code de conduite interne, l'entreprise transnationale affirme son intégrité comportementale et sa responsabilité sociale, tout comme elle offre en principe une meilleure transparence de ses activités. Il comporte plusieurs faiblesses notoires -- son caractère trop déclaratif et général, son implémentation inégale et sa vérification lacunaire -- qui limitent considérablement sa crédibilité publique. Le secteur privé en a conscience, mais n'entend guère pallier ces lacunes afin de se ménager une liberté d'action maximale 984 . L'attitude est compréhensible d'un strict point de vue managérial, encore que l'importance économique de la transparence opérationnelle croît considérablement 985 . L'attitude est en revanche moralement intolérable. Lorsqu'il dissimule des pratiques d'affaires moins louables, le code de conduite représente une manifestation bien creuse de la responsabilité sociale de l'entreprise, assimilable à une démarche de marketing institutionnel. A ce titre, le code de conduite doit être tenu pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme une simple initiative privée qui ne saurait se substituer à des dispositions légales contraignantes lorsqu'il s'agit de réguler l'activité économique.
3° Le label social
Le label social est un mode d'information publique sur les conditions de travail et sur l'impact social de la fabrication d'un bien ou la prestation d'un service. Son attribution implique une forme d'évaluation et de certification plus ou moins indépendante de l'entreprise. Vis-à-vis du consommateur et des partenaires commerciaux, le label est un gage de qualité et de confiance. Il garantit un procès de production qui respecte des critères éthiques, écologiques, sociaux ou politiques. Pour l'entreprise, l'attribution d'un label social à l'un de ses produits ou à sa raison sociale crédibilise la publication d'informations sociales sous forme documentaire ou par un code de conduite.
Il est toute une variété de prix, de distinctions et autres labels concernant la responsabilité sociale de l'entreprise. Le prix et la distinction sont décernés sans consultation préalable ni implication directe de l'entreprise, sur la base de ses réalisations ou de ses publications. Le monde anglo-saxon est friand de telles distinctions qui sont décernées principalement par des ONG, des fondations privées, des associations professionnelles, voire par des collectivités publiques 986 . En revanche, l'attribution du label social exige une requête explicite de l'entreprise en ce sens ainsi que sa participation directe et active à la procédure de certification. Par rapport au code de conduite interne, le label social est une marque distinctive plus contraignante pour l'entreprise et plus crédible pour la société. Sa base normative est généralement plus solide, encore que ce point soit sujet à caution.
Le label social repose sur une norme sociale. En référence à la production d'un bien ou à la prestation d'un service, la norme sociale définit un certain nombre de règles à respecter en matière de conditions de travail et d'impact social de l'activité économique. La norme sociale s'adresse à une question de fond ; elle est donc de nature substantive ou juridique. La norme sociale ne comporte pas forcément de caractère obligatoire. L'entreprise qui décide volontairement de se conformer à une norme sociale non obligatoire s'engage au respect de sa substance définie au travers d'un certain nombre de «clauses». Le respect par l'entreprise de la norme sociale peut rester discret ou faire au contraire l'objet d'une ample publicité. Dans ce dernier cas, l'entreprise peut recourir à une procédure de certification pour crédibiliser son affirmation.
La certification aboutit à l'octroi d'une marque distinctive -- d'un label -- au bien ou au service ou encore à l'entreprise. La relation entre l'entreprise et l'organe de certification est alors de type contractuel. L'entreprise se soumet à la procédure. L'instance de certification s'engage à l'octroi de la marque distinctive si les normes requises sont satisfaites. La certification fait appel à une ou plusieurs normes sociales qu'elle complète par des normes techniques ou procédurales. Les premières représentent en quelque sorte l'objectif ou la référence normative, alors que les secondes définissent les règles techniques et les moyens de contrôle. La certification possède en général une ambition universelle bien que cette universalité soit souvent limitée en pratique.
Il n'est pas de corpus cohérent de normes sociales ou techniques, nationales ou internationales, relatifs à la citoyenneté de l'entreprise. La thématique est partiellement couverte par le droit international de l'environnement et les droits internationaux du travail et les droits de l'homme. Les normes techniques applicables à la responsabilité sociale de l'entreprise sont plus nombreuses. Sur le plan international, l'instance par excellence d'élaboration normative est l'Organisation internationale de normalisation (en anglais ISO). Par ses normes ISO 9000 et ISO 14000, cette organisation définit des règles techniques universelles en matière respectivement de qualité de biens et de services ainsi que de préservation de l'environnement naturel. Ces normes sont à la fois substantives et procédurales, établissant à l'égard de l'entreprise désireuse de s'y conformer des objectifs qualitatifs minimaux et des processus pour les atteindre. Une instance externe de vérification s'assure de leur respect. En matière sociale, l'organisme de certification peut se référencer explicitement à une norme sociale à l'universalité avérée, telle une convention de l'OIT ou une déclaration des Nations Unies. Son travail consiste dès lors en l'élaboration des normes techniques permettant le respect de la norme sociale. A contrario, l'instance de certification peut arrêter tant la norme substantive que procédurale. Les deux labels SA8000 et AA1000 reflètent chacun des termes de l'alternative.
Le label social est entaché d'une ambiguïté fondamentale. La crédibilité publique du label est fonction de la qualité de son contenu normatif et de l'efficacité du contrôle de son application alors que son succès commercial dépend notablement de sa souplesse d'application. La référence formelle éventuelle du label à une norme sociale internationale illustre le dilemme : elle crédibilise pour une part la substance normative du label alors qu'elle en fait souvent pour l'entreprise un instrument trop peu souple, inadapté aux dures conditions concurrentielles des marchés internationaux 987 . L'organisme d'élaboration du label peut être ainsi écartelé entre d'une part un objectif qualitatif de précision et de rigueur, d'autre part un objectif commercial de large diffusion.
Le label représente en pratique davantage un phénomène commercial de promotion qualitative d'un produit et de choix stratégique de partenaires d'affaires qu'il ne constitue un réel développement législatif ou réglementaire 988 . La forte visibilité sociale du produit et sa proximité vis-à-vis du consommateur sont essentiels au succès commercial du label. Le phénomène touche en priorité la production de l'industrie THC et du secteur alimentaire ainsi que les biens de luxe. Son objet est tantôt très spécifique tels que les tapis noués à la main, les ballons de football ou les fleurs coupées, tantôt plus général -- textile et habillement. Les pratiques visées par les labels sont essentiellement le travail des enfants et le niveau salarial, dans une moindre mesure la sécurité, la santé et la non-discrimination au travail 989 .
Lancés voici une vingtaine d'années, les premiers labels écologiques préparent en quelque sorte le foisonnement récent de labels en tous genres. L'écologie demeure un thème de prédilection alors que les questions sociales sont abordées surtout par le commerce équitable et le travail des enfants. A l'instar du code de conduite, le phénomène du label répond avant tout à l'accroissement des attentes publiques en matière de comptabilité sociale de l'entreprise. Contrairement au code de conduite, le label contemporain est le plus souvent conçu par une instance indépendante de l'entreprise -- ONG, association professionnelle, industrielle ou syndicale, collectivités publiques ou encore collectif de celles-ci. Ce label indépendant n'est pas spécifiquement attaché à un seul produit ou à une seule entreprise. Il est ainsi peu attractif pour une société très portée sur le marketing institutionnel. Le label social majore les coûts de production et de vente du produit certifié et peut engendrer des effets sociaux pervers 990 . Enfin sa compatibilité avec la législation nationale ou internationale n'est pas toujours avérée.
L'évaluation de la portée générale du phénomène du label paraît malaisée, en raison tant de la pléthore des labels que de leur manque de comparabilité directe. Les différents labels manquent de transparence méthodologique, de solidité normative et de vérification indépendante. Ils gagneraient en homogénéité et en crédibilité si leur conception, leur application et leur contrôle s'effectuaient de façon plus concertée avec divers acteurs privés et publics pour s'insérer dans de véritables politiques sociales nationales et internationales 991 . Le label social prouve toutefois son utilité. Par son approche incitatrice plutôt que policière, il contribue à l'amélioration effective des conditions sociales de travail et au plus fidèle respect des législations en vigueur. Le label facilite en outre le dialogue et le consensus parmi les divers acteurs sociaux concernés par son élaboration et sa mise en oeuvre. Il provoque en outre un effet d'entraînement et d'émulation entre des firmes concurrentes 992 .
Le label social idéal devrait rendre compte tant des pratiques sociales de l'entreprise que de ses politiques d'information et de dialogue vis-à-vis de ses partenaires, sans omettre les progrès réalisés depuis la précédente évaluation. Les normes sociales internationales formeraient un cadre général d'évaluation que compléteraient des normes techniques plus spécifiques dans leur formulation et plus souples dans leur mise en oeuvre. Pour sa crédibilité, un label devrait impliquer dans sa conception, son application et son contrôle une variété d'acteurs sociaux et de compétences -- milieux d'affaires, organisations internationales, administrations publiques, ONG, associations diverses, sociétés d'expertise et de conseil. Son champ d'analyse devrait couvrir l'ensemble des partenaires de l'entreprise. La certification consisterait moins en une démarche inquisitrice et policière que formatrice ; elle se concevrait, en d'autres termes, moins comme une épreuve ponctuelle qu'un processus continu d'amélioration. Ceci requiert en retour une attitude coopérative, transparente et proactive de la part de l'entreprise. La certification doit néanmoins prévoir une forme de vérification indépendante.
Les labels sociaux ou grilles d'évaluation de la responsabilité sociale de l'entreprise émanent essentiellement du secteur privé -- de groupements d'entreprises ou d'associations professionnelles, d'instituts de recherche ou de consultants plus ou moins indépendants des entreprises et d'ONG. Les divers labels sociaux divergent notablement dans leur objectif et dans leur substance Certaines certifications en vue de l'octroi d'un label sont conçues à l'échelon national, d'autres traitent d'un sous-ensemble des partenaires de l'entreprise, d'autres encore se concentrent sur des thèmes spécifiques tels que la gestion et les procédures internes, les conditions de travail, les droits de l'homme ou encore les questions environnementales 993 . Il est somme toute très peu de labels qui tentent de rendre compte de l'entièreté du champ thématique de la responsabilité sociale de l'entreprise. Plusieurs tentatives en ce sens sont en cours d'élaboration ou dans une phase récente de leur application. Les labels SA8000 et AA1000 comptent parmi les tentatives les plus complètes.
Social Accountability 8000 (SA8000) est un label élaboré en 1997 par le Council on Economic Priorities (CEP), basé à New York. La composition du conseil consultatif de son agence d'accréditation (CEPAA, récemment rebaptisé Social Accountability International (SAI)) est hybride, avec une forte majorité de représentants du secteur privé 994 . SA8000 est un label de performance destiné au secteur manufacturier. Il est uniforme, auditable et implique une vérification externe 995 . Inspirée des méthodes de certification de qualité ISO 9000, la procédure de certification vérifie la complétion des seuils de performance exigés par le label. La certification s'effectue moyennant la consultation par des auditeurs qualifiés de l'ensemble des partenaires de l'entreprise. SA8000 fait explicitement référence à plusieurs conventions de l'OIT, à la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et de la Déclaration universelle sur les droits de l'homme. Le label reprend les cinq droits fondamentaux du travailleur 996 . Il considère également la santé et sécurité au travail, les horaires, la rémunération, le management et contrôle de l'application du standard. Ce dernier point assure le suivi de la certification avec l'exigence que la firme améliore ses points faibles. Un programme de formation des auditeurs est mis en place 997 .
AccountAbility 1000 (AA1000) est un label dont l'élaboration en cours est menée par l'Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA), basé à Londres. Les membres de l'ISEA sont plus diversifiés que ceux du CEP, quoique aussi issus principalement du secteur privé 998 . AA1000 est un label de processus non de performance. Il vise moins à la réalisation d'objectifs absolus qu'à rendre compte des progrès effectués. Sa base normative consiste en un corps de principes définis par l'ISEA et que l'entreprise auditée s'engage à respecter. L'entreprise est tenue de dialoguer effectivement avec ses partenaires, de publier ses objectifs et d'évaluer ses performances pour leur amélioration constante. Les normes de processus permettent l'évaluation de la qualité et l'effectivité des procédures mises en place par l'entreprise en vue de la complétion des objectifs fixés. Les normes de processus s'appuient sur la base normative. Elles sont opérationnalisées au travers d'indicateurs définis à la fois par l'entreprise, par les meilleures pratiques sectorielles et locales ainsi que par l'ISEA. Les thèmes considérés par AA1000 incluent le dialogue avec les partenaires, l'intégrité, l'éthique commerciale, les conditions de travail et la publication d'informations sociales. Le label comprend également un programme de formation d'auditeur 999 . AA1000 n'est du reste pas stricto sensu un label, car il ne prévoit pas comme SA8000 de procédure formelle de vérification qui aboutisse à l'attribution d'une marque distinctive. La vérification externe a valeur consultative.
Le point fort du label SA8000 réside dans la solidité de sa base normative. Il garantit au travailleur en principe un niveau de vie souvent supérieur au seuil fixé par les législations nationales des pays en développement ainsi que les droits de négociation syndicale et de libre association. En cela il est en avance sur les codes de conduite interne élaborés par les entreprises. Mais le label n'impose pas stricto sensu à l'entreprise de vérifier que ses fournisseurs n'enfreignent la norme. L'évaluation est également sujette à caution. Son indépendance est relative puisqu'elle est effectuée par un cabinet de consultance. Elle implique peu la main-d'oeuvre et les ONG locales et ne travaille pas à leur conscientisation 1000 . La démarche est somme toute très occidentalo-centrée. De plus, la définition de seuils est une approche statique qui incite l'entreprise à s'en tenir au minimum requis, en dépit de l'obligation d'amélioration ultérieure. Le laxisme de l'application du label et les lacunes de la formation des auditeurs en Asie de l'Est ont été vertement critiqués 1001 . Le label ne considère pas la publication d'information non financière et guère davantage la qualité du management. Enfin SA8000 n'exprime pas grand chose quant à la responsabilité sociale de l'entreprise au sein des pays de l'OCDE. Dans ceux-ci, les droits fondamentaux au travail sont mieux protégés par la législation nationale et mieux respectés par les entreprises. En revanche, les problèmes humains et sociaux liés au travail s'expriment en termes de discrimination, de mobbying ou de charge nerveuse excessive.
Le label AA1000 est plus ambitieux que SA8000. Il propose une procédure complexe d'audit de la responsabilité sociale de l'entreprise. Son avantage majeur est sa souplesse d'application. En évitant autant que possible l'imposition à l'entreprise de valeurs, d'objectifs et de performances, la démarche de certification tente d'éviter un tour par trop normatif et policier. L'approche est ici dynamique, centrée sur la qualité des procédures plutôt que sur la réalisation d'objectifs normatifs absolus. En renonçant à une certification formelle, AA1000 évite l'exploitation commerciale agressive qui peut découler de l'obtention d'un label comme SA8000. En revanche, les fondations normatives d'AA1000 souffrent d'un déficit de légitimité en évitant toute référence à des normes internationales. En dépit de son appellation, AA1000 n'est guère une marque d'accréditation universelle. Axé sur l'amélioration de la responsabilité sociale de l'entreprise, il rend malaisé toute comparaison avec une autre entreprise même si la considération des meilleures pratiques sectorielles et locales dans la définition des normes de processus amende quelque peu ce constat. Enfin la vérification à valeur consultative envisagée rend compte du changement organisationnel, mais guère de la vitesse et de la direction de celui-ci. AA1000 reste relativement silencieux sur le mode de dialogue de l'entreprise avec ses partenaires et de prise en compte de leurs attentes 1002 . L'entreprise peut n'intégrer dans son évolution que les attentes les plus concordantes avec ses intérêts propres. Le tableau ci-dessous synthétise la discussion.
| Tabl. 6 : Les labels SA8000 et AA1000 |
| |
SA8000 |
AA1000 |
| Type de standard |
De performance
(valeurs minimales universelles définies par le label) |
De processus
(objectifs définis par l'entreprise et accent sur l'amélioration des processus) |
| Norme substantive |
Référence explicite à des instruments juridiques internationaux |
Propre base normative (normes de fondation) |
| Normes techniques |
Propres, définies par le CEPAA |
Propres (normes de processus), définies par l'entreprise, les meilleures pratiques sectorielles et locales ainsi que l'ISEA. |
| Champ thématique du label |
Assez limité. Il se focalise sur le respect des droits fondamentaux du travailleur tout au long du procès productif. |
Plus étendu. Il concerne tous les aspects sociaux, éthiques et environnementaux de l'activité de l'organisation. |
Champ opératoire du label
|
Etendu. Il concerne la définition des principes d'action ; le contrôle externe de la mise en oeuvre, des résultats et de leur conformité avec les principes d'action ; le développement des systèmes de gestion ; la description d'un modèle de gouvernance d'entreprise. |
Très étendu. Aux points mentionnés ci-contre, il adjoint notamment l'exigence de compte-rendu public des pratiques sociales ainsi qu'un schème détaillé de dialogue avec les partenaires de l'entreprise. |
| Type d'organisation auditée |
Secteur manufacturier essentiellement |
Tout type d'organisation |
| Vérification externe |
Certification formelle débouchant sur l'obtention d'un label. |
Evaluation à valeur consultative (sans certification). |
| Intégration des partenaires de l'entreprise |
Consultation des syndicats et des ONG locales. |
Participation active des partenaires à la certification. |
| Formation spécifique d'auditeurs |
Oui |
Oui |
| Suivi |
Obligation d'amélioration continue des performances |
Accent sur les processus assure le suivi dynamique |
| Mode d'élaboration |
Multi-acteurs |
Multi-acteurs |
Institution initiatrice du label
(origine principale de son financement) |
CEP
(entreprises) |
ISEA
(entreprises et sociétés d'audit et de conseil) |
| Date d'ouverture à la certification |
1997 |
2001 |
| Nombre de certifications |
31 en janvier 2000 |
Aucune en janvier 2000 |
L'élaboration des deux labels est trop récente pour juger de leur impact respectif. Le label AA1000 affiche dans son contenu les belles ambitions de ses initiants. Reste la double épreuve de l'accueil commercial et surtout de la mise en oeuvre. Les labels SA8000 et AA1000 ont tous deux impliqués dans leur élaboration une grande variété d'institutions, d'associations et d'experts. Ces initiatives privées ont peu de chance d'aboutir telles quelles à une norme substantive ou technique universelle. Elles constituent pourtant une indispensable et précieuse étape préliminaire à son émergence probable. Sorte de moyen terme entre la régulation formelle et l'autorégulation, la norme sociale privée présente de belles potentialités de diffusion auprès des milieux d'affaires.
* * *
Au bilan, le libre marché nécessite pour son bon fonctionnement des mécanismes effectifs tant d'incitation comportementale des acteurs que de suivi et de contrôle de leurs actions. Il en va de même en matière de responsabilité sociale de l'entreprise. L'affirmation authentiquement citoyenne de l'entreprise est en essence un code de conduite. Elle se double souvent en pratique de l'adoption formelle d'un code de conduite interne. Celui-ci appelle à un « trust me ! » alors que l'opinion publique réclame un « show me ! ». Les faiblesses du code de conduite interne démontrent les limites de l'autorégulation de ses acteurs. L'implication des pouvoirs publics et de divers groupements de la société civile lors de l'élaboration et la mise oeuvre du code de conduite paraît en l'espèce l'unique voie de progrès possible. La récente émergence de solutions de droit privé est un phénomène entaché d'un caractère erratique et d'un manque de transparence 1003 . Le point crucial consiste en l'occurrence dans l'identification des partenaires légitimes de l'entreprise et dans l'élaboration d'un modus vivendi qui dédramatise leur interaction. A ce titre, l'implication des organisations internationales d'une part et de la société civile des pays en développement d'autre part, paraît revêtir une importance toute particulière.
La mondialisation requiert des normes sociales globales et locales, suggérions-nous en introduction générale. L'audit social représente une pierre de voûte de la nouvelle architecture régulatoire de la vie mondialisée qui combine la régulation publique et contraignante, la corégulation des solutions de droit privé et enfin l'autorégulation du secteur privé. L'audit s'adresse à la corégulation. Il questionne la norme et son contrôle. Sa qualité suppose la reconnaissance universelle tant de sa base normative que de ses méthodes d'évaluation. L'audit met l'accent sur le besoin d'universalité des normes et des processus. Sa mise en oeuvre s'effectue avec d'inévitables aménagements contextuels, mais sa crédibilité requiert un noyau dur normatif et procédural. De nombreuses élaborations de normes et de procédures d'audit à vocation plus ou moins universelle ont vu le jour ou sont en cours d'élaboration. SA8000 et AA1000 en sont deux exemples saillants 1004 . Le PNUD tente par exemple de définir un indice de responsabilité sociale de l'entreprise qui serait le pendant de l'IDH conçu pour les pays 1005 . Ces initiatives publiques et privées visent en substance à garantir et même à relever le standard comportemental minimal de l'acteur économique global 1006 . Elles jouent sur l'effet de concurrence informelle entre les entreprises en mal de réputation vertueuse auprès du grand public.
L'audit réalise un équilibre entre liberté et discipline. Il représente une constellation complexe d'attitudes sociales envers le risque, la confiance et l'exigence de compte-rendu 1007 . Son indépendance vis-à-vis de l'entreprise auditée est cruciale pour la crédibilité du discours citoyen que la sienne propre. L'indépendance de l'audit permet de relier la responsabilité sociale de l'entreprise dans ses activités à sa transparence organisationnelle ainsi qu'au dialogue effectif de l'entreprise avec ses partenaires. Cette indépendance n'implique toutefois pas l'application aveugle d'un quelconque schème analytique à prétention universaliste. Elle est d'abord une communication avec l'organisation, une écoute attentive des acteurs et une analyse circonstanciée et sereine des structures et des processus. Le label social nécessite indubitablement une certaine souplesse d'application qui s'apprécie notamment au travers de la grille de l'interculturalité. La certification prend acte à un certain degré des variations de sensibilité et de priorité en matière sociale. La publication d'informations sociales et l'audit social reflètent partiellement le milieu sociopolitique dans lequel ils interviennent. La réciproque se vérifie également. L'audit social comporte une incontournable dimension normative et un réel potentiel formateur de son contexte social 1008 .
L'audit social ne peut aspirer au statut de science exacte, dérivée d'un cadre conceptuel clair et précis. L'enjeu commercial de l'audit constitue une première limitation. Pour sa crédibilité, le label doit dans sa phase d'élaboration conjuguer la consultation des parties à l'indépendance de l'organisme qui le promeut. Une démarche de cette envergure dépasse rapidement les moyens limités d'une seule institution privée. L'engagement de fonds publics paraît indispensable pour crédibiliser l'élaboration normative. Deuxièmement, l'étendue et l'effectivité de la démarche d'audit et de la publication d'informations sociales sont en pratique le fruit d'un marchandage politique entre diverses partenaires de l'entreprise -- du rapport de force entre d'une part la direction de l'entreprise et d'autre part les groupes de pression et les collectivités publiques 1009 . L'approche classique de la comptabilité, axée sur les résultats financiers de l'entreprise, a longtemps pêché par son conservatisme et sa vaine ambition d'objectivité. A l'évidence, les certifications de responsabilité sociale de l'entreprise appellent à la révision des principes de comptabilité traditionnels et à la mise à jour des compétences d'expertise 1010 .
L'audit social jouit d'un certain pouvoir de légitimation de l'entreprise. L'essor contemporain des pratiques d'audit atteste du déficit de légitimité dont souffre l'acteur économique. La suspicion prédomine face à toute initiative sociale émanant du secteur privé, telle l'affirmation citoyenne de l'entreprise. Prise de responsabilité et affirmation de sa faculté de jugement, la citoyenneté de l'entreprise revendique implicitement un blanc-seing que la société rechigne à lui attribuer. Sans validation empirique par le biais d'un audit de qualité, le discours citoyen risque d'être considéré, à tort ou à raison, comme un piètre paravent à des pratiques d'affaires socialement déconsidérées.
9. L'entreprise, citoyenne du monde
Le premier chapitre a posé l'entreprise comme un produit sociohistorique et socioculturel. Après l'évocation dans la partie centrale de l'évolution historique de la responsabilité sociale de l'entreprise, le présent chapitre explore quelques unes de ses variations interculturelles. L'affirmation citoyenne de l'entreprise est d'origine anglo-saxonne. En dépit de la mondialisation des marchés, sa mise en oeuvre dans d'autres contextes culturels ne va pas sans d'indispensables aménagements afin d'épouser au mieux les attentes sociales et le contexte institutionnel local. L'observation renvoie aux variantes culturelles du système de production capitaliste qui se regroupent en quatre grandes familles 1011 .
-
Le capitalisme de marché est à l'oeuvre dans la plupart des économies anglo-saxonnes, telles les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle Zélande. Les mécanismes de marché y régissent l'essentiel de la vie économique et sociale. Le rôle de l'Etat se borne à assurer les conditions cadres de la concurrence économique. Les marchés financiers jouent un rôle clé d'arbitrage de la vie économique et poussent à l'évolution rapide de la structure industrielle.
-
Le capitalisme méso-corporatiste ou rhénan se retrouve au Japon et en Allemagne, voire en Suisse. La vie économique y est davantage encadrée et coordonnée, voire dirigée que dans le capitalisme de marché, alors que les questions sociales relèvent généralement du bien public. Le rôle des marchés de capitaux est limité par des participations croisées entre sociétés et par une banque liée au groupe industriel. Le tissu industriel est rendu à la fois souple et solide par les nombreuses relations d'affaires établies à moyen et long termes.
-
Le capitalisme social-démocrate a cours en Suède et dans les autres pays scandinaves, voire en Allemagne. Il se caractérise par des négociations tripartites institutionnalisées entre le patronat, les syndicats et les pouvoirs publics afin d'assurer la compétitivité de l'économie, le plein emploi et la justice sociale. Les élites économiques sont issues de filières publiques.
-
Le capitalisme à impulsion étatique est celui des pays latins, y compris de la France. L'Etat assume des fonctions keynésiennes. Il régule non seulement les conditions structurelles de la compétitivité, mais également ses aspects conjoncturels par des plans de relance ou de déflation par exemple. Il comporte un haut degré de codification et d'institutionnalisation législative.
Aucune mouture du capitalisme ne démontre historiquement une suprématie absolue et durable. Le capitalisme occidental est de tendance social-démocrate dans les années septante, méso-corporatiste durant la décennie quatre-vingts et marchande lors des années nonante 1012 . Les temps contemporains consacrent indubitablement la primauté du capitalisme de marché. Le modèle social-démocrate n'a plus les moyens financiers de sa politique sociale. Le capitalisme à impulsion étatique et le modèle méso-corporatiste souffrent de rigidités internes qui limitent leur adaptation aux nouvelles donnes de l'économie internationale. Le capitalisme de marché gagne en outre au début des années nonante son bras de fer avec son grand contradicteur socialiste. La forte croissance économique américaine depuis une décennie suggère le triomphe du modèle anglo-saxon. Le tableau n'est pas sans tache. La société américaine se polarise entre des working poors et une élite gestionnaire et technicienne 1013 .
Du reste, la culture américaine n'est pas fortement dotée en capital social 1014 . En attestent la logique fortement compétitive du marché du travail, la précarité des termes d'engagement et d'emploi, les faibles investissements de l'entreprise en matière de formation continue, la loyauté minimale de l'employé. L'individualisme et le contractualisme ne favorisent pas l'émergence de la confiance dans les relations sociales 1015 . Il est en effet deux modalités basiques de régulation sociale, la loi et le contrat 1016 . La loi consacre une approche collective et socialement indifférenciée du lien social. Le contrat exprime au contraire une conception individualisée et volontariste du lien social. L'essor contemporain du contrat vis-à-vis de la loi stimule l'individualisme par le renforcement du lien volontaire sur le lien consenti, de l'autonomie au détriment de l'hétéronomie. En bref, la société américaine a renoué avec une vigoureuse croissance économique sans résoudre le défi de sa cohésion sociale.
Les institutions politiques américaines ne jugulent guère l'érosion des solidarités. Leur rôle traditionnel est d'ordre supplétif vis-à-vis de l'action privée 1017 . La politique économique se limite à la prévention et à la correction d'éventuelles distorsions de la libre concurrence ou de fraude. En matière sociale, l'intervention publique est légère par manque de moyens plutôt que par choix délibéré. Elle s'appuie sur la vigueur de la vie associative et coopérative de la société américaine qui affectionne la large décentralisation des services communautaires 1018 . A l'instar du citoyen fortuné, la grande entreprise assume ses obligations sociales par des pratiques philanthropiques et des formes d'engagement social local qui témoignent de sa citoyenneté 1019 .
Dans la conception américaine et plus largement anglo-saxonne, la responsabilité sociale de l'entreprise a pour manifestation privilégiée la création de valeur assumée par sa fonction productive. Elle prévoit quelques correctifs aux dysfonctionnements sociaux qui en découlent. Le modèle méso-corporatiste --japonais ou allemand voire suisse -- assigne à l'entreprise un rôle social plus ample qui intègre davantage en sa fonction productive l'idée d'un service public. Autrement dit, la conception anglo-saxonne intime à l'entreprise de servir aux mieux ses intérêts et ceux de ses propriétaires pour assurer sa viabilité, ce qui lui permet ensuite de contribuer à l'optimum collectif. Dans l'approche méso-corporatiste, l'entreprise considère initialement la satisfaction des besoins et des attentes de la société afin d'assurer sa viabilité et la satisfaction de ses propres intérêts et de ses propriétaires 1020 . L'origine nationale d'une entreprise explique partiellement sa conception de son rôle social. Les valeurs clé de sa culture interne et surtout les attentes exprimées par son milieu opérationnel local façonnent puissamment son comportement social. Des principes cadre assurent la cohérence des diverses initiatives dont les modalités exactes et l'ampleur répond aux besoins et aux attentes du milieu local. L'analyse de la responsabilité sociale de l'entreprise au Japon et en Suisse met en perspective interculturelle la citoyenneté à l'anglo-saxonne de l'entreprise.
A. La responsabilité sociale de l'entreprise au japon
L'histoire du capitalisme japonais comporte pour défi collectif la modernisation économique sans l'occidentalisation et pour défi individuel l'intégration professionnelle aux fins d'identité sociale. En Occident, le travail est longtemps considéré comme une punition et la technologie comme un substitut à la peine humaine. Au Japon en revanche, le travail est un rite sacré, un effort collectif dans lequel la conformité constitue la règle comportementale première et la technologie une aide à l'accomplissement du projet collectif 1021 . Le capitalisme japonais privilégie l'ordre et l'harmonie, la hiérarchie et les valeurs groupales. Il cultive la force morale et la souplesse de l'accord informel, préfère le lien interpersonnel à l'engagement contractuel. Ces traits façonnent le modèle japonais d'organisation sociale de l'activité économique du second XXe siècle avant sa récente remise en question.
1° Le modèle d'après-guerre (1945-1990)
Si la grande entreprise marque de son empreinte la structure industrielle des économies américaine et japonaise, son rôle respectif y diffère considérablement. La vie économique américaine a pour principe cardinal la compétition, celle nippone repose sur un mélange de coopération et de compétition. La législation proscrit aux Etats-Unis toute distorsion à la libre concurrence par des ententes cartellaires alors que l'économie japonaise bâtit précisément sa force et sa cohésion sur celles-ci. Le groupe industriel japonais assume un rôle social plus ample que son concurrent américain. Sa fonction de création de richesse est indissociable du maintien de la cohésion sociale. La langue japonaise fait virtuellement de l'entreprise (kaisha) un synonyme de la société, collectif d'individus (shakai) 1022 . L'activité économique est étroitement encadrée par les politiques publiques. Le développement économique japonais s'insère dans le projet politique formulé lors de la révolution Meiji de 1858 : le rattrapage économique de l'Occident par l'adaptation de son organisation productive aux réalités japonaises.
-
L'organisation sociotechnique du travail
La grande entreprise japonaise cherche à reproduire en son sein l'archétype de l'organisation sociale japonaise, soit la famille. Dans le sillage de la révolution Meiji, l'entrepreneur japonais procède à la concentration industrielle par agglomération horizontale des structures productives. Le zaibatsu, souvent un holding familial 1023 construit autour d'une banque commerciale, superpose l'interdépendance financière aux liens de sang. Dès le premier quart du XXe siècle, de nombreuses relations de sous-traitance, des participations croisées dans les conseils de direction, des garanties d'emploi à vie nourrissent un vigoureux esprit de corps au sein du groupe industriel 1024 . Vis-à-vis de la main-d'oeuvre, la référence à la famille est plus idéologique qu'elle ne se vérifie dans les faits. La condition de l'ouvrier japonais est des plus précaires jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, notamment en raison de la faiblesse du fait syndical 1025 . Le keiretsu marque de son empreinte la vie économique japonaise du second XXe siècle. A l'instar du zaibatsu, il se caractérise par une structure productive et commerciale organisée en réseau. Le keiretsu consiste en une fédération d'entreprises organisée autour d'une grande banque commerciale. Le keiretsu vertical consiste en une association intrasectorielle, étroite et hiérarchisée, de firmes satellites autour d'une entreprise de grande taille. Le keiretsu horizontal est un groupement lâche de firmes de taille plus ou moins équivalente, actives dans divers secteurs industriels.
Le keiretsu est de type vertical lorsque la production requiert de nombreuses relations de sous-traitance au sein d'un même secteur industriel 1026 . La firme mère est souvent l'actionnaire majoritaire des entreprises satellites. Ce type de fédération d'entreprises connaît un vigoureux développement dans l'après-guerre, en raison des importants investissements requis en matière de R&D, et des difficultés pour une entreprise indépendante à réunir des capitaux. Quant au keiretsu horizontal, il est puissamment implanté dans la vie économique de l'archipel nippon 1027 . Il résulte pour une bonne part de la reconstitution organisationnelle du zaibatsu d'avant-guerre. En plus de la logique économique qui avantage le choix de partenaires d'affaires éprouvés antérieurement, une telle reconstitution est guidée par la valorisation des liens interpersonnels et le sens du groupe industriel 1028 . Ainsi donc, la cohésion interne et l'identité collective du keiretsu se fondent sur des liens moins tangibles que son prédécesseur d'avant-guerre. Les accointances et les convergences de vues entre les dirigeants l'emportent sur le formalisme des relations familiales ou financières.
Sur le plan opérationnel, la force cohésive du keiretsu doit beaucoup à l'interdépendance stratégique des unités du groupe. Celles-ci sont reliées par des flux multidirectionnels de biens, de capitaux et de compétences, au travers de relations productives et commerciales, de participations financières croisées, de représentations panachées au sein des conseils de coordination du groupe et d'échanges de main-d'oeuvre. La stabilité interne du keiretsu est son meilleur filet de sécurité : elle est propice au développement des échanges internes, facilite le redressement d'une entreprise en difficulté, et décourage toute tentative de pénétration externe du groupe -- par offre publique d'achat (OPA) ou par la conquête de ses parts de marché 1029 . La souplesse et la relative indépendance de cette fédération d'entreprises vis-à-vis de son environnement économique lui permet de mieux assumer sa fonction première de création de richesse.
Le keiretsu recherche moins l'intégration que l'interdépendance et la complémentarité. La dépendance externe en matière productive, commerciale et financière de ses unités composantes est plus prononcée que les firmes américaines ; elle demeure toutefois interne au groupe 1030 , ce qui en fait une interdépendance source de cohésion. Sorte de complexe banco-industriel, le keiretsu recourt ainsi peu aux marchés ouverts de capitaux. La banque commerciale du groupe joue les chefs d'orchestre. Elle finance les investissements des firmes, contrôle la qualité de leur gestion et contribue activement si besoin est à leur redressement. Elle est maîtresse de la précieuse information financière, managériale et stratégique des entreprises du groupe, qu'elle collecte notamment via sa participation aux nombreux conseils de coordination du keiretsu. La cohésion du keiretsu découle en outre de sa recherche de cohérence interne. Le groupe industriel cultive l'idée d'une famille d'entreprises. Son fonctionnement est empreint d'un paternalisme combinant autorité et bienveillance 1031 . Un corpus de normes fonctionnelles et symboliques spécifiques est établi en matière de dettes et de commerce, de fonctionnement des conseils d'administration et d'échange de main-d'oeuvre, de relations publiques et d'activités socioculturelles. On évite toute concurrence directe entre les diverses entreprises du groupe. La cohérence du keiretsu est en outre particulièrement soignée dans l'image externe du groupe 1032 .
L'organisation sociale traditionnelle de la firme japonaise est complexe. Fondamentalement, on distingue les «personnes qui travaillent» des «personnes en charge». Les premiers vaquent aux fonctions productives et peu qualifiées. Au bénéfice d'un niveau d'éducation élevé, les seconds occupent des fonctions plus ou moins formelles et honorifiques de gestion et de supervision. L'étagement hiérarchique s'enrichit parfois d'un niveau intermédiaire lorsque des connaissances techniques élevées sont requises. De tels postes sont dévolus essentiellement aux jeunes diplômés universitaires. Ceux-ci acquièrent ainsi l'indispensable expérience professionnelle sans porter ombrage aux cadres tout en jouissant de leur prééminence statutaire vis-à-vis des employés subalternes 1033 . Si une telle organisation sociale concilie les exigences du rôle et du statut, elle produit de nombreux doublons de postes peu productifs et fonctionnellement mal définis. La gestion méritocratique des carrières rend difficile l'appréciation des responsabilités individuelles. Elle est fortement guidée par la préservation de la réputation personnelle 1034 et la prégnance des liens relationnels. Aussi l'attribution de fonctions honorifiques aux cadres peu performants, les pratiques discriminatoires de type népotique en matière d'engagement et de promotion sont-elles monnaie courante 1035 .
A l'instar de sa concurrente américaine, le conseil d'administration de la firme japonaise est en principe l'instance de contrôle de la qualité de la gestion managériale ainsi que le relais des intérêts des actionnaires. La similarité n'est qu'apparente. Le conseil d'administration de la firme japonaise fusionne en pratique le contrôle et le management. Il est composé de cadres expérimentés issus du sérail, lesquels représentent les salariés et non pas les marchés financiers 1036 . Le conseil est hiérarchisé sur le statut et l'ancienneté de ses membres. Le pouvoir décisionnel échoit en principe aux membres de longue date du conseil, usuellement le président et les vice-directeurs. Le directeur de département ne supervise guère les décisions de ses supérieurs hiérarchiques. Seule une grave faute professionnelle du président peut l'amener à présenter sa démission 1037 . L'investisseur privé est faiblement associé au processus décisionnel, car il représente une faible portion du capital social par rapport aux participations croisées et aux capitaux de l'établissement bancaire du groupe. La passivité de l'investisseur privé est notoire. L'actionnariat ne s'active qu'en cas de graves déficiences managériales ou très mauvais résultats financiers. L'horizon temporel d'investissement est étendu, d'où une relation de confiance entre le pourvoyeur en capital et la direction 1038 . Quant au processus décisionnel, il est à la fois consensuel par la procédure consultative préliminaire et profondément hiérarchisé dans la prise de décision. S'il pèche par sa lenteur, il garantit mieux l'adhésion des collaborateurs aux décisions de principe arrêtés par la direction ainsi que leur mise en oeuvre rapide.
-
La responsabilité sociale de l'entreprise
La responsabilité sociale de l'entreprise japonaise est de type méso-corporatiste. Elle s'exprime dans la satisfaction des besoins de consommation et des attentes sociales en matière d'emploi et de rentrées fiscales ainsi que d'élévation du niveau de vie. Elle se base sur une conception organique de l'organisation et suppose des liens durables avec ses partenaires. L'entreprise assume une importante fonction de liant social et jouit d'un capital confiance élevé. Dans la logique corporatiste, l'entreprise japonaise est peu transparente vis-à-vis de la société. Elle n'est guère encline aux pratiques philanthropiques. Perçu comme un bâtisseur d'empire et un promoteur de l'harmonie sociale, l'entrepreneur japonais jouit d'un prestige social considérable 1039 intimement lié au soin voué au renom de la firme qu'il dirige 1040 . L'industriel japonais considère son entreprise comme un service public dont il a mandat de gestion pour le bien commun. Les politiques publiques veillent à la concordance des objectifs privés de l'industriel avec les priorités économiques 1041 .
Au Japon prévaut une vision organique de l'entreprise, soit une communauté d'individus qui partagent au travers de leur travail des expériences de vie, des responsabilités et des risques. A l'inverse des sociétés occidentales, la culture japonaise privilégie la responsabilité collective à celle individuelle 1042 . Cette tradition sociale collectiviste puise ses solides racines historiques dans les institutions du Japon féodal, tels les conseils de village ou les réunions de famille. Une telle approche collective des problèmes sociaux est également pratiquée en Occident. Elle demeure comparativement plus vivace dans la société japonaise.
L'organisation industrielle japonaise effectue une répartition sociale des risques et des bénéfices liés à l'activité économique. Les participations croisées entre les unités du keiretsu soudent le groupe dans les périodes fastes comme dans les moments difficiles. L'entreprise en instance de faillite peut ainsi compter sur l'aide financière et logistique des autres unités du groupe 1043 . Le profit est réparti de façon relativement équitable au long des échelons hiérarchiques : à responsabilités similaires, un cadre supérieur d'une firme japonaise est sensiblement moins rétribué qu'un salarié d'une entreprise américaine 1044 . Le principe de mutualité se lit encore au travers du faible recours au licenciement et par la rareté des faillites observées traditionnellement dans l'économie japonaise. Le manager qui recourt à la mise à pied est considéré comme un incapable parmi ses pairs et par la société tout entière. Il s'agit donc d'une mesure d'ultime recours 1045 à laquelle est préférée la réduction des bénéfices opérationnels.
L'entreprise japonaise voue tous ses soins à la satisfaction de sa clientèle. Son attitude est plus ambiguë vis-à-vis de sa main-d'oeuvre. La firme nippone assume généreusement son rôle d'employeur et de formateur. En retour, elle exige un dévouement sans borne. Aussi l'entreprise japonaise donne-t-elle priorité au recrutement, à la formation continue et à la promotion de sa main-d'oeuvre par des filières qui lui sont propres 1046 . Ce marché interne du travail comporte quatre volets principaux : l'emploi à vie, la promotion selon l'ancienneté, la formation continue et le syndicat d'entreprise. L'embauche s'effectue moins en fonction des compétences professionnelles du candidat que de ses facultés à l'apprentissage professionnel et relationnel. La procédure d'embauche s'assure de la convergence idéologique du candidat avec la culture d'entreprise ainsi que de son aptitude à travailler en équipe. Les diplômes universitaires sont très inégalement appréciés. Une dizaine d'universités fournissent les futurs cadres les plus recherchés, Le poids des relations personnelles est important 1047 . L'embauche possède la symétrie et la solennité d'une promesse matrimoniale. L'entreprise assure la prise en charge totale de l'employé et de sa famille nucléaire contre son dévouement inconditionnel au travail 1048 . Elle se pose à l'employé comme un puissant référentiel identitaire. Les implications émotionnelles et sociales de l'embauche débordent très largement l'idée étroite d'une relation contractuelle de travail. Une forte culture d'entreprise et une politique d'engagement à long terme nourrissent un rapport d'autorité teinté de sentimentalisme qui assure l'esprit de corps et qui étouffe les revendications.
La force de l'appareil idéologique engendre des dérapages, notamment lorsque le salarié n'ose pas prendre les vacances auxquelles il a pourtant droit 1049 . La gestion des carrières obéit peu aux qualifications professionnelles per se. Elle s'effectue selon des critères méritocratiques -- égalité de principe quant à la postulation, mais respect de l'âge et de l'ancienneté lors de la nomination 1050 . La formation interne est particulièrement soignée, car elle permet l'acquisition de compétences professionnelles spécifiques à l'entreprise. Celle-ci limite ses risques de départ inopiné de sa main-d'oeuvre par la promotion selon l'ancienneté et la garantie implicite d'emploi à vie. Changeant d'entreprise, un salarié se verrait ipso facto rétrogradé à un échelon hiérarchique inférieur. Quant au syndicalisme d'entreprise, il est moins un contre-pouvoir apposé à la direction qu'une plate-forme de communication susceptible de renforcer la communauté d'intérêts entre le patronat et le salariat 1051 .
L'entreprise japonaise s'inspire avec un certain décalage temporel des expériences occidentales et en accentue certains traits. Certains zaibatsu mettent en oeuvre dès les années 1920 des programmes paternalistes d'encadrement de la main-d'oeuvre. Ils privilégient l'emploi à longue durée ainsi que la formation continue et intensive de cols bleus, le tout dans un fort conditionnement idéologique. Dans la détresse sociale de l'immédiat après-guerre, le paternalisme social des keiretsu s'étoffe en matière de logement surtout. L'emploi à vie concerne alors environ le tiers des contrats de travail. Ce privilège fait l'objet d'une féroce concurrence, d'autant plus qu'il conditionne les promotions internes. La symbolique d'appartenance est assurée par les exhortations quotidiennes de la direction et les retraites zen obligatoires pour les nouveaux employés.
Durant les années soixante, la politique sociale de l'entreprise japonaise évoque le paternalisme occidental du début du XXe siècle 1052 . L'exiguïté géographique des villes fait du logement ouvrier un sempiternel problème. La grande entreprise établit en zone urbaine des parcs de logement (shataku), du dortoir pour célibataire au logement pour père de famille. Si les loyers pratiqués sont dérisoires, la qualité de cette vie semi-collective est suffisamment médiocre pour inciter l'ouvrier à quitter le shataku dès que ses moyens financiers le lui autorisent. En raison de la crise immobilière persistante, le shataku conserve son actualité durant les années quatre-vingts et gagne même en confort et en commodité 1053 . La responsabilité sociale de l'entreprise japonaise évolue avec précaution. L'encadrement des salariés perd quelque peu de sa patine paternaliste et de son autoritarisme. Sa vocation moralisante et éducative s'émousse. Son accent glisse du logement ouvrier à la formation continue et à la couverture sociale de l'employé 1054 . A l'époque, les allocations familiales versées par l'employeur répondent peut-être moins à une nécessité matérielle qu'elles ne valorisent symboliquement la fidélité de l'employé vis-à-vis de l'entreprise 1055 .
 Encadré 7 : Toyota-City au début des années nonante
Encadré 7 : Toyota-City au début des années nonante
L'entreprise japonaise ne remet toutefois pas fondamentalement en question ses méthodes d'encadrement de la main-d'oeuvre. L'impératif de service public et de cohésion interne l'emporte sur tout autre considération. Au début des années nonante, le paternalisme de Toyota est teinté d'anachronisme. S'il ne représente plus guère les pratiques sociales de la plupart des sociétés japonaises, l'encadrement étroit de la main-d'oeuvre illustre les limites de tout modèle productif qui, auréolé de son succès, refuse d'évoluer avec son époque. Le méso-corporatisme d'après-guerre ne fait simplement plus recette, ni sur le plan économique ni auprès des jeunes générations.
2° La crise du modèle japonais (1990-2000)
Le modèle traditionnel japonais de gouvernance économique et d'organisation sociale du travail est en crise depuis une décade. Le chômage atteint dans les années nonante un niveau sans précédent dans l'histoire contemporaine nippone 1056 . Le phénomène est symptomatique d'une crise de société, car la clause essentielle du contrat social qui a maintenu au pouvoir le parti libéral démocrate (PLD) japonais était précisément le plein-emploi. L'origine de la crise est à la fois structurelle et conjoncturelle. Le Japon achève le processus de rattrapage des économies occidentales initié dans les années cinquante. Son modèle industriel, voué à l'exportation de produits manufacturés et axé sur l'efficience productive et sur la qualité des produits, s'essouffle. La crise a pour origine conjoncturelle les bulles spéculatives des années quatre-vingts et l'attentisme politique subséquent. Les plans de relance sont trop timides et trop classiques pour assainir l'économie japonaise. Des faillites bancaires en cascade provoquent dès novembre 1997 une crise de confiance généralisée dans le marché interbancaire et occasionnent une contraction des prêts bancaires qui mettent en difficulté beaucoup d'entreprises fortement endettées 1057 .
Les récents déboires de l'économie japonaise interpellent par leur soudaineté. En fait les signes avant-coureurs de la crise se décèlent dès la décennie quatre-vingts. Sur le plan technique, l'économie japonaise se retrouve alors pour la première fois dans son histoire dans la position de leader mondial. Elle se repose pourtant sur ses lauriers et ne décèle pas suffisamment tôt les potentialités des NTIC. Selon l'analyse schumpétérienne, le Japon demeure trop longtemps attaché aux technologies vieillissantes du quatrième cycle économique et néglige la préparation du cycle actuel lié à la nouvelle économie. En dépit d'investissements massifs, la recherche fondamentale reste insuffisamment féconde et mal relayée vers l'industrie 1058 . Le Japon des années nonante peine à se réformer et à innover.
Force majeure du développement économique japonais de l'après-guerre, la vigueur du capital social de la société nippone devient paradoxalement contre-productive dans les années quatre-vingts. La mutualisation des risques économiques au sein des keiretsu connaît alors de sérieuses dérives. Pensées comme le ciment des relations d'affaires, les participations croisées entretiennent de fait une opacité et un conservatisme financier coupables. La banque de keiretsu pèche souvent par sa complaisance vis-à-vis d'entreprises pourtant condamnées par l'insuffisance durable de leurs résultats ou se montre trop généreuse face à des stratégies d'expansion industrielle parfois mégalomanes. En conséquence, l'établissement bancaire hypothèque son propre avenir par de lourdes créances douteuses. Le risque économique est alors socialisé à l'excès dans un faisceau de relations interpersonnelles à long terme, au détriment de mécanismes plus formels de réduction de risque tels que le contrôle externe ou les dispositions légales 1059 .
Le capital social tend même à décliner dans la société japonaise. Tant les élites politiques qu'économiques souffrent d'une crise de légitimité. «Japan, Inc.», le blason de la complicité féconde entre les pouvoirs publics et le secteur privé, s'est terni pour symboliser la collusion trouble entre les élites politiques, financières et industrielles. Le capital confiance et le respect publics dont jouit traditionnellement le secteur privé souffre notablement de divers scandales intervenus dans le dernier quart de siècle 1060 . Certaines sociétés parmi les plus prestigieuses sont contraintes à dépopser leur bilan 1061 . En conséquence, l'administration publique réduit de façon générale sa gouverne du secteur privé au profit des marchés financiers, alors qu'elle décidait auparavant en quelque sorte de la prospérité de l'entreprise par ses choix de politique économique. L'action publique se conjugue désormais à la pression des investisseurs pour la meilleure transparence opérationnelle de l'entreprise japonaise.
-
L'organisation sociotechnique du travail
En plus d'un cadre renouvelé de gouvernance d'entreprise, le fonctionnement interne du keiretsu connaît plusieurs révolutions de palais. Depuis les années quatre-vingts déjà, les grands groupes japonais diversifient leurs sources de financement par un plus large recours aux marchés internationaux de capitaux 1062 . Le rôle central de pourvoyeur en capital de la banque de keiretsu et par-là son influence relative dans la vie du groupe tend à diminuer. Qui plus est, ce type de banque n'échappe pas à la vague de fusions qui remodèle le secteur bancaire japonais 1063 . Les établissements bancaires recherchent l'effet de taille critique censé l'immuniser contre toute attaque hostile 1064 . La stratégie ne compense pas leur vulnérabilité foncière, car leurs prêts non recouvrables atteignent des montants faramineux 1065 . L'évolution du secteur bancaire, encouragée par le Keidanren et le PLD 1066 , mine la cohésion interne du keiretsu. Elle expose ses unités composantes à des offres publiques d'achat 1067 ou à des prises de participation par des sociétés étrangères. L'évolution est notable, car la psyché collective japonaise moderne ne s'est guère départie d'une mentalité insulaire, dont le slogan serait « compter sur ses propres forces. » Ce slogan qui fondait la logique productive et commerciale interne du keiretsu est à présent remis en cause par des contrats d'affaires conclus avec des sociétés extérieures au groupe industriel.
Sur le plan social, le capital humain de la main-d'oeuvre qui nourrit le développement économique japonais dans l'après-guerre repose sur des connaissances de base standardisées par le système d'éducation publique, sur l'aptitude au travail de groupe et à la conformité comportementale, ainsi que sur une approche empirique de l'apprentissage 1068 . De telles connaissances et valeurs socioprofessionnelles s'avèrent peu adaptées à des marchés éminemment fluctuants. La diversité et la complémentarité des compétences, la vigueur de l'esprit d'initiative et d'innovation favorisent la rapidité de la réaction de l'entreprise et stimulent sa faculté d'anticipation de l'évolution des marchés. L'esprit innovateur souffre dans les échelons subalternes des grands groupes japonais des carcans hiérarchiques et méritocratiques. Quant au management, son inventivité et son dynamisme sont limités par le mode consensuel de décision et par le souci de ne pas faire perdre la face à quiconque 1069 .
A l'exemple du secteur automobile, les difficultés de l'économie japonaise ne découlent notamment de graves inefficiences et de surcapacités productives. Fortement dépendantes des commandes des grands groupes industriels, beaucoup de PME font en premier les frais de la crise 1070 . Face au motto managérial contemporain de réduction des coûts de production, le keiretsu japonais est handicapé notamment par ses effectifs pléthoriques. Alors que le licenciement constitue traditionnellement la mesure de dernier recours, les groupes industriels opèrent depuis 1993 des coupes sombres dans leurs effectifs 1071 . Les réductions de personnel s'opèrent autant que possible par la formule plus élégante d'une invitation à quitter l'entreprise, accompagnée soit d'un plan de retraite anticipée soit d'une indemnité pour recherche d'emploi 1072 . L'engagement d'un manager étranger facilite la mise en oeuvre de mesures sociales plus drastiques et impopulaires, telles la fermeture d'une usine 1073 .
La perte d'un emploi à vie est particulièrement problématique pour l'employé âgé et peu performant qui n'a jamais été confronté au filtre du marché libre du travail. A ceci s'additionnent les graves conséquences sociopsychologiques d'une mise à pied. Pour le salarié japonais au bénéfice d'une promesse implicite d'emploi à vie, elle est vécue comme sinon une «trahison», du moins un camouflet et un déshonneur social. Même une mise à la retraite anticipée est mal vécue, car elle interrompt abruptement un parcours professionnel qui constitue souvent l'essentiel du parcours de vie du travailleur japonais. La précarisation de l'emploi constitue désormais une préoccupation sociale majeure au Japon 1074 .
Le salaryman japonais est une espèce de travailleur menacée. Face aux rapides et profondes mutations techniques, les filières internes de formation et de promotion professionnelles s'avèrent trop rigides, trop fermées et surtout trop coûteuses 1075 . Censée amortir les fluctuations des commandes, la mobilité interne de la main-d'oeuvre au sein du keiretsu ne fonctionne pas vraiment. De méritocratique, le système japonais d'emploi prend un tour plus technocratique. L'emploi à vie recule au profit de l'annualisation du contrat de travail, de l'emploi à court terme et de la consultance. La fidélité de la main-d'oeuvre est moins valorisée que par le passé, alors que sa compétence et sa performance le sont davantage. La promotion selon l'ancienneté est remplacée par des examens internes évaluant les compétences professionnelles de l'employé. Le salaire à la performance se répand, et les primes sont désormais indexées à la valeur boursière des titres de la société 1076 .
Les jeunes diplômés universitaires n'aspirent plus autant que par le passé à faire carrière au sein des keiretsu. Conséquence de l'évolution des mentalités, un nombre croissant de jeunes loups fondent leur propre entreprise dans la nouvelle économie 1077 . La tendance bute sur l'aversion traditionnelle du Japonais à la prise de risque personnelle. L'entrepreneuriat troupe peu de soutien institutionnel. Le système éducatif traditionnel ne favorise pas l'esprit d'initiative ou la créativité alors que les fonds de capital-risque sont insuffisants. Le tableau n'est pas figé toutefois, car les écoles de management privées comme publiques fleurissent au Japon. Autrefois le keiretsu envoyait ses meilleures cols blancs ou les jeunes universitaires les plus prometteurs entreprendre des études de troisième cycle dans les écoles de management occidentales contre l'assurance implicite de leur retour au bercail. L'évolution récente devrait stimuler le brassage d'idées des futures élites économiques, diversifier leurs compétences et accroître leur mobilité socio-professionnelle. La propension à l'innovation de l'économie japonaise pourrait être stimulée par la crise de légitimité de la grande entreprise.
-
La responsabilité sociale de l'entreprise
L'entreprise japonaise transgresse lors de la dernière décennie plusieurs clauses fondamentales de son pacte social. Elle n'assure plus la pérennité de la croissance économique et faillit à sa fonction de liant social. L'entreprise dénonce le contrat implicite d'emploi à vie avec sa main-d'oeuvre. Elle ne respecte plus le sacro-saint principe du respect des aînés et met à mal la solidarité intergénérationnelle. Elle ne justifie plus la confiance placée en elle et voit l'hostilité sociale croître à son égard. Aveu ultime de faiblesse, l'entreprise japonaise se commet avec l'étranger pour se réformer.
Les prises de participation étrangères dans le capital social des firmes nipponnes se multiplient et pèsent sur les décision et les méthodes managériales. Est-ce à dire que la responsabilité sociale de l'entreprise japonaise tend à se fondre dans le creuset d'un modèle unique d'inspiration anglo-saxonne ? A problème complexe, réponse nuancée. La mondialisation des marchés se traduit effectivement par une relative homogénéisation des pratiques d'affaires. Le recours plus massif aux marchés internationaux de capitaux induit par exemple une évidente convergence internationale en matière de gouvernance d'entreprise vers des standards anglo-saxons. Les problèmes sociaux des pays industrialisés offrent certaines similitudes, ce qui rapproche le Japon des Etats-Unis par rapport à d'autres pays asiatiques moins industrialisés. Le Japon moderne s'est construit à la fois par l'imitation et le rejet de l'Occident dans la recherche de sa voie propre 1078 . Les politiques sociales sont le parent pauvre du développement économique américain et japonais. Au Japon, le problème est aggravé par le rapide et sérieux vieillissement démographique 1079 . Contrairement à la mentalité américaine encline à la consommation et au crédit, le consommateur japonais d'âge mûr renforce à présent sa propension à l'épargne. Il gonfle son bas de laine pour faire face aux nécessités de ses vieux jours : couverture des dépenses de santé, complément aux rentes de l'assurance vieillesse et de la caisse de retraite.
L'évolution sociale japonaise laisse plus de champ d'action pour un engagement citoyen de l'entreprise inspiré des pratiques anglo-saxonnes. La philanthropie trouve toutefois un faible écho au Japon. Quoique d'orientation collectiviste, la société japonaise ne forme pas un tout social, homogène et compact. Elle est traversée par de multiples lignes de fracture de type familial ou clanique, délimitant des groupes sociaux solidaires en interne, mais plutôt étanches les uns aux autres. Les notions de dette morale (giri) et de gratitude (on) structurent la vie interne de ces phratries. Ces sentiments ne se conçoivent toutefois qu'au travers des contacts personnels et approfondis entre les individus ou les groupes sociaux. En arrière-fond de ces réseaux sociaux privilégiés se situe la société, corps amorphe et impersonnel envers qui le Japonais n'éprouve pas d'obligation particulière 1080 . Une donation sans récipiendaire socialement bien défini -- ami, obligé, voisin -- n'a pas beaucoup de sens dans la société japonaise éprise de particularismes relationnels. Ainsi la philanthropie à large spectre n'est guère prisée par l'entreprise niponne.
Même si le groupe social bénéficiaire est précisément défini, la philanthropie dans sa conception anglo-saxonne est inappropriée au contexte nippon. Elle est trop «désintéressée» et trop unilatérale dans une société japonaise dont la réciprocité représente le principe premier d'interaction sociale. Certes le don peut être motivé par l'affection personnelle du donateur envers le bénéficiaire (ninjo). La donation répond aussi parfois à la nécessité d'action collective, telle la construction d'un édifice public, à moins qu'elle ne résulte du désir du donateur d'impressionner la collectivité par ses largesses et donc par son pouvoir. Plus fréquemment, le don témoigne au Japon de la loyauté et de la gratitude de l'individu vis-à-vis du groupe auquel il appartient (on). Plus souvent encore, le don représente en fait le prélude à la sollicitation d'une faveur (giri). L'obligation morale de réciprocité fait en effet du récipiendaire l'obligé et le débiteur du donateur. Le bénéficiaire du cadeau se voit alors tenu de répondre favorablement à la requête du donateur en respectant la proportionnalité des prestations. Si le cadeau est en somme une pratique courante dans la société japonaise aux fins de ciment social et d'assurance sociale, il n'est pas toujours bien apprécié socialement, de par les effets contraignants qu'il déploie envers son destinataire 1081 .
D'autres modalités de la citoyenneté anglo-saxonne de l'entreprise souffrent également d'un décalage culturel au Japon, bien que celui-ci tende à s'atténuer. Par exemple, l'engagement social de la firme japonaise envers la communauté locale est un phénomène récent et timide, et ce pour au moins trois raisons. Premièrement, les intérêts économiques de l'entreprise japonaise sont définis d'emblée pour converger au mieux avec ceux de la société, tant par la définition du rôle social de l'entreprise que par le travail de concertation entre divers groupes sociaux qu'il implique. Le besoin d'actions sociales envers les communautés locales aux fins de légitimisation se fait alors moins ressentir. Deuxièmement, la responsabilité sociale de l'entreprise japonaise se lit au travers de relations privilégiées entretenues avec certaines groupes sociaux directement liés au procès productif -- clientèle, main-d'oeuvre, investisseurs, fournisseurs et sous-traitants 1082 . La communauté locale est donc considérée comme d'importance secondaire. Troisièmement, la notion même de communauté locale a sensiblement moins de consistance au Japon qu'en Occident. Dans une conception traditionnelle du moins, l'importance temporelle et affective du travail et de la famille laisse peu de place au salarié japonais pour participer à la vie associative, religieuse ou scolaire locale.
A l'image des sociétés continentales européennes, le Japon conçoit traditionnellement le service social comme de nature publique. Une initiative sociale en matière d'éducation ou de santé émanant du secteur privé est accueillie plutôt avec circonspection par la société et les pouvoirs publics japonais. Cette conception a toutefois évolué quelque peu depuis les chocs pétroliers des années septante. La contribution à l'emploi représente jusqu'alors pour la société japonaise le critère primordial, sinon unique, d'évaluation de l'utilité sociale d'une entreprise. Plusieurs graves pollutions industrielles intervenues pendant la décennie quatre-vingts sensibilisent le public quant à l'importance de la préservation de l'environnement naturel dans la production économique. Par ailleurs, le relâchement des liens familiaux et le vieillissement de la population augmentent les besoins en couverture sociale en particulier pour les aînés. Le ralentissement de la croissance économique japonaise aggrave le phénomène et diminue les recettes fiscales qui financent les programmes publics en matière sociale. Les réalisations du tiers secteur ne pallient guère les carences des systèmes publics de sécurité sociale et professionnelle 1083 . Cette évolution rend ainsi plus appréciable la contribution de l'entreprise par exemple à la couverture des soins médicaux, en particulier pour les retraités 1084 .
L'expérience du marché américain de l'entreprise multinationale japonaise la prépare paradoxalement mieux à satisfaire ces nouvelles attentes sociales sur l'archipel nippon. La fin des années quatre-vingts coïncide en effet avec la forte augmentation des investissements directs étrangers japonais aux Etats-Unis 1085 . La firme japonaise est alors handicapée par son manque d'expérience en matière d'engagement social local 1086 , modalité majeure de la responsabilité sociale de l'entreprise aux Etats-Unis 1087 . Déjà perceptible sur le marché national, le désintérêt relatif envers les communautés locales manifesté par l'entreprise nipponne s'accentue hors frontières du fait de la forte centralisation de sa structure décisionnelle et opérationnelle dans ses quartiers généraux japonais.
La plupart des firmes japonaises réalisent cependant rapidement l'importance d'un haut profil citoyen pour leur succès commercial sur le marché américain 1088 , mouvement mené par les groupes Hitachi, Sony, Matsushita et Toyota 1089 . Chef d'orchestre d'une approche concertée typiquement japonaise, le Keidanren lance en 1989 le Council for Better Corporate Citizenship 1090 afin de promouvoir les pratiques sociales de l'entreprise japonaise sur les marchés étrangers, ainsi qu'en 1990 un One Percent Club voué aux oeuvres philanthropiques du secteur privé. Aussi nombre de firmes japonaises disposent-elles à présent de leur propre fondation aux Etats-Unis, tout en coordonnant leur action par le biais d'une structure commune baptisée Affinity Group on Japanese Philanthropy 1091 . La citoyenneté de l'entreprise japonaise se manifeste aux Etats-Unis logiquement sous la forme d'initiatives sociales destinées en priorité aux communautés locales. Ces actions demeurent apparemment encore trop souvent conçues par les quartiers généraux japonais, pas toujours bien informés des attentes sociales américaines. L'exigence de transparence organisationnelle posée par le marché américain confère à la politique de relations publiques de la firme une importance stratégique inconnue sur l'archipel nippon 1092 .
Sur le marché américain, la firme japonaise s'est appliquée à démentir un préjugé social largement négatif, à la fois suspicieux et exigeant, exprimé à son égard 1093 . Cet a priori défavorable prend racine dans l'âpre concurrence industrielle et commerciale nippo-américaine qui n'a que gagné en acuité depuis les années soixante. L'opinion publique américaine estime encore souvent que le rattrapage de l'économie japonaise par rapport aux pays occidentaux s'est effectué au mépris de principes universels d'éthique économique, tels la copie plus ou moins licite de technologies développées à grands frais par des firmes occidentales, l'exploitation inconsidérée des ressources naturelles ou encore l'exploitation de la docilité et de l'abnégation de la main-d'oeuvre japonaise. En outre, l'image citoyenne auprès de la société américaine de l'entreprise nipponne souffre décidément d'une méconnaissance chronique de la culture japonaise.
Le problème d'image de l'entreprise japonaise est probablement moindre en Europe et un peu différent. Echaudées par les succès commerciaux de l'industrie japonaise notamment en matière de construction automobile, les sociétés européennes sont également circonspectes à l'égard de l'entreprise japonaise. Elles ne formulent toutefois à l'égard des firmes japonaises guère d'autres attentes que la contribution à l'emploi et aux recettes fiscales, ainsi que le respect de l'environnement naturel. Aussi les initiatives citoyennes de l'entreprise japonaise en Europe sont très loin d'atteindre la diversité et l'ampleur qui est la leur sur le marché américain. Quant aux marchés émergents, notamment asiatiques, les firmes japonaises s'y montrent des plus discrètes 1094 .
Au Japon, l'employé et sa famille demeurent au début de la décennie nonante le groupe social cible par excellence de la politique sociale de l'entreprise nipponne. Le logement demeure en zone urbaine un problème suffisamment sérieux pour que la grande entreprise entretienne de vastes et coûteux programmes de logements (shataku) 1095 . Cette pratique est moins paternaliste que pragmatique, car elle fidélise l'employé à un coût moindre qu'une hausse substantielle de salaire. Les infrastructure de loisirs, les maisons de villégiature ou de retraite et parfois la couverture des frais de sépulture pour des proches de l'employé constituent d'autres prestations traditionnellement offertes par la grande entreprise à sa main-d'oeuvre. Ces pratiques sociales vont decrescendo durant la décennie nonante vu la crise économique persistante. Le montant global des fonds alloués à des initiatives sociales par le secteur privé japonais décroît en fait dès 1992. En revanche la proportion de ces dépenses allouée à des services sociaux envers la communauté locale augmente 1096 . Les réticences des pouvoirs publics japonais sont partiellement levées par la clause de nécessité. L'entreprise japonaise peut amorcer sa révolution culturelle.
* * *
Durant la dernière décennie, la firme japonaise sise aux Etats-Unis poursuit son apprentissage d'une politique sociale en faveur de la communauté locale alors qu'elle reste très discrète dans les économies émergentes. Sur l'archipel nippon, la firme japonaise esquisse quelques initiatives d'inspiration anglo-saxonne. Elle allège notablement l'encadrement paternaliste de sa main-d'oeuvre. La réduction des effectifs pléthoriques constitue la priorité actuelle du management japonais. L'évolution démographique suggère que le défi managérial futur concernera le recrutement de jeunes collaborateurs. Ceux-ci ne sont pas près d'accepter le régime paternaliste autoritaire et fortement idéologisé qu'ont connu les générations précédentes. L'entreprise japonaise devra réinventer sa responsabilité sociale vis-à-vis de ses employés, modifier un rapport de force teinté de sentimentalisme en un lien d'attention et de responsabilisation individuelle. La disparition de l'emploi à vie met un terme à la loi du silence pour le collaborateur. Aguerri par diverses expériences professionnelles, celui-ci se montrera plus actif et entreprenant pour revendiquer la reconnaissance de ses compétences plutôt que de ses années de service. La politique du personnel de l'entreprise japonaise conjuguera vraisemblablement la réduction des temps de travail, la flexibilité des conditions de travail et l'attractivité des salaires. Elle déploiera une offensive de charme envers la main-d'oeuvre féminine grâce à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'à de meilleures perspectives d'avancement. Le rapport de l'entreprise avec la communauté locale s'étoffera à l'avenir vis-à-vis de ses anciens employés, mais aussi à l'égard du reste du corps social. Elle découvrira les vertus de la transparence opérationnelle et du dialogue avec le corps social. L'entreprise japonaise sera moins japonaise dans l'origine nationale de ses propriétaires et de ses collaborateurs, dans ses méthodes de gestion et de commercialisation. Elle restera néanmoins japonaise.
La convergence de l'économie japonaise vers le capitalisme anglo-saxon procède plus d'une adaptation pragmatique que d'une réelle homogénéisation culturelle. L'histoire moderne démontre la résilience de la culture japonaise. L'ouverture sur l'Occident après 1858 se traduit moins par une acculturation qu'une catharsis. Elle permet la modernisation socioéconomique qu'une réforme interne ne parvenait à produire. Elle intervient par l'action conjuguée d'une partie de l'élite japonaise et des puissances occidentales. Le Japon entretient durant le XXe siècle son dynamisme économique par la greffe d'éléments étrangers sur son tissu industriel. L'étranger est à nouveau aux portes de l'archipel. A présent, la principale dynamique interne de changement provient de la base sociale, de la jeunesse surtout, qui tire parti d'une crise du modèle industriel traditionnel pour répudier une organisation sociale dont elle ne veut plus.
B. La responsabilité sociale de l'entreprise en Suisse
Le développement historique de l'économie suisse compose avec bien des éléments défavorables. La Suisse est riche en minerais pauvres et en terres ingrates. Sa situation géographique centrale en Europe a pour corollaire un accès malaisé aux voies commerciales maritimes. Le morcellement politique confédéral d'avant 1848 complique considérablement l'activité économique sans l'étouffer cependant 1097 . La Suisse s'industrialise précocement dès 1770 aux côtés de la France et de la Belgique. L'exiguïté du marché intérieur entraîne au cours du XIXe siècle la rapide orientation internationale de son commerce, de ses capitaux et même de ses structures productives 1098 . En 1913, l'économie helvétique est déjà florissante et très fortement internationalisée 1099 . Elle acquiert durant le XXe siècle ses caractéristiques contemporaines : une structure diversifiée avec la prépondérance d'activités de services ; une spécialisation productive dans des niches sectorielles à forte valeur ajoutée 1100 ; une forte intégration internationale 1101 .
Face à l'ingratitude de son contexte d'émergence, l'économie helvétique compte pour son développement sur des valeurs sociales fortes. La culture d'entreprise suisse fait la part belle au goût de la belle ouvrage et à la gestion de la complexité. L'approche consensuelle fonde la paix du travail et la paix sociale. Elle facilite la gestion des paradoxes et des contrastes culturels. L'entreprise suisse combine généralement des principes hiérarchiques marqués avec une procédure de consultation des collaborateurs. Elle se montre prudente dans ses stratégies et ses succès. Au revers de la médaille, la structure hiérarchique, le paternalisme et le consensus favorisent le conservatisme et la conformité, mais démontrent leurs limites dans un environnement très dynamique. Ces principes ne favorisent pas l'émergence du chaos créateur qui permet l'innovation. La culture du Sonderfall ne stimule pas l'élaboration de vision d'avenir et incite à la préservation de l'acquis. Le changement est d'ordre réactif et intervient lorsqu'il est incontournable. Il vise à changer le minimum pour préserver l'essentiel. Plus rarement, il saisit une opportunité. Le changement est graduel et prudent ; il s'effectue à la lumière d'expériences similaires entreprises par la concurrence 1102 . Ces caractéristiques traditionnelles de l'entreprise suisse sont à relativiser triplement. Elles occultent d'importantes différences d'une entreprise à l'autre. Elles évoluent face aux rapides et profondes mutations du contexte international d'affaires. Enfin leur pertinence est réduite pour l'entreprise multinationale suisse très fortement multinationalisée.
1° Caractères généraux et traits particuliers
La responsabilité sociale de l'entreprise suisse est de type méso-corporatiste ou rhénan. Elle consiste en un contrat implicite dont les termes seraient la contribution à l'emploi et aux rentrées fiscales publiques, l'élévation du niveau de vie, une production de qualité contre la tranquillité dans l'exercice des affaires. L'entreprise reconnaît ses interdépendances avec son milieu social. Dans ses relations d'affaires, elle tisse volontiers des liens durables avec des partenaires connus et jugés fiables. L'économie suisse reste éminemment corporatiste et cartellisée quand bien même ces caractères tendent à s'estomper 1103 . La main-d'oeuvre est une ressource fortement valorisée et plutôt respectée. Les exigences sociotechniques sont élevées à l'embauche. Elles sont affûtées dans le cadre de programmes de formation continue, ce qui contribue à fidéliser le collaborateur. La culture d'entreprise est solide et intègre, mais pas toujours ouverte. La satisfaction de la clientèle est une règle d'or. Elle s'effectue moins par la réalisation d'un produit d'avant-garde que par l'adéquation de l'article aux besoins de consommation 1104 . Les pratiques philanthropiques sont peu développées et surtout discrètes. Elles témoignent de l'attachement de l'entreprise aux valeurs sociales fondamentales. La philanthropie est essentiellement financière. Elle n'implique guère d'engagement social local du collaborateur. Tout à sa discrétion et son conformisme, l'entreprise suisse reste réservée en matière de label, de marketing institutionnel, de commerce équitable et de promotion des droits de l'homme.
Dans la logique d'une économie corporatiste, les intérêts sectoriels du secteur privé sont fortement relayés au sein de la sphère publique, mais restent largement méconnus du grand public. Celui-ci représente un peu le laissé-pour-compte du système. Le succès de l'économie helvétique n'a d'égal la faible transparence de son fonctionnement et de la vie interne de ses acteurs. L'entreprise estime que la qualité de ses produits constitue sa meilleure carte de visite et son compte-rendu public le plus probant. Le grand public ne paraît pas s'en émouvoir pour autant que soient honorés les termes du contrat susmentionné. L'actionnariat d'une grande société adopte un comportement passif sinon moutonnier en assemblée générale pour peu que lui soient versés de généreux dividendes. En bref, la discrétion proverbiale de l'activité de l'entreprise suisse découle du haut niveau de confiance que lui accorde le public et se justifie par la qualité de son activité et de ses résultats d'exercice. Sa responsabilité sociale s'exprime par son souci de satisfaire sa clientèle et de répondre aux attentes génériques de la société. En s'assurant de son intégration sociale et de la concordance de ses valeurs avec celles de son milieu social, elle assure sa propre viabilité 1105 .
L'entreprise suisse est naturellement peu encline à publier des informations non financières et à participer au débat d'opinion. Elle est ainsi particulièrement mal préparée à affronter la critique publique portant soit sur un dommage ponctuel découlant de son activité soit sur une option stratégique controversée 1106 . L'entreprise suisse cultive la discrétion dans la conduite des affaires. Elle a le succès modeste et redoute l'esclandre public. A ce titre, les récentes restructurations de l'économie helvétique bouleversent la culture d'affaires nationale ainsi que son appréciation publique. Les fusions qui ont donné naissance aux groupes Novartis et UBS ont par exemple constitué de véritables électrochocs. La Suisse croyait un peu naïvement son tissu économique immune de telles tendances. Pour leur part, les deux nouvelles sociétés se sont insuffisamment préparées à l'opprobre public subséquent. Elles s'activent présentement à redorer leur image de marque 1107 .
Le Novartis Venture Fund représente dans ce contexte une initiative intéressante 1108 . Il s'agit d'une fondation indépendante dont la naissance en 1996 répond à une situation de crise. Elle vise à soutenir financièrement d'anciens collaborateurs très qualifiés désireux de lancer leur propre entreprise. La fondation acquiert rapidement une logique à long terme par le financement de tout projet dans le domaine des sciences de la vie. Le projet n'émane plus forcément d'anciens collaborateurs et ne se déroule pas forcément en Suisse. L'engagement financier est généralement tripartite : aux fonds propres de l'entrepreneur se juxtaposent les capitaux d'investisseurs et ceux de la fondation. La PME bénéficiaire ne vend pas forcément le fruit de ses recherches à Novartis, mais est tenue de rembourser les montants avancés. Le but atteint est triple. Il est social, car il facilite la transition professionnelle de personnes très qualifiées, économique grâce à la stimulation de l'entrepreneuriat, technologique par l'encouragement à la recherche scientifique sans imposer apparemment le transfert technologique au groupe Novartis. Une telle initiative s'adresse à un segment limité de la main-d'oeuvre touchée par une restructuration, mais constitue une solution plus imaginative et plus constructive que tout plan social.
La société civile helvétique est également mieux informée et sensibilisée en matière de responsabilité sociale de l'entreprise 1109 . Les fonds éthiques se multiplient pour répondre aux attentes des nombreux investisseurs helvétiques 1110 . L'activisme de l'actionnariat institutionnel et privé se développe. La fondation Ethos et l'association ACTARES usent des droits de prise de parole et de vote dont jouit l'actionnaire pour de stimuler la responsabilité sociale de la société par l'établissement d'un dialogue régulier avec la direction 1111 . Leur action est limitée tant par la définition légale des droits de l'actionnaire que par la faible proportion en par rapport aux pays anglo-saxons d'entreprises suisses cotées en bourse. Certaines ONG -- notamment Amnesty International, le WWF et la Déclaration de Berne -- sensibilisent également les entreprises à leur responsabilité sociale et le grand public à leur capacité d'influence par leur achat sur le comportement du secteur privé. D'autres associations adoptent des méthodes plus discrètes pour un même objectif de conscientisation. Les organes d'évaluation sociale ou environnementale se multiplient, le plus souvent par le biais de départements spécialisés au sein de divers établissements bancaires ou de sociétés de consultance, mais également en tant que société d'audit social et environnemental telle que Centre-Info 1112 .

 Encadré 8 : Le réseau suisse des entreprises citoyennes...
Encadré 8 : Le réseau suisse des entreprises citoyennes...
Lié à l'European Business Ethics Network (EBEN, rebaptisé récemment CSR Europe), un Réseau suisse des entreprises citoyennes a vu récemment le jour, avec la fondation Philias pour cheville ouvrière 1113 . Il entend promouvoir parmi ses membres tout comme dans le reste des milieux d'affaires les pratiques socialement responsable de ses membres. La fondation Philias offre du reste des services de conseil et d'interface vis-à-vis des entreprises désireuses de se profiler en matière sociale. Un Réseau pour la responsabilité sociale de l'économie a été également fondé voici peu, regroupant des représentants des milieux académiques, du secteur privé et de la société civile. Il rebondit en quelque sorte sur les réflexions menées en 1997 lors d'une série de tables rondes consacrées à la citoyenneté de l'entreprise 1114 . Ses ambitions sont multiples, de l'élaboration d'un code de conduite modèle à la conscientisation du secteur privé et du grand public, en passant par la stimulation du débat politique sur ce thème.
La sensibilité publique aux questions environnementales est nettement exacerbée en Suisse alémanique alors que la partie romande se montre plutôt concernée par les questions sociales. Les grandes entreprises disposent généralement d'une politique environnementale mieux définie et publicisée que leur pendant social 1115 . L'observation est généralement pertinente quel que soit le secteur d'activité 1116 . Cette prépondérance tient également à la disponibilité d'outils de mesure. Beaucoup de sociétés suisses sont à présent certifiées ISO 14000 ou évaluent l'éco-efficience de leurs activités. De tels instruments sont encore insuffisamment développés en matière sociale 1117 . C'est dire que le public suisse romand ressent tout particulièrement un déficit d'information sociale alors que ce thème devient de plus en plus d'actualité. De façon générale, le volume et la qualité de l'information non financière publiée par les entreprises helvétiques laisse encore beaucoup à désirer à l'aune des meilleures pratiques internationales 1118 . La qualité des produits constitue une des préoccupations majeures du consommateur suisse. Celui-ci se montre particulièrement critique envers les conséquences sociales et environnementales de la commercialisation d'OGM. Cette préoccupation est mal relayée par la politique d'information des entreprises. Divers labels biologiques y remédient partiellement, quand bien même leur domaine d'application concerne plus largement une production respectueuse de l'environnement 1119 .
Du fait de la conscientisation accrue de la société civile, l'image publique d'une entreprise transnationale est toujours plus liée à son comportement dans les pays en développement. Le groupe ABB renonce actuellement à ses activités controversées d'équipement de grands barrages hydroélectriques comme celui des Trois Gorges en Chine pour concentrer ses activités dans l'infrastructure de transport et d'énergie 1120 . Jusque récemment, le secteur privé suisse affichait une désinvolture coupable vis-à-vis des conditions de travail offertes par ses sous-traitants. Certaines initiatives témoignent de sa prise de conscience. La société Veillon a mis par exemple en place dès 1994 un système de prévention du travail des enfants auprès de ses fournisseurs de tapis en collaboration avec la fondation STEP et l'ONG François-Xavier Bagnoud 1121 . Mabrouc (Switcher) a développé plus récemment auprès de son principal fournisseur indien un programme social qui s'adresse non seulement aux collaborateurs, mais à toute la population avoisinante : habitations pour la main-d'oeuvre d'origine lointaine, cantines, fourniture d'eau potable, dispensaires médicaux, financement partiel d'écoles publiques. Le jeune adulte est admis dans l'entreprise dès l'âge de seize ans, soit deux ans de plus que l'âge légal minimal 1122 . L'école gratuite ouverte en janvier 2001 au Sud de l'Inde et financée par la société Migros vise également à lutter contre le travail infantile 1123 . De telles approches intégrées de lutte contre le travail des enfants rejoignent la philosophie d'Owen à New Lanark : un problème économique est social en essence 1124 .
A fin 1999, la Déclaration de Berne a lancé avec l'Action de Carême et Pain pour le prochain le volet suisse de la campagne européenne Clean Clothes. La campagne oeuvre à la sensibilisation du consommateur au respect des droits fondamentaux au travail dans le secteur textile des économies en développement. La campagne est charpentée autour d'un code de conduite que les entreprises signataires -- pour l'heure Mabrouc, Migros et Veillon -- s'engagent à respecter. La campagne prépare actuellement une phase pilote en Inde et en Chine. La base normative du code de conduite est moins large que celle du label SA8000 puisqu'elle considère les cinq droits fondamentaux au travail 1125 . Leur respect est en revanche garanti plus sûrement par un monitoring indépendant effectué à intervalles réguliers. La main-d'oeuvre locale peut ainsi mieux faire valoir ses droits fondamentaux et dénoncer leur éventuelle violation. A l'instar d'AA1000 et de l'ETI, la mise en oeuvre du code de conduite n'implique pas de procédure de certification en vue de l'obtention de label, mais une information publique régulière qui rend compte des résultats obtenus 1126 .
La campagne européenne Clean Clothes et le Réseau suisse des entreprises citoyennes amorcent peut-être une nouvelle tendance en matière de responsabilité sociale de l'entreprise. Jusqu'à présent, les initiatives tiennent du franc-tireur et n'impliquent aucune coordination parmi le secteur privé 1127 . La Fédération des entreprises suisses (anciennement Union suisse du commerce et de l'industrie ou Vorort 1128 ) est impliquée dans divers groupes de travail au sein de la CCI, de l'OCDE et de l'UNICE 1129 . La Fédération des entreprises suisses n'a pas émis à l'égard de ses membres de directives autres que le renvoi aux principes cadre énoncés par ces associations. L'Union patronale suisse (UPS) affiche une position similaire. La très large thématique de la citoyenneté de l'entreprise est abordée de façon ponctuelle au gré de dossiers politiques sur lesquels les associations prennent position ou en fonction de leurs priorités d'action. L'Union syndicale suisse (USS) s'active également, outre en faveur de la préservation des acquis sociaux, dans des dossiers spécifiques tels la fixation légale d'un salaire minimum et d'un horaire hebdomadaire de 36 heures. Au niveau européen, les associations patronales pressent à la flexibilisation des conditions de travail, à la stimulation de l'innovation technique et à l'amélioration des conditions cadre 1130 . En France, le Medef a abandonné toute référence explicite à ce thème et milite désormais pour l'assouplissement des formes d'emploi 1131 . La réflexion sur le thème de la responsabilité sociale de l'entreprise et la promotion des meilleures pratiques y relatives s'effectue principalement par le biais de «clubs» de milieux d'affaires. Les groupements les plus en vue sur le vieux Continent sont le WBCSD, le réseau CSR Europe, la CCI, au Royaume-Uni Prince of Wales Business Leaders Forum (PWBLF) et Business in the Community, aux Etats-Unis Business for Social Responsibility (BSR) 1132 . L'impact en Suisse des activités de ces groupements est indirect, mais non négligeable.
Parmi ces enceintes, les entreprises multinationales les plus actives sont probablement européennes telles Shell et BP Amoco. De nombreuses entreprises multinationales américaines -- telles que Du Pont, Hewlett & Packard, IBM, Eli Lilly -- sont très actives en matière de responsabilité sociale telles, mais se montrent prudentes dans leurs engagements formels en raison de l'approche légaliste des affaires qui prévaut aux Etats-Unis. Quant aux entreprises multinationales japonaises, elles se distinguent généralement par leur discrétion et parfois par leur efficacité à l'image de Toyota et de Sony. Le profil social très affirmé de Body Shop et Levi Strauss représentent un peu des cas particuliers. Par son approche très marketing de sa responsabilité sociale, Body Shop se démarque des grandes sociétés plus qu'elle ne les guide. Levi Strauss ne peut guère se targuer de valeur d'exemple au sein des milieux d'affaires en raison de ses graves difficultés financières 1133 .
Le retentissement en Suisse de l'engagement social marqué à l'étranger de certaines multinationales est inégal. La petitesse du marché et la cherté du coût de la vie en Suisse incitent beaucoup de sociétés à y installer une représentation commerciale et un centre administratif plutôt qu'un site productif. Dans ce cas, l'engagement social est très réduit et ne se distingue guère de la politique définie par le siège européen de la firme 1134 . Lorsque une entreprise transnationale étrangère établit un siège important en Suisse, l'échelle géographique de ses activités est ample -- l'Europe et voire même l'Afrique et le Moyen-Orient -- ou correspond à un point d'ancrage d'un réseau continental. Sa politique sociale s'ajuste en conséquence. Le public suisse est pour l'heure peu demandant d'une affirmation en matière de responsabilité sociale de type anglo-saxonne et offre un retour sur image réduit du fait de la petitesse de son marché. La philanthropie à l'anglo-saxonne paraît néanmoins en progression 1135 . Les entreprises multinationales les plus profilées au niveau international se sont montrées particulièrement peu réceptives à notre étude, toutes origines nationales confondues. Il en va de même pour des sociétés aux abois comme Microsoft. Certains refus sont motivés par les restructurations organisationnelles de la société qui appellent à la redéfinition de la politique sociale. En somme, la responsabilité sociale de l'entreprise paraît moins déterminée par son origine nationale que par sa culture interne et par le contexte opérationnel local.
2° La citoyenneté de l'entreprise en région genevoise
L'étude de la responsabilité de la grande entreprise en région genevoise introduit une dimension prospective dans l'analyse. Plutôt que de brosser un compte-rendu inévitablement incomplet des diverses initiatives sociales du secteur privé, les pages ci-dessous se fondent sur les réalisations actuelles pour suggérer leurs possibles développements futurs. L'analyse considère les interactions et les attentes mutuelles du secteur privé, des pouvoirs publics et de la société civile. L'élargissement du champ analytique permet une évaluation plus réaliste et plus fine des enjeux relatifs à la citoyenneté de la grande entreprise.
Genève est une petite grande ville 1136 . Dépourvue d'arrière-pays et d'importante fonction politique nationale, elle ne peut prétendre au titre de métropole. Genève est une ville à vocation internationale et à fonction spécialisée. A sa forte intégration économique internationale se juxtapose la présence sur son territoire d'une importante communauté d'acteurs internationaux -- organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que de nombreuses entreprises transnationales. La Genève internationale confère à la population locale son caractère très cosmopolite. Elle contribue également à l'importance du bassin d'emploi 1137 et à la forte tertiarisation de l'économie locale.
L'essor de la Genève internationale s'explique historiquement par la neutralité politique de la Confédération helvétique durant la Guerre froide, géographiquement par la situation centrale de la Suisse sur le vieux Continent et d'un point de vue logistique par la qualité de ses transports internationaux. Plusieurs très grandes sociétés américaines, notamment Caterpillar, Du Pont, Hewlett & Packard s'implantent à Genève au début des années soixante, suivies peu après par IBM et Motorola. Leurs activités contribuent à la vigueur de la croissance ainsi qu'à la rapide tertiarisation de l'économie locale. Pendant cette période dorée, le tissu économique genevois se densifie par l'implantation de nombreuses sociétés étrangères aux côtés des entreprises locales. En 1991, 440 entreprises transnationales suisses et étrangères sont installées sur le canton de Genève et procurent plus de 38'000 emplois. Parmi celles-ci, 264 sociétés développent des activités à vocation internationale (plus de 20'000 emplois ou 8% de l'emploi cantonal) alors que 175 entreprises se limitent à des activités locales ou nationales (18'000 emplois) 1138 .
L'économie genevoise passe sans encombre les chocs pétroliers des années septante avant d'entrer en crise structurelle profonde au début des années nonante. La récession se traduit par un net fléchissement conjoncturel, par l'augmentation massive du chômage et la détérioration des finances publiques 1139 . La chute du mur de Berlin marque la fin du statut privilégié dont jouissait Genève pendant l'affrontement Est-Ouest. Sur un plan politique comme économique, elle entre en concurrence directe avec les plus importantes métropoles européennes telles que Paris et Londres ou de grandes villes comme Francfort et Amsterdam. La forte intégration économique internationale de l'économie genevoise s'inscrit en porte-à-faux par rapport à l'isolement politique international de la Confédération helvétique découlant de sa non-adhésion à l'Union européenne en 1992. La qualité des conditions cadre locales ainsi que la promotion économique revêtent ainsi une importance toute particulière.
Les options sectorielles choisies en matière de promotion économique s'inscrivent alors dans l'évolution structurelle de l'économie genevoise depuis les années soixante. Elles privilégient les activités de services et d'industries à forte valeur ajoutée telles que les NTIC et plus largement la nouvelle économie. A l'exemple du secteur des télécommunications, ces efforts de promotion économique s'inscrivent dans un projet politique de constitution de pôles de compétence, sinon d'excellence technologiques. De nombreuses sociétés étrangères du secteur tertiaire s'établissent sur le canton de Genève pendant la dernière décennie. L'échelle et la forme d'établissement se modifie toutefois considérablement par rapport aux années soixante. L'entreprise est généralement de taille relativement réduite. Elle établit sur sol genevois un pôle de son réseau européen et non plus un siège européen ou mondial comme souvent dans le passé. Le récent renforcement de la présence genevoise de Procter & Gamble, de Reynolds (racheté par Japan Tobacco) et de Kodak sont sui generis à cet égard. Le marasme économique persistant durant la décennie nonante incite le politique avant tout à attirer un maximum d'entreprises étrangères dont les activités correspondent aux options sectorielles définies. La considération de questions sociales et environnementales liées à l'implantation de nouvelles société est secondaire. La forte sollicitation du système d'action sociale contribue à accentuer la dette publique. La densification du tissu économique local a pour indésirable corollaire des nuisances environnementales accrues 1140 .
La relance de l'économie genevoise s'amorce dès 1998 et se confirme par la suite avec de solides perspectives de croissance économique et d'embauche, particulièrement dans le secteur bancaire et financier ainsi que dans les activités de conseil. La création d'entreprise est également stimulée par l'amélioration conjoncturelle. Néanmoins le taux de chômage reste élevé en comparaison nationale et le nombre de chômeurs de longue durée augmente, ce qui suggère une inadéquation structurelle entre l'offre et la demande d'emploi 1141 . A fin 1997, le gouvernement genevois présente ses priorités politiques pour la législature courant jusqu'en 2001 dont quelques unes sont présentées ci-après :
| Tabl. 7 : Priorités politiques du gouvernement genevois 1142 |
| Objectifs |
Moyens |
Soutien au redressement économique. |
Soutien à la créativité et l'innovation technologique
Aide et crédit pour PME.
Renforcement de la promotion économique. |
Lutte contre le chômage et ses corollaires. |
Partage du temps de travail.
Formation.
Création d'emplois de proximité. |
| Qualité des rapports avec les organisations internationales. |
Défense et essor du rôle international de Genève. |
| Gestion du cadre de vie en fonction des principes généraux du développement durable. |
Préservation de la qualité de vie et du patrimoine naturel.
Justice sociale fondée sur une économie solidaire et sur la notion d'équité. |
Fondamentalement, le programme politique ambitionne au développement local durable dans ses dimensions économique, sociopolitique et écologique. L'allusion au développement durable n'est pas fortuite. Elle est concomitante avec le lancement de la mise en oeuvre locale de l'Agenda 21 à Genève. L'Agenda 21 est le programme d'action élaboré en 1992 par la Conférence de Rio afin de concrétiser la notion de développement durable aux niveaux international, national et local. La connotation écologique, sociale et tiers-mondiste de l'Agenda 21 cadre a priori assez mal avec des objectifs de croissance et de promotion économiques. L'antinomie entre les objectifs économiques d'une part, écologique et sociaux d'autres part est surévaluée. Dans son développement, toute communauté locale est confrontée à cinq défis 1143 :
-
Nourrir ses compétences de base et inspirer des visions de qualité qui rencontrent l'assentiment du secteur public et privé.
-
Intensifier les liens entre les entreprises locales.
-
Développer un environnement propice à l'établissement de sociétés étrangères et favoriser l'acquisition locale de leur savoir-faire.
-
Renforcer la sécurité de l'emploi et assurer la qualité et la suffisance des filières de formation.
-
Promouvoir de nouveaux modèles d'engagement civique et de leadership qui développent le capital social local.
La réalisation de ces objectifs comporte potentiellement des incidences favorables pour le secteur privé comme la communauté locale. Elle suggère des solutions intégrées basées sur la concertation plutôt que la réglementation. Elle suppose une perspective à long terme concordante avec l'esprit de l'Agenda 21. Ces solutions s'appuient sur les atouts du milieu local pour mieux pallier ses insuffisances. Le tableau en page suivante synthétise la situation en région genevoise. Les atouts recensés constituent autant de motifs pour une entreprise transnationale d'élire Genève pour lieu d'implantation. Les faiblesses représentent par contre en principe des facteurs répulsifs pour celle-ci et des défis à résoudre pour les collectivités publiques. Sous un autre angle, elles sont également des domaines susceptibles de connaître le développement d'actions citoyennes. Comme toute entreprise, l'entreprise transnationale bénéficie de la qualité de son environnement. Plus qu'une entreprise locale, l'entreprise transnationale est sensible à la qualité de son milieu opérationnel, car elle peut redéployer ses activités dans un autre contexte local plus favorable. La communauté locale doit ainsi séduire et fidéliser l'entreprise transnationale tout stimulant son ancrage. Le « pacte de citoyenneté » qui unit l'entreprise à la communauté locale s'appuie sur les compétences respectives des acteurs. Il trouve matière à concrétisation dans en matière de géographie, d'économie, de politique et de social.
| Tabl. 8 : Atouts et faiblesses de la région genevoise 1144 |
| |
Atouts |
Faiblesses |
| Géographie |
Position géographique stratégique au centre de l'Europe.
Densité et qualité du réseau de voies de communications aériennes, ferroviaires et routières.
Présence de nombreuses organisations internationales. |
Exiguïté du territoire genevois et helvétique.
Morcellement politico-administratif (arc lémanique et surtout région Rhône-Alpes).
Faible ouverture politique de la Suisse. |
| Economie |
Tissu économique dynamique et diversifié, axé sur les secteurs d'activité à haute valeur ajoutée et à fort potentiel de croissance (services surtout).
Pôle de compétence et d'expertise en matière de NTIC, de services (domaine bancaire, assurances, conseil juridique et fiscal, audit), de santé et d'écologie.
Potentiel élevé de coopération en matière de R&D entre entreprises et instituts de recherche.
Compétences, productivité et motivation de la main-d'oeuvre locale.
Fort pouvoir d'achat de la population locale. |
Dynamisme entrepreneurial insuffisamment développé dans le tissu économique, trop peu soutenu par les pouvoirs publics et faiblement valorisé socialement.
Diversification réduite du tissu économique local notamment en matière d'activités industrielles à forte valeur ajoutée.
Difficultés de lancement de programmes de recherches mixtes.
Lacunes techniques, faibles flexibilité et polyvalence ainsi que prétentions salariales élevées de la main-d'oeuvre locale. |
| Polititique |
Cadre institutionnel solide, efficace et stable.
Fiscalité attractive pour les entreprises et les personnes privées.
Système d'instruction publique et privée de bonne qualité. |
Nombre limité de permis de travail pour étrangers.
Lenteur du processus législatif.
Insuffisances, rigidités et inadéquation des formations de pointe. |
| Société |
Niveau et qualité de vie : cadre géographique, vie culturelle et sportive, infrastructures de transport locaux.
Paix du travail et paix sociale.
Diversité socioculturelle. |
Capacité insuffisante des écoles internationales ; capacité insuffisante et faible rapport qualité/prix du parc de logements ; coût élevé de la vie locale.
Méconnaissance mutuelle entre la Genève internationale et locale. |
Géographie
L'attractivité internationale de Genève dépend de façon cruciale de la qualité de sa desserte aérienne et de son infrastructure de télécommunication. La constitution d'un pôle d'excellence en matière de télécommunications suppose une infrastructure de pointe. La région genevoise améliore actuellement ses liaisons internationales par l'installation d'un réseau souterrain de fibres optiques. Elle doit veiller à conserver l'organisation des salons Telecom organisés par l'Union internationales des télécommunications (UIT). La question des transports aériens est plus problématique. Aux yeux de nombreux acteurs internationaux, l'aéroport genevois n'assure plus de façon satisfaisante les liaisons directes avec l'étranger -- notamment vers l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique. Les nuisances environnementales occasionnées par l'aéroport paraissent indissociables de la vocation internationale de l'agglomération genevoise. Le morcellement politico-administratif de l'arc lémanique et de la région Rhône-Alpes entraîne nombre d'inconvénients pour l'activité économique. Il contribue aux insuffisances et à la cherté des logements en région genevoise et complique par exemple l'exécution d'un mandat d'affaires sur la circonscription cantonale vaudoise 1145 . La coopération transfrontalière au sein de la région Rhône-Alpes est encore plus complexe en raison de la non-adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Elle reste néanmoins nécessaire. Le décloisonnement politico-administratif de l'arc lémanique permettrait de décongestionner le centre ville genevois et de réduire l'expansion géographique de l'agglomération genevoise.
La citoyenneté environnementale de l'entreprise est protéiforme. Elle concerne les multiples facettes de sa politique environnementale, du contrôle des émissions polluantes au recyclage des déchets industriels en passant par des évaluation d'éco-efficience et des mesures de sécurité. Si l'acquis en ce domaine est déjà solide, il n'exclut pas des initiatives novatrices telle la signature en mars 1999 entre l'Etat de Genève et la société Firmenich d'une convention portant sur l'aménagement de l'embouchure de l'Allondon. La société s'engage à financer partiellement des travaux d'aménagement des rives et de restauration du biotope local. Le projet s'inscrit dans le cadre de la renaturation d'un important site voué à devenir une réserve naturelle 1146 . Le mécénat écologique de Firmenich ouvre une voie nouvelle dans la région genevoise en matière de partenariat public/privé. Un tel partenariat pourrait s'envisager vis-à-vis d'un problème plus aigu et qui affecte directement toute entreprise transnationale, soit la politique de logement. En collaboration avec l'Etat, l'entreprise transnationale pourrait acquérir ou construire des logements qu'elle louerait à prix coûtant à une partie de sa main-d'oeuvre. Cette pratique est courante dans les agglomérations japonaises. Sans réactualiser les coûteuses cités-usines du XIXe siècle, un tel parc d'habitation faciliterait la rotation de la main-d'oeuvre d'origine étrangère alors qu'il adoucirait les fluctuations conjoncturelles et les tendances spéculatives du marché du logement.
Economie
La formation de pôles de compétence et d'expertise densifie les interdépendances locales. Les activités de sous-traitance, de maintenance, de conseil et d'audit se développement sur des prémices de connaissance et de reconnaissance mutuelles. Le secteur des services n'échappe pas à cette règle. La tendance actuelle au recentrage sur les activités de base induit par exemple la multiplication des contrats de maintenance informatique entre des grandes et des petites sociétés ainsi que vis-à-vis des organisations internationales sises à Genève. Ces liens d'affaires durables solidifient et dynamisent ainsi le tissu économique local. La très forte orientation vers les activités de service de l'économie genevoise peut nuire à terme à son dynamisme par la réduction des complémentarités sectorielles. A cet égard, la citoyenneté de l'entreprise suppose la multiplicité de ses liens d'affaires avec des entreprises locales. Elle implique aussi sa contribution à la formation de pôles d'expertise par les échanges d'idées, d'expériences et de compétences avec des sociétés aux activités similaires ou complémentaires. Une telle fertilisation mutuelle participe à l'élévation des compétences locales ainsi qu'à l'affermissement des liens interpersonnels et inter-institutionnels. Elle est plus féconde dans une approche collective et coordonnée avec les pouvoirs publics.
La stimulation et la valorisation de l'esprit d'entreprise est un vieux problème en Suisse. L'entrepreneuriat nécessite tant un cadre institutionnel adéquat qu'une valorisation sociale suffisante. Les deux éléments sont perfectibles dans le cas genevois. Diverses structures d'encadrement technique et d'aide financière existent dans la région genevoise, telles Fondetec, Fongit, Genilem ou encore l'Office pour la promotion de l'industrie genevoise (OPI). Les milieux patronaux estiment leurs moyens et leur coordination insuffisants 1147 . Par ailleurs, la propension à entreprendre est relativement faible en Suisse et les projets viables trop rares 1148 . La haut niveau de vie et la forte sanction sociale d'un échec de ce type expliquent la préférence générique en faveur d'un emploi sûr, stable et rémunérateur. La qualité et le dynamisme du tissu des PME est pourtant la précondition de l'ancrage économique local d'une grande entreprise. La réciproque est tout aussi vraie. Les grappes de PME prospèrent mieux si elles bénéficient du savoir-faire et des mandats de grandes sociétés qui font ainsi preuve de leur citoyenneté économique locale.
La recherche scientifique menée dans les universités et les instituts de recherche est d'un niveau élevé. La valorisation industrielle de la recherche scientifique est par contre relativement lente en Suisse, problème auquel répond le mandat élargi des hautes écoles spécialisées 1149 . La floraison actuelle de start-up dans des niches sectorielles à forte intensité technologique témoigne cependant déjà d'une amélioration en l'espèce 1150 . Les entreprises transnationales de la région genevoise ont conclu de nombreux accords de coopération et valorisent beaucoup cette proximité avec de fortes qualifications scientifiques. A cet égard, les difficultés de lancement de programmes de recherches mixtes tiennent souvent aux termes du contrat de coopération. Unitec Genève, le bureau de transfert de technologie de l'Université, se refuse à cautionner toute recherche «captive» guidée exclusivement par les intérêts privés. Le bureau se réserve le droit de remettre en vente le brevet d'une innovation technique qui ne serait pas développé commercialement dans un délai raisonnable. Afin de favoriser ce transfert de technologies nouvelles de l'Université vers les entreprises, Unitec accepte depuis peu le paiement d'un brevet par des parts du capital social d'une jeune société. Elle organise également une formation entrepreneuriale de base pour les scientifiques désireux de valoriser par eux-mêmes une innovation technique 1151 . Ces initiatives constituent un terreau propice à l'expression de la responsabilité sociale de l'entreprise transnationale, à condition que les accords mixtes de recherche et de partenariat s'effectuent sur des bases saines 1152 .
En matière d'emploi, la responsabilité sociale de l'entreprise transnationale sise à Genève ne paraît ni meilleure ni pire qu'ailleurs. Le tissu économique genevois a connu également de fortes restructurations qui se sont traduites par d'importantes réductions d'effectif. Le cahier des charges attaché aux différents postes tend à augmenter tout comme la charge nerveuse reposant sur leur titulaire. La motivation du collaborateur constitue un sérieux problème auquel ne répond pourtant pas souvent une politique spécifique 1153 . L'intéressement des cadres aux bénéfices de la société, mesure en vogue, offre une réponse partielle au problème. Elle ne concerne qu'une minorité de collaborateurs et ne constitue pas une rémunération non matérielle à laquelle la main-d'oeuvre est toujours plus sensible. Ceci étant, les collaborateurs employés par les entreprises transnationales jouissent de conditions de travail et de rémunération élevées, souvent supérieures à la moyenne locale.
La meilleure considération et valorisation des compétences locales par le société transnationale augmenterait sa contribution à l'emploi et réduirait les pressions inflationnistes sur le marché du logement. En dépit des doléances exprimées par une partie des milieux d'affaires internationaux, l'obtention de permis de travail est relativement aisée pour une entreprise transnationale pour peu qu'elle démontre la pénurie locale de compétences. Il s'agit en l'occurrence davantage d'un problème de longueur de procédure que de principe 1154 . L'entrée en vigueur des accords bilatéraux conclus entre la Confédération helvétique et l'Union européenne ne devrait pas modifier fondamentalement la situation, mis à part un biais plus fortement pro-européen dans la politique d'octroi 1155 . Cette politique gagnerait en efficacité si le délai d'obtention était raccourci afin de plaquer au plus près aux opportunités d'affaires.
La contribution à l'emploi assurée par les entreprises transnationales s'adresse essentiellement à une main-d'oeuvre très qualifiée, soit à une portion réduite du marché du travail local. Le secteur privé regrette le manque de compétences hautement spécialisées de la main-d'oeuvre genevoise tout en reconnaissant la très bonne qualité de son instruction de base. Il déplore le caractère trop académique de l'enseignement universitaire 1156 . La main-d'oeuvre locale manque en outre de flexibilité, de polyvalence et d'ouverture d'esprit alors qu'elle émet des prétentions salariales élevées. Ces divers facteurs limitent l'embauche de collaborateurs non étrangers et par suite la responsabilité sociale locale de l'entreprise transnationale. Le dépassement de telles limitations suppose un effort conjoint du secteur privé et des pouvoirs publics ainsi que l'évolution des mentalités. Certaines inadéquations du marché de l'emploi local sont réelles et aiguës telles la pénurie d'informaticiens. D'autres n'en sont pas. L'entreprise transnationale qui s'implante à Genève connaît souvent imparfaitement les institutions, les filières de formation et les compétences locales. Elle tend par exemple à exiger systématiquement un diplôme à vocation internationale du type MBA. Interface Entreprises oeuvre dans ce contexte à remédier à ce déficit d'information et à une meilleure équivalence des diplômes. Son action serait judicieusement complétée par une promotion renforcée à l'échelon européen des diplômes universitaires suisses 1157 .
Le reproche du secteur privé portant sur le caractère trop académique de l'enseignement universitaire est partiellement justifié. L'enseignement vise de plus en plus à forger des outils d'apprentissage qui permettront l'adaptation au contexte de travail. Il serait vain de vouloir former des universitaires sur une base technique trop étroite qui serait rapidement surannée dans la vie économique et sociale. Ceci étant, les passerelles telles que l'AIESEC manquent encore entre l'Université et le monde du travail, tant pendant qu'à l'issue de la formation de deuxième et troisième cycles. Pour les degrés inférieurs de formation, l'apprentissage du français pour les ressortissants étrangers, des langues étrangères et de l'anglais pour les Suisses revêtent une importance cardinale. Les voies d'apprentissage et de formation professionnelle supérieure restent encore insuffisamment développées 1158 . Les stages en entreprise représentent une autre modalité d'insertion à encourager quel que doit le niveau de formation. En tout cela, l'adaptation aux nécessités économiques des politiques publiques doivent distinguer les éléments structurels et conjoncturels et surtout conserver la finalité publique de l'instruction et de la formation. L'enseignement de l'anglais dans les classes primaires ne saurait par exemple occulter la nécessité d'apprentissage de l'allemand pour faciliter la cohésion nationale.
L'amélioration du niveau qualitatif des compétences locales, ainsi que leur adéquation aux besoins économiques supposent un dialogue constant entre le secteur privé et les pouvoirs publics ainsi que des actions communes ou coordonnées. L'entreprise socialement responsable accepte d'assumer une part de la formation locale de compétences spécifiques dont elle a besoin. Ses programmes de stagiaires ont un tour réellement formateur. Elle peut également contribuer à la conscientisation et à la formation des cadres de demain. L'AIESEC a fait de la responsabilité sociale de l'entreprise une de ses thématiques de réflexion privilégiées. Des cadres d'entreprises pourraient y intervenir plus fréquemment pour faire part de leurs expériences y relatives. De son côté, l'Université se doit d'offrir dans ses cursus académiques des enseignements qui valorisent une conception socialement responsable de l'activité économique. La coordination locale, régionale et nationale serait assumée par le RSE.
La mentalité genevoise constitue à la fois un frein à la citoyenneté de l'entreprise et un objectif potentiel de son expression. La mentalité locale reflète une aisance économique certaine : contestataire et gouailleuse dans les dires, moins entreprenante dans les faits. Le secteur privé et les pouvoirs publics s'accordent pour estimer que le jeune Genevois manque de ténacité et d'assurance, d'ouverture d'esprit et de flexibilité dans ses démarches de recherche d'emploi 1159 . Ce trait ne représente pas l'apanage des jeunes générations. Le secteur bancaire, privé en particulier, souffre d'une réputation de conservatisme et de faible sensibilité à la détresse sociale. Dans ce contexte, l'engagement citoyen de l'entreprise représente pour le collaborateur une opportunité d'ouverture aux réalités sociales de son milieu de vie et de responsabilisation individuelle. D'autres actions agissent moins en profondeur, mais comportent une utilité sociale indéniable. Une banque de la place genevoise a décidé également d'une action de marketing institutionnel et de sponsoring sportif destinée à rompre l'image peu flatteuse qui colle aux basques du secteur bancaire. Il y a en l'espèce une multitude d'initiatives possibles pour faire des individus et des entreprises de véritables citoyens au niveau local.
Politique
Les relations entre les entreprises transnationales et les pouvoirs publics genevois sont plutôt sereines. Le secteur privé apprécie le cadre institutionnel solide, efficace et stable local ainsi que la transparence des procédures. Il déplore par contre la lenteur des décisions politiques tout comme la tendance à la boulimie administrative et à l'endettement public 1160 . Il presse le politique en faveur de l'amélioration des conditions cadre de l'activité économique. Le régime fiscal genevois est globalement attractif en comparaison internationale pour la société commerciale et la personne privée 1161 . Des avantages fiscaux sont en outre souvent octroyés à la société étrangère nouvelle venue. Les points faibles du système de taxation concernent d'une part la double imposition des bénéfices des personnes morales et physiques et d'autre part l'insuffisance des incitations fiscales à entreprendre 1162 . La philanthropie individuelle n'est guère stimulée par des déductions fiscales. Quant aux charges sociales obligatoires assumées par l'employeur, elles sont également modestes en comparaison internationale 1163 .
Les interactions entre les sphères publique et privée s'effectuent par des contacts personnalisés entre les décideurs politiques et économiques ou par la participation de collaborateurs de sociétés privées à divers cercles politiques consultatifs. La modalité la plus courante et la plus visible reste toutefois l'action collective via notamment la Fédération des syndicats patronaux (FSP) ou la Chambre de commerce et d'industrie de Genève (CCIG) 1164 . Les deux associations regroupent la gros du tissu économique genevois et principalement de ses PME. Le Groupement des entreprises multinationales (GEM) est né dans les années septante sous la forme de rencontres régulières de responsables de ressources humaines. L'association s'est étoffée depuis tant sur le plan du nombre de ses membres -- une cinquantaine à présent -- que dans son champ d'activité. L'association est en majorité anglosaxonne ; les firmes suisses y sont rares 1165 . Le GEM coordonne les actions du secteur économique international et fait office de courroie de transmission de ses intérêts auprès du secteur privé et des pouvoirs publics locaux. Le groupement négocie et gère par exemple des contrats cadre d'assurances maladie et accident. En matière politique, son motto est le profil bas pour une souplesse et une efficacité d'action maximales.
Les associations patronales, les chambres de commerce et le GEM constituent des instances locales privilégiées de promotion de la responsabilité sociale de l'entreprise. L'échange d'expériences au sein de groupes de réflexion est propice à convaincre les entreprises les plus réticentes. Des programmes cadre de responsabilité sociale favoriseraient l'engagement des PME aux moyens financiers limités. Du reste, certaines PME démontrent qu'il est possible de faire beaucoup avec des ressources limitées. La responsabilité sociale est question de volonté plus que de moyens. L'Etat a un rôle important à jouer en tant que médiateur et facilitateur. Diverses mesures incitatrices, telles l'attribution d'une distinction, des pouvoirs publics contribuent par exemple à la promotion de la responsabilité de l'entreprise 1166 .
La dimension politique de la responsabilité sociale de l'entreprise concerne son dialogue vis-à-vis de tous ses partenaires. Elle trouve pour expression première son attachement à la paix du travail et au respect de sa main-d'oeuvre par une culture d'entreprise ouverte. Il est en l'espèce rien de très spécifique aux entreprises de la région genevoise qui n'ait été dit précédemment 1167 . La réglementation publique du marché du travail est légère en comparaison internationale, notamment en matière de salaires et d'effectifs 1168 . Un régime libéral d'encadrement de la vie économique suppose une attitude responsable des acteurs. Les conventions collectives cristallisent les acquis sociaux. Elles sont à défendre avec clairvoyance. Leur adaptation aux réalités socioéconomiques contemporaines ne doit pas se traduire par la péjoration foncière des conditions de travail. La paix du travail est à ce prix.
La Genève internationale, politique comme économique, apprécie la tranquillité dont elle jouit en terre genevoise. Les entreprises suisses ne sont pas les dernières à apprécier cet état de fait. En affaires, chaque mot prononcé en public, chaque engagement formel peut se retourner contre son auteur si son comportement ne reflète pas ses dires. En démocratie, la jouissance d'un pouvoir suppose de rendre compte de ses actes. L'entreprise n'échappe pas à cette règle de l'Etat de droit. La discrétion nécessaire aux affaires ne justifie pas une politique du silence vis-à-vis de la société civile 1169 . Elle suppose une transparence d'action minimale. Les difficultés de réalisation de la présente étude témoigne de l'ampleur des progrès à effectuer en l'espèce.
Social
Une des doléances majeures exprimées actuellement par la Genève internationale envers l'infrastructure sociale locale concerne l'insuffisance capacitaire de l'Ecole internationale 1170 . Le phénomène paraît plus conjoncturel que structurel, car l'établissement a déjà entrepris de remédier. Il met néanmoins le doigt sur le nécessaire couplage entre les politiques de promotion économique et d'infrastructure éducationnelle. Une carence similaire se retrouve au niveau des crèches, jardins et garderies d'enfants. Elle pourrait être partiellement palliée par des initiatives émanant de grandes entreprises ou d'organisations internationales. Les collaborateurs sont sensibles à de telles facilités qui concourent à la qualité des conditions de travail. L'engagement direct de l'entreprise dans l'infrastructure d'éducation publique est beaucoup plus problématique. La mentalité suisse est plutôt réfractaire à cette idée. Certaines sociétés ont déployé des initiatives d'ampleur limitée vis-à-vis d'associations privées par la mise à disposition et la maintenance de matériel informatique. Comme suggéré plus haut, la citoyenneté de l'entreprise se manifeste à tous niveaux de formation par la transmission de son savoir-faire et par l'encouragement à l'acquisition de ses compétences dans le respect de la finalité publique de l'éducation.
Les collaborateurs étrangers des entreprises transnationales établies à Genève s'estiment dans leur large majorité satisfaits par la qualité de vie locale 1171 . L'agglomération genevoise offre nombre d'avantages similaires à de grandes métropoles européennes sans présenter leurs inconvénients. La richesse de l'infrastructure de loisirs et de la vie culturelle ainsi que la qualité des réseaux de transport locaux compensent largement la cherté des logements et du coût de la vie. La paix du travail et la paix sociale concourent également à assurer la qualité de vie dans la région genevoise. La situation sociale n'est pourtant pas idyllique. La décennie nonante a vu la précarisation matérielle et l'exclusion sociale d'une portion croissante de la population locale. Les familles monoparentales se multiplient. Le vieillissement de la population accroît les besoins en soins médicaux et en aide sociale. L'intégration socioculturelle et économique des étrangers est largement perfectible. A Genève comme partout en Suisse, la détresse sociale est probablement d'ordre moins matériel que moral.
La citoyenneté de l'entreprise peut ainsi contribuer à préserver la qualité de vie et à la cohésion sociale locales. La manifestation par excellence de la responsabilité sociale de l'entreprise concerne l'emploi -- sa rémunération et ses conditions d'exercice. Il est clairement des formes d'activité professionnelle qui précarisent la condition matérielle et psychologique du collaborateur comme trop souvent lors du travail sur appel. La flexibilisation des conditions de travail peut s'effectuer de manière plus mutuellement bénéficiaire. Le partage du temps de travail et le télétravail, souvent malaisés dans les postes clé, restent encore insuffisamment favorisé aux échelons subalternes. Ce type d'aménagement du travail participe pourtant à la lutte contre l'exclusion sociale. L'entreprise peut en outre développer diverses formes d'initiatives sociales vis-à-vis des personnes plus défavorisées. L'économie solidaire représente une des passerelles entre la logique marchande et l'action sociale. Certaines sociétés ont mis sur pied des ateliers protégés de production qui assurent l'insertion professionnelle de personnes handicapées. Les services logistiques d'intendance et de maintenance sont porteurs de belles opportunités en matière de services de proximité et de partenariats avec le secteur associatif.
Le secteur associatif genevois est plutôt hétérogène et fragmenté. Les pouvoirs publics ont récemment entrepris la fédération des compétences et des ressources afin de permettre une meilleure cohérence et efficience de l'action sociale privée et publique. Ce mouvement reste lacunaire en comparaison internationale. Vu la disponibilité restreinte des deniers publics, le secteur associatif recourt de plus en plus aux collectes et aux souscriptions publiques. La récolte de fonds devient un volet essentiel de l'activité associative. Vis-à-vis du secteur privé, les associations agissent le plus souvent de façon non coordonnée. Les entreprises y répondent de façon discrétionnaire selon leur objectifs et leurs disponibilités financières. Leurs lignes budgétaires en matière philanthropique diminuent et se ciblent sur des actions ponctuelles de sponsoring à forte visibilité.
Action plus continue et plus discrète, le mécénat de l'entreprise est toujours plus lié à un mandat spécifique et soumis à un compte-rendu détaillé. Le secteur associatif renâcle à souscrire à ce type de financement. A ses yeux, le mécénat par mandat assujettit l'action sociale aux volontés du bailleur et limite sa force première -- la flexibilité qui permet l'innovation dans son mandat d'intérêt public. Le mécénat par mandat est viable sous condition de compatibilité de valeurs entre le donateur et le récipiendaire. Il confère à l'association une certaine indépendance opérationnelle qui ne la dispense pas d'une obligation de transparence. Si le souci d'indépendance d'action des associations paraît légitime, ses fondements psychologiques sont anachroniques. L'attitude reflète les réflexes forgés lors d'une période antérieure caractérisée par un accès facile aux financements publics et une confortable autonomie d'action. La situation actuelle appelle à l'évolution des mentalités ainsi qu'à l'élaboration de solutions novatrices. L'une d'elle consiste à constituer des réseaux de parrainage qui multiplient les petits bailleurs et préservent leur marge de manoeuvre. Des partenariats plus étroits avec le secteur privé sont une autre option possible.
L'interaction du secteur associatif et du secteur privé genevois est très peu coordonnée, situation que beaucoup d'acteurs déplorent. Ni les associations ni les entreprises ne disposent de beaucoup de ressources pour trouver le ou les partenaires appropriés. La nécessité d'interfaces et de plates-formes de coordination se fait sentir. Les activités de la fondation Philias répondent à ce double objectif. Le Conseil économique et social (CES) est également pressenti pour faciliter la mise en oeuvre locale de l'Agenda 21. A cet égard, il est frappant de constater combien tant les milieux associatifs que le secteur privé privilégient encore l'Alleingang. Méconnaissance des organes d'intermédiation, impératif de discrétion voire souci d'économie sont les motifs les plus souvent avancés dans les entreprises. De telles réticences paraissent tout à fait surmontables à terme, car la coordination assurée par une interface augmente la crédibilité de l'action associative et l'efficience de l'engagement social de l'entreprise.
La méconnaissance mutuelle de la Genève internationale et locale est patente 1172 . La population genevoise voire même l'administration cantonale connaissent très imparfaitement les activités des organisations internationales. Les fonctionnaires internationaux sont connus pour leur faible implication dans la vie de la cité. L'entreprise transnationale relie la Genève locale et internationale par ses relations d'affaires et par la composition cosmopolite de sa main-d'oeuvre. Elle travaille ainsi de facto à la cohésion sociale locale, mais n'exploite pas activement le potentiel cohésif de ses activités et de ses ressources. Le collaborateur étranger d'une entreprise transnationale est souvent peu au fait des réalités sociales et des projets politiques locaux. Son implication active dans des projets communautaires paraît particulièrement judicieuse. Elle développerait ses compétences relationnelles et humaines tout comme elle contribuerait à la cohésion sociale et à l'enrichissement interculturel. Il donnerait à l'engagement citoyen de la grande entreprise une publicité discrète conformes aux pratiques d'affaires et aux mentalités locales.
Genève connaît des manifestations probantes de la citoyenneté de la grande entreprise. Les potentialités sont en l'espèce plus grandes encore. La région genevoise connaît une forte concentration d'entreprises de toutes tailles. Elle abrite de nombreuses organisations actives dans les domaines économique, environnemental ou social. Genève dispose d'une exceptionnelle concentration de compétences et de ressources en matière de responsabilité sociale de l'entreprise. Manquent encore l'information, la volonté d'engagement et la coordination des acteurs. La démarche suppose un intense travail de fond de communication et d'apprentissage mutuel. Les connections et les plates-formes de dialogue entre les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile manquent d'effectivité ou sont insuffisamment développées. Sans information ni conscientisation des acteurs sur les réalisations et les besoins locaux, la citoyenneté de l'entreprise ne peut réellement se concrétiser.
L'entreprise transnationale a un rôle d'avant-garde à jouer en l'espèce. Par manque d'intérêt ou par souci d'économie, celle-ci dispose très rarement d'un préposé aux relations communautaires ou d'un spécialiste des questions sociales et environnementales. La fonction est souvent assumée par le département des ressources humaines aux côtés de la gestion du personnel. L'argument du surcoût qu'impliquerait un tel poste paraît étriqué si l'on songe que celui-ci existe au sein de PME. Cette fonction est pourtant vitale pour prendre le pouls du public local, informer le public et ajuster finement les initiatives sociales de l'entreprise. La fonction permet d'effectuer un essentiel travail de conscientisation parmi les collaborateurs. La simple philanthropie ne suffit plus à assurer l'ancrage social de l'entreprise. L'évolution des attentes sociales suggère son implication plus active dans la vie locale. Le collaborateur représente pour l'entreprise son meilleur ambassadeur.
L'orientation marquée de l'économie genevoise vers les activités de services suggère la valorisation et le développement du capital humain local. Le savoir-faire est l'atout économique de demain. La segmentation de la population genevoise appelle à l'augmentation du capital social. L'activité économique ne prospère que si elle s'imbrique dans un faisceau dense de relations sociales. L'élévation du niveau de vie va de pair avec le maintien de la cohésion sociale et assure ainsi le développement durable de la communauté locale. L'affermissement de l'engagement social de l'entreprise appelle à de divers types de solutions concertées, ce que synthétise l'encadré en page suivante.
 Encadré 9 : La citoyenneté locale de l'entreprise transnationale en région genevoise
Encadré 9 : La citoyenneté locale de l'entreprise transnationale en région genevoise
Les modalités d'engagement citoyen en région genevoise concernent tant l'habitat que l'emploi, le soutien à l'entrepreneuriat, la R&D, l'action sociale et la santé. Dans tout cela, une nouvelle complémentarité entre l'entreprises transnationale et les PME doit s'affirmer, car cet élément est crucial dans la vitalité du tissu socio-économique local. On en déduit l'important rôle joué en l'occurrence par les chambres de commerce ou autres clubs d'affaires. Ces plates-formes de rencontre des cadres économiques sont une aire propice à l'échange et à la promotion d'expériences, tout comme elles constituent un tremplin d'insertion sociale pour les entreprises. A Genève, l'interface du secteur privé avec les pouvoirs publics est déjà bien étoffée ; celle avec la société civile reste très perfectible. Voilà pourtant une modalité essentielle de la citoyenneté de l'entreprise, apte à nourrir le capital social local.
* * *
Au bilan, la forte dotation traditionnelle en capital social constitue un trait d'union entre l'économie suisse et japonaise. L'histoire moderne du capitalisme japonais démontre que la dotation et la valorisation économique du capital humain et social d'une société sont susceptibles d'évoluer avec le temps. La formidable capacité d'apprentissage qui a fait le lit du rattrapage économique japonais durant le second XXe siècle démontre ses limites dans un environnement économique qui requiert souplesse d'adaptation et créativité. Société de confiance, le Japon a socialisé à l'extrême la gestion du risque opérationnel au détriment de mécanismes institutionnels et formels. Il tente de corriger cet état de fait. A l'inverse, le capitalisme américain magnifie à l'excès la rationalité de l'organisation économique ainsi que l'approche contractualiste et institutionnelle de la gestion du risque économique. La citoyenneté de l'entreprise remédie partiellement au déficit générique de compétences individuelles et de cohésion sociale qui en résulte. En cela, les moutures japonaise et américaine convergent plutôt vers un moyen terme sur lequel se situerait le modèle helvétique. Celui-ci doit également travailler à son évolution pour répondre aux exigences économiques et sociales évolutives.
Dans la manifestation de sa citoyenneté locale, l'entreprise transnationale intègre la variable culturelle de diverses manières. Elle sous-tend les valeurs individuelles de ses collaborateurs, sa culture interne ainsi que les attentes sociales locales envers l'entreprise. La culture d'entreprise comporte une part de spécificité qui ne reflète pas forcément l'intégralité des valeurs sociales de son environnement. Au pays champion de la cause démocratique, certaines entreprises américaines ont une culture très hiérarchisée et peu ouverte. L'entreprise s'adapte autant que possible aux valeurs sociales de son milieu opérationnel local. Ainsi se relativise l'importance de l'origine nationale de l'entreprise transnationale. La firme américaine démontre plutôt chichement son engagement social à l'étranger, notamment dans les pays en développement 1173 . A l'identique, la société multinationale japonaise ne duplique guère dans les marchés émergents ses initiatives sociales lancées sur le marché américain. L'entreprise européenne est plus constante en l'espèce 1174 . Ces différences paraissent tenir d'une sorte de pondération entre les attentes sociales exprimées dans le pays d'origine de l'entreprise transnationale et celles de son contexte opérationnel à l'étranger. Elles s'expliquent également par l'aptitude générique de sa culture d'origine à affronter un contexte culturel différent. Forte de sa longue expérience du multiculturalisme forgée sur le vieux Continent et en raison du degré plus élevé d'internationalisation de ses activités 1175 , l'entreprise transnationale européenne paraît mieux armée pour se faire citoyenne du monde.
En dernière analyse, la variable culturelle ne saurait suggérer une explication monocausale dans la forme et la qualité de l'engagement citoyen de l'entreprise transnationale. Le degré de visibilité publique de son secteur d'activité ou sa volonté de redorer son image publique ternie par un facteur conjoncturel défavorable constituent des déterminants non négligeables en l'espèce. Par ailleurs, l'importance de l'origine culturelle de l'entreprise transnationale tend à se réduire du fait du caractère toujours plus international et multiculturel de sa main-d'oeuvre. Cette hétérogénéité sociale accroît dès lors l'importance de la culture d'entreprise. Elle devient un périlleux exercice d'équilibre entre l'intégration et la préservation des diversités culturelles au sein de l'entreprise. Le défi est identique en matière d'insertion sociale de l'entreprise : définir un engagement citoyen qui, sur un noyau dur de principes universels, respecte les sensibilités locales.
Conclusion. La citoyenneté globale et locale de l'entreprise transnationale
La dissertation aborde certains aspects de la citoyenneté globale et locale de l'entreprise. Si elle n'épuise pas la richesse de la thématique, elle en esquisse les contours et les enjeux principaux. Quant aux mises en oeuvre concrètes de la citoyenneté de l'entreprise, elles sont qualitativement trop diverses pour permettre toute généralisation péremptoire. La dissertation conclut ainsi par une série de réflexions nuancées et prudentes quant à la qualité et à la pertinence de cette forme de responsabilité sociale de l'entreprise. Elle reprend et approfondit certaines conclusions intermédiaires dégagées en cours d'exposition. La thématique de citoyenneté de l'entreprise est examinée ci-après sous cinq facettes : (i) dans le contexte d'une crise sociale et des idées ; (ii) face à l'histoire ; (iii) dans ses équivoques et ses limites ; (iv) dans le contexte de gouvernance globale ; (v) enfin en tant qu'acte de leadership culturel, moral et intellectuel.
La crise sociale et idéologique
La mondialisation contemporaine occasionne à la fois une crise sociale et idéologique. Elle accroît considérablement les inégalités sociales sur le double plan international et national. La contestation sociale et idéologique du système d'économie de marché n'émane désormais plus tant de son grand contradicteur socialiste que des nombreux exclus et des marginalisés de la mondialisation. Elle intervient au sein des sociétés occidentales, et non plus des pays en développement comme durant les années septante. Important vecteur de la mondialisation, l'entreprise transnationale est la cible de critiques acerbes accompagnées d'un intense activisme politique. Sur le plan politique, on s'affaire à renouer un cycle vertueux entre le développement économique et social, entre la création et la distribution des richesse. A l'évidence, le néolibéralisme qui sous-tend la mondialisation contemporaine ne délivre pas ses promesses en matière sociale. Si les outils keynésiens de relance macro-économique ont stimulé la croissance des économies nationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils démontrent leurs limites face à l'intégration des marchés mondiaux. Du reste, l'Etat-providence, pendant social des politiques keynésiennes, n'assure plus l'intégration et la cohésion sociales par une certaine redistribution des richesses produites. D'où le double constat de crise sociale et de crise des idées.
Dans ce contexte, l'oeuvre de l'économiste Joseph Schumpeter offre de précieuses clés de lecture par ses analyses pénétrantes de l'histoire capitaliste. L'entreprise est un vecteur de choix de l'évolution sociale. Destructrice et créatrice tout à la fois, son activité déstabilise foncièrement son environnement social. Ce travail de sape et de reconstruction procède par phases d'accélération, ponctuées de crises de croissance. La dynamique capitaliste paraît suivre une logique cyclique alimentée par le progrès technique. Une vague d'innovation initie le cycle de croissance, sa maturation l'essouffle. Le cycle se clôt en une récession, voire une dépression. Après la crise de croissance des années septante, l'émergence de la nouvelle économie inaugurerait un nouveau cycle économique.
L'analyse schumpétérienne formule plusieurs enseignements. Premièrement, l'activité innovante de l'entreprise est cruciale dans la dynamique capitaliste. Si le progrès technique anime l'évolution sociale, il ne constitue pas une donnée exogène qui serait intégrée sans heurt notable dans la vie économique, comme le prétend l'économie néoclassique. L'innovation est le produit de la créativité, de l'activité et des interactions humaines. Elle représente donc un phénomène social, endogène au développement des sociétés. Son irruption déstabilise profondément la vie sociale. Deuxièmement, la destruction créatrice impliquée par le progrès technique comporte inévitablement un certain coût social d'adaptation structurelle. Il est ainsi abusif de vilipender systématiquement l'activité de l'entreprise dont l'activité fonde le développement sociétal. Pour l'entreprise comme pour les pouvoirs publics, le défi politique est double. D'une part, pondérer les dimensions destructrice et créatrice de l'activité économique afin de maximiser la création nette de richesse. D'autre part, concilier la création et la distribution de richesse pour permettre un véritable développement économique et social. A l'examen, les deux objectifs sont davantage complémentaires que contradictoires, s'inscrivant tous deux dans une perspective de développement durable. Il n'est pourtant point de formule magique en l'espèce, car chaque société définit tacitement avec ses acteurs économiques les seuils de l'optimal, de l'acceptable et de l'intolérable.
Troisièmement, les phases longues de récession et de dépression sont inhérentes à l'évolution économique. La croissance est renouée moins par la libéralisation de la vie économique ou par la relance keynésienne que par la stimulation de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Quant aux politiques sociales, elles doivent protéger durant les périodes récessives les groupes sociaux les plus vulnérables, afin qu'ils participent à l'essor futur du nouveau cycle d'affaires. A l'évidence, les politiques économiques et sociales néolibérales des années quatre-vingts n'ont pas suivi de tels préceptes. L'enjeu politique contemporain réside dans l'intégration des groupes sociaux et des pays marginalisés par la mondialisation. L'éducation et la formation deviennent des aspects cruciaux de l'intégration sociale dans les sociétés de la connaissance qui s'élaborent.
Quatrièmement, si la tendance historique à la réduction progressive de la durée de vie des cycles d'affaires se confirme à l'avenir, elle implique l'instabilité systémique croissante de l'économie mondialisée. L'hypothèse de l'accélération de l'alternance de phases d'expansion et de récession crédibilise une politique de développement qui renoncerait à exploiter une vague de progrès technologique pour mieux préparer la suivante. L'instabilité systémique croissante de la vie économique, si elle se confirme, pose également avec insistance la nécessité d'un encadrement institutionnel et régulatoire adéquat de la vie économique, apte à tempérer les excès de la concurrence. Le défi politique est en l'occurrence de deux ordres. Il souligne d'abord l'indispensable coordination des politiques gouvernementales à un niveau inter- ou même supranational. Il appelle ensuite plus largement à une solution de gouvernance globale qui implique des acteurs privés, tels les milieux d'affaires et la société civile internationalisée. Les deux défis sont autant de versants d'une même problématique : l'arbitrage des deux principes ordonnateurs de l'économie de marché, l'organisation et la concurrence 1176 .
L'interaction dialectique des principes de concurrence et d'organisation tout au long de l'histoire capitaliste influence de façon déterminante l'évolution de la responsabilité sociale de l'entreprise. D'une part, la concurrence, la compétition ou la confrontation insufflent au capitalisme sa dynamique innovatrice et la chargent de conflictualité. Le droit du travail, le dialogue syndical, le paternalisme industriel ou les initiatives philanthropiques de l'entreprise se développent le plus souvent sur des prémices de crise. La dynamique capitaliste compte alors sur sa souplesse d'adaptation remarquable et sur sa formidable faculté de résilience -- soit sa capacité institutionnelle à endogénéiser la critique sociale pour mieux la réduire 1177 . D'autre part, l'organisation, la coopération ou l'harmonie veillent à la cohésion sociale par une certaine redistribution sociale des richesses produites. La puissance publique institutionnalise à grand peine le rapport entre le patronat et le salariat afin de réduire son animosité. L'identification d'intérêts communs -- santé et sécurité au travail, conditions d'embauche, de promotion et de débauche -- permet la formulation démocratique de dispositions contraignantes. Ce corpus de droits et de devoirs socialement sanctionnés fonde le fragile consensus qui anime le rapport salarial 1178 . Dans l'histoire capitaliste, la confrontation paraît l'emporter sur l'harmonie et se résoudre souvent en une coopération pragmatique. L'encadrement institutionnel et régulatoire de la vie économique tempère les excès de la concurrence. L'entreprise peut ainsi mieux démontrer sa responsabilité et sa légitimité sociales.
La citoyenneté de l'entreprise contemporaine face à l'histoire
La pensée schumpétérienne s'avère également utile à l'analyse historique de la responsabilité sociale de l'entreprise. L'accélération du progrès technique des phases de croissance découvre de nouveaux modes productifs, réinvente le travail et la relation salariale, cisaille le tissu social, accroît les inégalités socio-économiques. Le secteur privé affronte alors un vent de contestation sociale. En déficit de légitimité, il imagine alors de nouveaux modes d'ancrage social qui réduisent les inégalités sociales et par suite son risque opérationnel. Les innovations ainsi produites sont d'ordre organisationnel ou social, non technique. Ainsi le patronage, puis les paternalismes du second XIXe siècle répondent indirectement à la première industrialisation de la fin du XVIIIe siècle, et directement à une deuxième vague de progrès technique intervenue vers 1845. La seconde industrialisation de la fin du XIXe siècle donne lieu à la formulation de l'ambitieux projet sociétal fordiste qui tourne court dans les années vingt. Le compromis salarial fordiste accompagne cependant l'évolution sociale du quatrième cycle d'affaires de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années septante. Enfin, le cinquième cycle, basé sur les NTIC, l'informatique et les biotechnologies, voit l'affirmation citoyenne de l'entreprise.
Lorsqu'elle est davantage d'une opération de relations publique, la citoyenneté de l'entreprise réinvente le paternalisme industriel 1179 . Les deux formes de responsabilité sociale considèrent à leur manière la communauté locale comme l'extension de l'aire de travail, mais l'appréhendent de façon singulière. Le paternalisme est socialement plus exclusif, car il porte essentiellement sur la main-d'oeuvre et sa famille. La citoyenneté de l'entreprise vise la communauté locale dans son ensemble. Le collaborateur est son ambassadeur philanthrope dans la variété de ses compétences et de ses réseaux sociaux. La citoyenneté de l'entreprise transcende du reste le niveau local pour s'adresser à l'ensemble de ses partenaires.
L'empreinte du paternalisme sur son public cible est plus autoritaire, plus entière et plus concrète que la citoyenneté de l'entreprise. Elle régit dans un rapport de domination presque tous les temps sociaux du travailleur, jusque de sa naissance à sa mort et dans ses aspects les plus intimes. Elle satisfait l'essentiel de ses besoins matériels et psychiques, procurant parfois même jusqu'à son lieu de villégiature et sa dernière demeure. La citoyenneté de l'entreprise suppose d'abord un dialogue interne qui relativise la hiérarchie. Elle incite, motive et séduit plus qu'elle ne domine ou n'oblige. Son contrôle de la main-d'oeuvre intervient grâce à la symbolique des valeurs qui charpentent la culture d'entreprise, non par le contremaître ou le chronomètre. Elle fait bonne place au sentiment et à l'émotion aux côtés de la rationalité. Enfin le projet paternaliste privilégie l'éducation morale par rapport à l'acquisition de connaissances de base et de compétences professionnelles. La citoyenneté de l'entreprise vise au développement des connaissances et des compétences génériques de l'individu. Elle oeuvre à son employabilité, soit sa faculté à développer les opportunités d'accroître ses compétences.
La filiation de la citoyenneté de l'entreprise avec le paternalisme industriel est indirecte et implicite, car le XXe siècle consacre en Occident la forte volonté émancipatrice de l'individu vis-à-vis des institutions et des grands référentiels moraux et religieux. L'esprit contemporain assimile le paternalisme à une mise sous l'étouffoir, une castration de l'idéal de réalisation personnelle qui habiterait tout individu moderne. Cependant, la dimension moralisatrice n'est pas absente du projet citoyen de l'entreprise. Les sociétés occidentales contemporaines se caractérisent par la multiplicité de leurs cadres normatifs. Les libertés de pensée, de croyance et d'association, ainsi que la diversité des modes de vie complexifient le choix pour l'individu d'un cadre normatif qui canalise ses idées et ses actions. Simultanément, on assiste aux Etats-Unis surtout à l'essor de courants hygiénistes et moralisateurs de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, le racisme ou le sexisme qui pressent les pouvoirs publics à renforcer la réglementation comportementale du citoyen 1180 . Face à ce mélange d'individualisme et de paternalisme physique et moral, l'entreprise affirme sa nature institutionnelle et son implication dans la vie publique. Elle définit strictement dans son enceinte les comportements de sa main-d'oeuvre et participe à l'amélioration qualitative de son milieu social à travers la lutte contre l'insécurité, la maladie et l'ignorance.
L'affirmation citoyenne de l'entreprise contemporaine comporte des traits plus spécifiques dans sa conjonction avec l'émergence de la nouvelle économie. Celle-ci dématérialise l'activité productive, et exerce de ce fait une pression négative limitée sur l'environnement naturel. Par contre, la compression du temps et de l'espace complexifie l'identification des partenaires de l'entreprise. Elle augmente le nombre et l'hétérogénéité des investisseurs, de la clientèle et des sous-traitants. Le partenaire est moins impliqué dans le devenir de l'entreprise vu le très faible coût d'opportunité de la modification de son choix. En matière de responsabilité sociale, l'information ventilée par une société sur l'Internet est encore très souvent basique et lacunaire, reflétant imparfaitement sa réalité économique et sociale. Ainsi donc, l'Internet devait favoriser l'émergence de fiches signalétiques en matière de responsabilité sociale de l'entreprise et orientent le choix d'un partenaire d'affaires ou d'un produit. L'Internet accélérera vraisemblablement l'élaboration de normes et de certifications universelles en matière environnementale et surtout sociale.
Si les diverses modalités historiques de la responsabilité sociale de l'entreprise répondent chacune aux défis de leur temps, elles énoncent également quelques constantes. Elles sont moins l'expression d'un idéal philanthropique qu'une stratégie défensive du secteur privé aux prises avec une sévère contestation sociale. L'entreprise innove alors dans l'organisation sociotechnique du travail tout comme dans ses modalités d'insertion sociale. Elle tente d'adoucir les mutations sociales engendrées par son activité productive. En somme, les crises sociales agissent comme catalyseur, mais pas comme déterminant unique de la redéfinition de la contribution de l'entreprise au progrès économique et social. L'entreprise comprend alors son intérêt intrinsèque à contribuer activement au développement économique et social. Un mot de Winston Churchill l'exprime : ce qui apparaît aujourd'hui comme social et périphérique à la réussite économique pourrait bien demain se révéler essentiel à sa perpétuation 1181 . L'entreprise joue sa légitimité, voire sa survie. Elle peut alors à la fois contrer sa critique sociale et stimuler l'élaboration de solutions institutionnelles appropriées.
Aux prises avec une concurrence aiguisée, l'entreprise transnationale contemporaine est tentée, comme l'industriel du premier XIXe siècle et comme le baron voleur américain de la fin du même siècle, par une définition minimaliste de sa responsabilité sociale. Le fait est paradoxal, car il intervient au moment où cet acteur croît en taille, en ressources, en marge de manoeuvre et en impact social. D'où la crise de légitimité sociale de la grande entreprise contemporaine. Un tel déficit de légitimité est à relativiser et à contextualiser. Le consensus social au sujet de l'entreprise paraît toujours plus difficile à établir. Si la relation salariale est tant bien que mal institutionnalisée et pacifiée, il en va autrement pour l'interaction de l'entreprise avec son environnement social. Depuis deux siècles, l'entreprise a gagné en centralité, en capacité d'influence et en visibilité sociales. Institution, l'entreprise interagit avec de nombreux groupes sociaux. Elle reflète à présent une constellation plus complexe d'intérêts, d'identités et de réseaux sociaux. Les attentes souvent contradictoires de ces groupes témoignent de l'hétérogénéité, voire de l'incohérence des sociétés en rapide mutation. L'entreprise est tiraillée entre l'efficacité économique et la justice sociale. Comme toute institution, l'entreprise rend compte des tensions sociales qui la traversent et qui l'entourent.
Toute crise est porteuse de risques et d'opportunités. Les sociétés contemporaines sont éminemment complexes dans leurs structures, interreliées et dynamiques par des flux de matière, d'énergie et d'information. Elles connaissent un « état de chaos potentiellement créatif 1182 . » Dans une crise économique, l'entreprise répond généralement par l'augmentation de la productivité du travail par l'innovation technique ou par le renforcement de la discipline et de la motivation 1183 . Elle peut également presser le politique pour la dérégulation de la vie économique ou encore influencer la structure de marché par des manoeuvres monopolistiques. De telles réponses renvoient à la fonction productive traditionnelle de l'entreprise moderne, la production efficace de biens et services. La crise contemporaine qu'affronte l'entreprise est autre, plus fondamentale. On ne se satisfait pas d'efficacité productive pour questionner son efficience : à quel coût écologique, économique, et social est obtenue la productivité accrue du travail ? La crise contemporaine souligne le pouvoir de structuration sociale de l'entreprise pour questionner la transparence et l'équité de ses pratiques, ainsi que sa contribution au développement durable des sociétés.
Equivoques citoyennes
Toute pratique comporte de possibles dévoiements et la citoyenneté de l'entreprise n'échappe pas à cette règle. Le premier clair-obscur est conceptuel : pourquoi l'entreprise n'affirmerait-elle pas explicitement sa responsabilité sociale ? Cette notion, on l'a vu, paraît plus adéquate sur un double plan conceptuel et pratique. Elle exprime plus franchement une prise de liberté capacité dans un contexte d'interdépendances sociales. Elle accentue les fonctions productives de base de l'entreprise, respecte la prééminence du politique dans la régulation sociale et accepte mieux l'idée de transparence opérationnelle. Outre cette ambiguïté conceptuelle, la citoyenneté de l'entreprise comporte des objectifs opérationnels latents. Elle serait, (a) une stratégie de légitimation sociale; (c) une idéologie managériale; et (c) une instrumentalisation de son milieu.
(a) La citoyenneté de l'entreprise en tant que stratégie de légitimation sociale
L'entreprise oscille constamment entre deux stratégies de légitimation. D'une part, embrasser pleinement la logique compétitive des marchés et justifier les mutations sociales induites au nom du progrès économique ou de la nécessaire évolution des sociétés. Ainsi la vision contemporaine d'une mondialisation économique en tant que phénomène inéluctable, irréversible et univoque. D'autre part, adoucir -- réellement ou symboliquement -- ces mêmes mutations sociales en puisant dans les identités collectives forgées depuis les temps préindustriels. Le patronage du second XIXe siècle, voire le paternalisme industriel des années 1870-1930 procèdent de cette logique par la reproduction idéalisée de la relation d'ouvrage de l'ordre corporatif. L'industriel a charge d'âme et de corps vis-à-vis de l'ouvrier. L'entreprise démontre une forte emprise économique, sociale et politique sur son environnement local.
Par son engagement local, la citoyenneté de l'entreprise contemporaine se réfère implicitement au patronage et au paternalisme industriel, en se posant comme une source de régénération du lien et du progrès social. La référence citoyenne est d'ordre métaphorique ; elle résulte d'un long cheminement et d'un patient travail symbolique. Dans son histoire, l'entreprise emprunte à des institutions sociales leur organisation, leur symbolique sociale et même les valeurs qui les sous-tendent. La cité-usine du XIXe siècle tire de la caserne et du couvent leurs dessins organisationnels ainsi que leurs méthodes d'encadrement des hommes. Elle en extrait encore les notions d'ordre, de discipline et de moralité. L'emprunt outrepasse l'inspiration ou la duplication. Dans sa maturation historique, l'entreprise attire à elle et refaçonne des pans entiers de la vie sociale. Elle conquiert ainsi sa spécificité, son autonomie et sa légitimité institutionnelle 1184 . Par l'affirmation de sa citoyenneté, l'entreprise contemporaine s'appuie sur un référentiel symbolique plus universel, plus politique et laïque que la caserne ou le couvent, moins castrateur aussi. La citoyenneté véhicule une charge morale positive d'épanouissement individuel et de source du lien social. Elle ancre symboliquement la grande entreprise aux valeurs fondamentales de la modernité.
Le discours citoyen confère à l'entreprise transnationale un statut d'acteur social responsable, même s'il évite plutôt toute référence explicite à cette notion. Il légitime et adoucit symboliquement les mutations sociales engendrées par son activité. Ce discours souligne l'état éminemment transitif des sociétés contemporaines. Il formule une idéologie du renouvellement perpétuel qui fonde le changement dans la tradition. L'affirmation citoyenne de l'entreprise s'inscrit en faux contre les critiques d'une mondialisation économique menée sans vision ni état d'âme. Elle tente de donner du sens aux valeurs cosmopolites qu'elle convoie en les ancrant dans la tradition et l'idéal communautaire. Ce discours de légitimation n'est pas nouveau en essence. Il est crédible à la condition qu'il se traduise en actes. A cet égard, la vie économique démontre d'une part que l'engagement citoyen de l'entreprise transnationale n'est pas à la hauteur de ses affirmations, d'autre part que sa volonté de transparence publique en la matière est fortement limitée. La citoyenneté de l'entreprise glisse alors vers une opération de marketing institutionnel destinée à rehausser chichement sa réputation 1185 .
Le grand public est abreuvé d'une information toujours plus événementielle et émotionnelle qui privilégie l'image. Celle de l'entreprise devient une ressource stratégique primordiale. La réputation de l'acteur économique permet de remédier à l'information imparfaite disponible sur les marchés et permet la démarcation concurrentielle. Certaines entreprises bâtissent se façonnent une réputation vertueuse de production qualitative, d'intégrité opérationnelle et de philanthropie. Mais quelques d'initiatives philanthropiques fortement médiatisées ne sauraient à elles seules rendre compte de la responsabilité sociale de l'entreprise. Ainsi l'engagement citoyen d'une entreprise produisant par exemple des mines antipersonnel ne saurait occulter la finalité de son activité productive. La citoyenneté de l'entreprise s'adresse avant tout à ses collaborateurs. Rappelons ici la sévère critique émise par Manthoux à l'encontre des industriels anglais du XVIIIe siècle : « La philanthropie était à la mode. Mais pour beaucoup de manufacturiers, elle s'arrêtait aux portes de la fabrique 1186 . »
(b) La citoyenneté de l'entreprise en tant qu'idéologie managériale
La contribution à l'emploi et le respect de la main-d'oeuvre représentent les manifestations premières de la responsabilité sociale de l'entreprise. Les restructurations incessantes des organigrammes fragilisent indéniablement la culture d'entreprise et altèrent le climat de travail. A ce titre, l'affirmation citoyenne de l'entreprise articule une nouvelle idéologie managériale destinée à motiver sa main-d'oeuvre 1187 . Elle tente de créer en son sein une communauté d'intérêt autour de ses objectifs économiques et d'en faire acte publiquement.
La stratégie gagne en pertinence dans le contexte de la nouvelle économie. Orientée vers les actifs immatériels, la nouvelle économie a pour matières premières l'idée, la connaissance et la compétence. Elle réhabilite en principe l'humain dans ses capacités créatrices et ses talents. La réalité est plus ambiguë. La politique de ressources humaines prend en l'occurrence un tour plutôt opportuniste et élitiste. Elle cherche moins à former l'ensemble de ses collaborateurs qu'à drainer et à fidéliser les individus les plus performants. Les initiatives sociales sont paradoxalement entretenues par la pression compétitive des débouchés commerciaux et par les goulets d'étranglement du marché du travail. Cette main-d'oeuvre est primordiale au maintien de la capacité innovatrice de l'entreprise qui n'hésite pas à la rémunérer grassement contre l'assurance contractuelle de sa fidélité. La rotation élevée de ces collaborateurs haut de gamme reflète moins leur insatisfaction foncière vis-à-vis des conditions de travail que leur désir de changement et leur gourmandise financière face aux diverses opportunités de travail. Vis-à-vis du reste de sa main-d'oeuvre, la nouvelle économie exerce une pression accrue en termes de productivité et d'insécurité professionnelle. Par l'introduction de systèmes de rémunération souple, elle accroît le différentiel salarial entre le cadre supérieur et le reste de la main-d'oeuvre, tout comme la pression à la compétitivité. Dans ce contexte, l'action syndicale peine à faire entendre sa voix, érodée qu'elle est par la mondialisation et la tertiairisation économiques, ainsi que par l'individualisation des carrières.
Le respect du collaborateur peut-il aller jusqu'à une vision démocratique de l'entreprise ? L'association du travailleur à la propriété du capital social de l'entreprise est ancienne, puisque Jean Godin l'expérimente par exemple dans son familistère lors du second XIXe siècle. Le principe se répand aujourd'hui au profit des cadres supérieurs. L'idée d'une démocratie industrielle possédée et gérée par les travailleurs n'est pas à dénigrer, mais sa généralisation paraît utopique. Dans le contexte économique actuel, l'entreprise doit compter plus que jamais sur un apport externe de capitaux, ainsi que sur un fort leadership décisionnel. En revanche, la démocratie économique au sein de l'entreprise est mieux envisageable et réalisée par le biais de l'aplatissement des hiérarchies, de la décentralisation des responsabilités et de la transparence décisionnelle, sans omettre la gestion dynamique des savoirs et des compétences 1188 .
Toute entreprise est légalement tenue de rendre compte de ses activités à son actionnariat et user de façon responsable des avoirs de celui-ci. Pour son succès économique et sa légitimité sociale, toute entreprise devrait assurer au collaborateur, outre une rémunération convenable, des opportunités de développement de ses connaissances et de ses compétences, des modalités d'expression et des canaux effectifs de communication avec la direction. Sans promouvoir l'idée d'une démocratie industrielle ou d'une entreprise «démocratique», l'entreprise reflète dans son organisation et sa gestion certaines valeurs démocratiques fondamentales telles la liberté et la dignité de l'individu, le pluralisme, la justice et la règle de droit 1189 . En bref, l'idéologie managériale formulée par la citoyenneté de l'entreprise est creuse si elle s'accompagne d'une pression accrue sur les collaborateurs et si elle cherche à pallier symboliquement le creusement des inégalités de traitement parmi ceux-ci.
(c) La citoyenneté de l'entreprise en tant qu'instrumentalisation de son milieu
Une clé essentielle du succès entrepreneurial consiste à tirer parti des interdépendances sociales. Par la reconnaissance et la valorisation des liens avec son milieu social, l'entreprise optimise son accès aux ressources matérielles, financières et humaines. Elle stimule la confiance sociale en ses activités et assure sa propre durabilité tout comme celle du développement économique et social qu'elle alimente. En cela, l'entrepreneuriat comporte deux fonctions. La première est strictement économique, par la création de richesse. La seconde est politique, au travers de la minimisation de l'incidence sociale négative de ses activités. L'entrepreneur incorpore les diverses attentes sociales dans sa stratégie et crée une communauté d'intérêt avec son environnement afin de minimiser son risque opérationnel. L'entrepreneuriat acquiert ainsi sa viabilité économique, son caractère politique d'acte de gouvernance et sa vocation solidaire.
Par l'expression de sa citoyenneté, l'entreprise transnationale souligne de façon ambiguë son lien avec son milieu. La mondialisation crée vis-à-vis de l'entreprise transnationale à la fois de formidables espaces géographiques d'action et de nouvelles contraintes compétitives. La concurrence aiguisée sur les marchés mondiaux l'incite à jouer plus que jamais sur l'effet de concurrence entre les sociétés hôtes, afin de bénéficier d'un environnement optimal. Cette pression compétitive relayée par l'entreprise sur son environnement social ne garantit pas le réel développement de celui-ci. Il pousse à la déréglementation sociale et renforce ce que la libéralisation des marchés induit déjà, à savoir la privatisation de l'action publique. L'entreprise n'a pas vocation de pôle de régénération sociale ou de mentor politique. Sa fonction sociale première est la production de richesse dans un mode qui respecte des considérations économiques, sociales et écologiques. La qualité de ses produits, sa contribution à l'emploi, la protection de son milieu physique représentent des critères bien plus primordiaux et effectifs de sa responsabilité sociale.
La citoyenneté de l'entreprise s'identifie à une démarche entrepreneuriale sous deux conditions. Tout d'abord, sa mise en oeuvre doit compléter l'action publique, non s'y substituer ou la prévenir. Le respect de la prééminence du politique suppose également que l'entreprise suggère et influence, mais sans s'ingérer, dans le processus démocratique. Deuxièmement, l'engagement citoyen authentique de l'entreprise suppose le dessein d'un mode productif qui profite aux divers groupes sociaux concernés par son activité. La démarche se conçoit en amont de l'activité productive pour mieux s'intégrer à celle-ci, et non pas en tant que palliatif aux disruptions sociales causées par la poursuite d'objectifs étroitement économiques. Henri Ford exprime ce principe clé de l'entrepreneuriat au début du XXe siècle déjà : « L'industrie organisée en vue de l'intérêt général fait disparaître la nécessité de la philanthropie 1190 . » La citoyenneté de l'entreprise est socialement responsable si elle n'instrumentalise pas son environnement social et si elle contribue positivement à son développement. Elle devient alors un véritable acte de gouvernance.
La citoyenneté de l'entreprise et la gouvernance sociétale
L'analyse schumpétérienne de l'histoire capitaliste relève que les transitions entre les cycles économiques accouchent d'une nouvelle formule de gouvernance sociétale, redéfinissant les fonctions les interactions des institutions. Les mutations contemporaines doivent beaucoup à l'effet couplé des sauts technologiques liés aux NTIC et de la mondialisation des marchés. L'intensification des relations inter- et transnationales qui en découle a pour protagonistes la grande entreprise et de la société civile. La période atteste aussi des limites de la capacité d'action individuelle et collective de l'Etat. L'absence d'une autorité supranationale et le manque de ressources du politique engendrent la prolifération de partenariats tissés entre les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile.
L'idée d'une gouvernance tripartite de régulation de la vie économique n'est pas neuve, du moins dans l'identification de ses composantes. Au milieu du XIXe siècle, le mouvement d'Economie sociale fondée par Le Play fonde en effet le progrès économique et social sur l'action concertée des politiques publiques, des milieux d'affaires, de la vie associative et religieuse. La problématique de gouvernance posée aujourd'hui comporte également des traits propres. Son cadre géographique est à la fois global et local. Sa résolution implique à présent un foisonnement d'acteurs sociaux, du fait notamment de la vigueur de la vie associative. La régulation de la vie économique s'entend dans le respect de normes universelles en matière économique, mais aussi de protection de l'environnement, de droits humains et sociaux. Au-delà de ce dénominateur commun, la régulation serait à géométrie variable. Les problèmes sociaux soulevés par l'activité économique comportent en effet une importante dimension interculturelle, malgré l'homogénéisation relative induite par la diffusion du modèle capitaliste anglo-saxon. Il importe dès lors de ménager des dispositions souples aptes à valoriser la diversité culturelle de la vie économique. La souplesse des arrangements régulatoires constitue un des leitmotivs de la conception contemporaine de la gouvernance.
L'engouement pour la notion de gouvernance comporte une ambiguïté majeure. Il peut s'interpréter comme la reconnaissance généralisée de la nécessaire stabilisation de l'activité économique mondialisée. Sous un angle plus critique, le phénomène est instigué par les milieux d'affaires à leur avantage. La gouvernance repose sur des mécanismes fragiles. Les arrangements souples entre les acteurs et leur autoresponsabilisation sont préférés aux normes contraignantes. L'atteinte à la réputation publique de l'acteur constitue la principale sanction, dont l'effectivité suppose sa forte transparence opérationnelle. Or, cette condition est loin d'être remplie actuellement dans la vie économique. Le monde des grandes affaires est des plus opaques pour le public. Le phénomène de la gouvernance exprime un fait -- l'amoindrissement de la capacité d'action des collectivités publiques. Elle trahit également un projet idéologique : maintenir la régulation de la vie économique mondialisée à un niveau d'effectivité minimal. Vu ainsi, les partenariats tissés entre les milieux d'affaires et les organisations intergouvernementales préviennent l'émergence de normes contraignantes.
Plusieurs indices étayent cette hypothèse. Le contexte contemporain atteste moins d'un déficit normatif que d'un manque de capacité ou de volonté politique à faire respecter les règles existantes. Diverses organisations intergouvernementales ont défini un corpus de normes économiques, sociales et environnementales à vocation universelle, dont le plus emblématique serait le Pacte global des Nations Unies proposé par Kofi Annan aux entreprises transnationales. L'instrument a pour principal mérite de stimuler le dialogue tripartite entre les gouvernements, les milieux d'affaires et certaines ONG. Les prescriptions comportementales qu'il énonce sont en revanche très peu précises 1191 ; leur respect par l'entreprise signataire n'est aucunement vérifié. La Chambre de commerce internationale (CCI) exclut explicitement que l'adhésion au Pacte implique des contraintes comportementales assorties de procédures de vérification, tout comme elle souhaite écarter des discussions y relatives tout représentant de la société civile 1192 . Aussi l'objectif fixé en l'occurrence -- l'adhésion au pacte de mille entreprises d'ici à 2002 -- est d'ordre plus quantitatif que qualitatif. Quant aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, ils représentent un instrument international plus précis dans ses stipulations. Ils énoncent de claires attentes comportementales vis-à-vis des milieux d'affaires, sans exercer toutefois de réelle contrainte à leur égard.
La récente Résolution du Parlement européen sur les normes communautaires applicables aux entreprises européennes opérant dans les pays en développement esquisse une solution de gouvernance plus contraignante 1193 . Elle appelle à l'élaboration d'un code de conduite modèle dont le respect serait obligatoire pour toute entreprise transnationale européenne. La base normative du code respecterait des normes internationales en matière de droits humains et du travail, d'environnement et de corruption. La Résolution recommande également la création d'un label social. Elle envisage enfin la fondation d'un Observatoire européen. Celui-ci assurerait des tâches de contrôle indépendant de la mise en oeuvre du code de conduite susmentionné, de dialogue entre les différents acteurs concernés ainsi que de promotion des meilleures pratiques y relatives. Cette plate-forme contrôlerait le respect de la mise en oeuvre, enregistrerait les plaintes éventuelles et assurerait la fonction d'ombudsman entre les sociétés multinationales et les ONG. La mise en oeuvre de la Résolution est encore lointaine, voire aléatoire. La Commission européenne doit encore se prononcer sur sa substance et, le cas échéant, produire une base normative adéquate. Une plate-forme provisoire placée sous l'égide du Parlement européen est envisagée à plus court terme afin de promouvoir les normes minimales internationales existantes ainsi que les meilleures pratiques d'affaires 1194 .
La valeur régulatoire des nombreux codes de conduite récemment adoptés par le secteur privé est encore plus incertaine. La crédibilité du code est fonction de la capacité du public à évaluer, voire de certifier son application concrète, capacité qui dépend à son tour de la transparence opérationnelle de l'entreprise. L'essor des labels sociaux et environnementaux crédibilise en principe l'idée d'autorégulation du secteur privé. Ce type de solution de droit privé comporte pourtant de nombreuses lacunes et faiblesses. L'indépendance de l'instance de contrôle est en particulier sujette à caution. L'audit social et environnemental devient un marché prometteur que les plus grandes sociétés d'expertise entendent bien exploiter. Celles-ci offrent en fait simultanément des services de conseil et d'audit aux entreprises, ce qui questionne l'indépendance de leurs analyses. Deux des Big Five se sont récemment séparés de leur division de conseil 1195 , mais cette fonction est susceptible de réapparaître rapidement sous une autre forme. Les entreprises conçoivent en effet le conseil et l'audit comme les deux volets d'une même démarche d'expertise externe.
En somme, les solutions de gouvernance existantes ou en cours d'élaboration relatives à la responsabilité sociale de l'entreprise transnationale relèvent essentiellement de l'incitation, de la corégulation ou de l'autorégulation. Les éléments contraignants en sont pratiquement absents. Ces solutions informelles de gouvernance contribuent à réguler l'activité économique mondialisée, mais n'offrent en aucun cas un pouvoir régulateur équivalent à des dispositions légales contraignantes. Les pouvoirs publics conservent une fonction clé en matière d'encadrement de la vie économique 1196 . En ont-ils encore la capacité? L'Etat délègue parfois délibérément certains domaines régulatoires à la sphère privée, tel l'Internet ou les normes ISO 1197 , ce qui n'exclut pas toute régulation publique ultérieure. La régulation s'instigue parfois sur des initiatives privées, comme en matière sociale au XIXe siècle. La capacité d'action du politique dépend de son pouvoir de contrainte et de l'ampleur de ses moyens financiers. Les difficultés de trésorerie de l'ONU sont de notoriété publique. Elles ne sauraient pourtant justifier une emprise croissante des milieux d'affaires sur la définition de ses programmes d'action. L'enjeu est de taille, car on risque « la société du simulacre, en laissant la marché prendre son autonomie et proliférer dans tous les domaines tout en faisant semblant de s'agiter aux tribunes 1198 . »
Les débats relatifs à la gouvernance sociétale et l'affirmation de la citoyenneté globale et locale de l'entreprise transnationale sont d'origine anglo-saxonne, reflétant une vision culturelle de la fonction sociale de l'entreprise et de la nature de son environnement régulatoire. Les deux notions relativisent le pouvoir d'action de l'Etat au profit du big business. La forme actuelle de la mondialisation est résolument néolibérale, et ce néolibéralisme profit indubitablement aux milieux d'affaires dominés par la culture anglo-saxonne. La citoyenneté globale et locale de l'entreprise transnationale évite soigneusement le niveau national -- domaine réservé de l'Etat --, mais le concurrence implicitement dans l'exercice de sa souveraineté. Si elle est authentique, cette prise de responsabilité du secteur privé suppose un sens aiguisé du leadership, une vision à terme et une éthique opérationnelle.
Leadership, vision et éthique
Dans son ouvrage intitulé Capitalisme, socialisme et démocratie, Schumpeter estime que la dynamique capitaliste mine la connivence entre les élites politiques et économiques. La classe politique tend à se faire l'écho du mécontentement de son électorat victime des bouleversements socio-économiques. Le monde des grandes affaires paraît aujourd'hui se distancier de la vie des sociétés. Il s'adresse au politique moins pour lui faire connaître ses expériences que pour exprimer ses intérêts. Il paraît bien opaque et impénétrable pour le grand public, malgré une politique de relations publiques soigneusement peaufinée. Il définit en cercles restreints une logique fonctionnelle et décisionnelle dont la qualité, la complexité ou l'évidence l'exempteraient de tout débat public. A tout le moins, le simple énoncé de cette logique du « business is business! » suffirait à sa justification. Le discours citoyen de l'entreprise peut s'inscrire dans cette ligne de pensée. L'autorégulation qu'elle proclame dans un contexte de mondialisation n'est pas neutre d'un point de vue idéologique. Elle exprime une vision néolibérale et anglo-saxonne de la vie économique qui gagnerait à s'enrichir par sa confrontation avec d'autres conceptions culturelles et idéologiques de l'activité économique. Si la dynamique de mondialisation paraît irréversible, sa forme actuelle n'est pas inéluctable 1199 . Un véritable débat d'idées sur son avenir améliorerait son bilan social plutôt sombre.
L'économie politique néoclassique contribue à cette stérilité intellectuelle. La dissociation artificielle de l'économique et du social qu'elle soutient, ainsi que son orientation mathématique contemporaine visent à lui donner un tour plus «scientifique» 1200 . Une telle orientation appréhende surtout de façon erronée et lacunaire les passerelles entre l'économique et le social. L'économie est une science sociale; le social est davantage qu'un simple coût économique ; l'économie et le social représentent deux facettes d'une même réalité sociétale. L'enjeu ne relève pas d'un pur académisme, car la science économique néoclassique constitue les soubassements intellectuels de l'enseignement dispensé dans les écoles de management. Cette dissociation artificielle tend à conforter le manque de vision du manager.
L'accélération du rythme de l'activité économique constitue un facteur aggravant en l'occurrence. Le décideur économique vit quotidiennement la compression du temps et des distances, ainsi que la montée de la complexité. L'executive summary est un support essentiel à des décisions prises dans l'urgence. La prise de recul ou la réflexion sur des considérations non strictement économiques apparaissent comme un luxe réservé aux intellectuels. Le social est un thème secondaire, appréhendé souvent comme un palliatif aux décisions stratégiques. Ainsi la définition étriquée de la responsabilité sociale de l'entreprise en termes philanthropiques. Le manager contemporain exerce pourtant de facto un leadership sur la vie sociale. L'affirmation citoyenne de l'entreprise reconnaît et même revendique une telle gouverne politique et idéologique. Le leadership requiert une autorité, mais aussi et surtout une vision et une éthique d'action. L'appel à la libéralisation à tout crin comme stimulant de la compétitivité représente un argument de facilité, car il n'incite pas le manager à explorer de nouvelles façon de concevoir l'insertion sociale de l'entreprise. L'affirmation citoyenne de la grande entreprise contemporaine sonne dès lors comme l'expression malsaine et creuse d'un leadership culturel, moral et intellectuel. Elle n'atteste ni de la vision ni de la responsabilité sociale de ses dirigeants.
Certains milieux d'affaires ont assumé dans l'histoire capitaliste un véritable leadership intellectuel et moral dans la gestion des affaires publiques. En France, les institutions de patronage développées par certaines entreprises dès la moitié du XIXe siècle sont exposées, primées et prises en exemple lors des diverses Expositions universelles parisiennes. Lors de son apogée entre 1870 et 1920, le paternalisme industriel contribue en Occident au développement des infrastructures sanitaires et éducationnelles publiques. Il inspire directement le législateur en matière de protection sociale ou de droit du travail, et prépare l'avènement de l'Etat-providence. Au début du XXe siècle, le projet sociétal fordiste affiche des ambitions sociales plus affirmées encore. La grande entreprise devient le creuset d'une nouvelle société qui bannirait les conflits sociaux. Si elle n'affiche pas de telles ambitions, la citoyenneté de l'entreprise contemporaine exprime bien l'idée d'un leadership moral et intellectuel dans la vie sociale.
Le leadership requiert la capacité d'initier et d'organiser le changement, dans sa vie interne comme dans ses services à la collectivité. Il s'exerce dans l'élaboration de l'action, l'apprentissage et la communication qu'elle implique. Il catalyse les énergies, guide et stimule par l'exemple sans oppresser. Il est moins un trait de caractère qu'une aptitude forgée par le vécu. Chacun est potentiellement un leader, c'est-à-dire responsable de lui-même dans sa contribution à l'action collective. Un individu responsable se sent à sa place et valorisé dans ses multiples potentialités. Le leadership suppose l'incorporation du sentiment et de l'émotion à la logique rationnelle de l'activité économique afin d'atteindre la pleine valorisation des potentialités créatrices de l'humain. Dans l'activité économique, l'humain n'est pas le problème, il est partie de la solution.
La citoyenneté authentique de l'entreprise outrepasse la philanthropie. Chacune des interactions sociales de l'entreprise exprime sa responsabilité sociale. La citoyenneté de l'entreprise suppose que l'ensemble des groupes sociaux concernés par son activité bénéficient de sa présence. Elle s'effectue grâce au concours des individus qui la composent et qui l'entourent dans la diversité de leurs temps sociaux. Plus largement, la citoyenneté de l'entreprise requiert un ethos d'action qui permette d'aborder les défis sociaux contemporains avec sérénité et clairvoyance. Cette éthique sous-tend toutes les facettes de l'activité économique. Au XIXe siècle, l'industriel anglais George Cadbury l'avait déjà compris : « The question for George Cadbury was not only that the money should be spent rightly, but that it should be made rightly 1201 . »
[Précédent]
[Suivant]