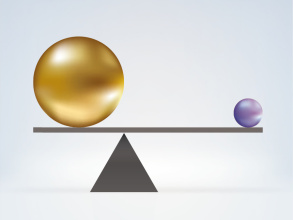3 décembre 2020 - Vincent Monnet
Que reste-t-il du «rêve américain»?
Qu’ils soient source d’émerveillement ou de rejet, les États-Unis ont profondément modelé nos modes de vie, que ce soit sur le plan politique, culturel ou économique depuis le milieu du XIXe siècle au moins. Retour sur l’histoire d’une relation plus ambivalente et plus complexe qu’il n’y paraît.

Des vastes plaines du Far West, aux gratte-ciels de la «Grande Pomme», du Coca-Cola aux blockbusters hollywoodiens, de Ford à Apple, l’American Way of Life a largement façonné le visage de la planète depuis la fin du XIXe siècle. Ce qu’on appelle communément «l’américanisation du monde» ne saurait pourtant être réduit à du pur impérialisme, les va-et-vient ayant été incessants entre le Nouveau-Monde et l’ancien. Professeur d’histoire contemporaine à la Faculté des lettres, Ludovic Tournès en fait la démonstration dans son dernier ouvrage à l’heure où semble se profiler un profond changement de paradigme. Entretien et éclairages.
Vous n’êtes de loin pas le premier à vous pencher sur la relation qu’entretiennent les États-Unis avec le reste du monde. Pourquoi ce livre aujourd’hui?
Ludovic Tournès: J’ai écrit ce livre pour deux raisons principales. La première, c’est que même si l’américanisation est effectivement un thème très rebattu dans la littérature scientifique, il n’existait jusqu’ici pas d’ouvrage de synthèse sur le sujet. On peut trouver une multitude de livres sur l’économie, la culture ou la politique américaines mais aucun n’offre une vision d’ensemble. Le deuxième point, c’est que, selon moi, l’américanisation n’a pas été envisagée de la bonne manière et dans toute sa complexité par les chercheurs qui se sont penchés sur le sujet. Mon objectif était donc d’aborder le problème sous un jour nouveau.
Lequel?
L’américanisation est souvent envisagée comme un mouvement de domination unidirectionnel qui partirait des États-Unis vers le reste du monde. Or, cette hégémonie n’est pas aussi totale qu’on le dit souvent et cette vision occulte également le fait que ce phénomène concerne d’abord les Américains eux-mêmes et la façon dont ils se perçoivent en tant que citoyens.
Pouvez-vous préciser?
Dans les faits, l’américanisation est un processus qui s’adresse en premier lieu aux personnes qui émigrent de manière massive vers le Nouveau-Monde à partir du milieu du XIXe siècle et qu’il vise à assimiler à cette société en construction. Il s’agit de trouver des éléments sur lesquels fonder un discours capable de cimenter ce jeune pays extrêmement hétérogène, comme on a pu le voir en Europe au moment de la naissance des États-nations. Mais ce qu’il y a d’unique avec les États-Unis, c’est que ce mouvement n’a pas de frontières et qu’il ambitionne de manière très précoce de faire des habitants du reste du monde des Américains potentiels ou, pour le moins, des supporters du modèle états-unien. Nous sommes là face à une nation qui ne fixe pas de frontières entre elle et le reste du monde. Une nation qui se conçoit donc d’emblée à l’échelle de la planète, que ce soit de manière physique ou symbolique. L’idée clé, c’est de faire participer au rêve américain aussi bien les gens qui viennent s’installer dans ce nouveau monde que ceux qui n’y viennent pas. La combinaison de ces deux éléments est toutefois loin d’être harmonieuse. Elle est même sans doute responsable de la violence entre les communautés qui caractérise la construction nationale états-unienne tout au long de son histoire. À chaque nouvelle vague de migrants, on assiste en effet à de nombreuses émeutes à caractère religieux ou racial qui sont dirigées tantôt contre les Juifs, tantôt contre les Italiens ou les Néerlandais. Tous les mouvements dits «nativistes» sont par ailleurs des mouvements foncièrement xénophobes, sans parler du Ku Klux Klan, qui est contre les Noirs mais aussi contre l’immigration juive.
Concrètement, comment se déclinent les deux pans de ce que vous présentez comme un même mouvement?
À partir de 1915-1920, on voit se développer sur le territoire états-unien de vastes opérations volontaristes dont l’objectif est de faciliter l’intégration (c’est-à-dire l’américanisation) des immigrants parce que l’on s’aperçoit bien vite qu’ils ne s’intégreront pas tout seuls. On leur propose donc des cours afin qu’ils apprennent l’anglais tout en essayant de leur inculquer ce que l’on considère comme les valeurs propres aux Américains. Ce qui est intéressant, c’est que ces campagnes d’américanisation sont exactement concomitantes de l’internationalisation du cinéma hollywoodien, qui, in fine, n’est rien d’autre qu’une campagne d’américanisation à l’échelle du monde.
À cet égard, le développement du western en tant que film de genre constitue, selon vous, un exemple tout à fait paradigmatique…
À la première lecture, les westerns apparaissent comme des films d’aventure qui relèvent du pur divertissement. Mais ces films portent aussi en eux une dimension éducative très importante. D’une part, parce qu’ils constituent une autre façon de familiariser les immigrants à l’histoire états-unienne en présentant de façon romancée un de ses épisodes majeurs, à savoir la conquête de l’Ouest. De l’autre, parce qu’ils permettent de présenter au public étranger une vitrine attractive du rêve américain (lire cet article).
Quels sont les fondements théoriques qui justifient l’ambition messianique des États-Unis?
L’idéologie de la «destinée manifeste», qui est élaborée vers 1840, repose sur l’idée que les États-Unis sont investis d’une mission divine leur enjoignant de s’étendre non seulement sur l’ensemble du continent américain, mais aussi – potentiellement – sur l’ensemble du monde pour y apporter la civilisation. Déjà présente chez les pèlerins puritains arrivés en Amérique sur le Mayflower, cette croyance en une élection divine permet de justifier l’expansion vers l’Ouest à une période où le territoire national s’agrandit effectivement de manière spectaculaire, puisque, en quelques années seulement, ce ne sont pas moins de 1,2 million de kilomètres carrés qui sont arrachés à la «sauvagerie». À partir de là, les États-Unis vont progressivement acquérir la certitude d’avoir créé le paradis sur Terre : un pays avec des ressources naturelles fantastiques, des étendues quasi illimitées, un modèle politique dont ils sont certains qu’il est parfait... Dès lors, participer à la construction du rêve américain, c’est participer à la construction du paradis sur Terre.
Cette croyance a-t-elle laissé des traces durables dans la culture politique américaine?
Elle a en tout cas donné un statut assez ambigu à cette démocratie que l’on pourrait considérer comme laïque mais qui, dans les faits, ne l’est pas du tout. Aux États-Unis, le président prête serment sur la Bible, chaque billet de banque est orné de la fameuse devise In God We Trust et, dans n’importe quel hôtel un tant soit peu respectable, on trouve cette même Bible dans chaque chambre. En forçant le trait, on pourrait donc parler d’une théocratie moderne davantage que d’une démocratie au sens où on l’entend dans les pays européens.
Comment s’articule cette idée de peuple élu avec le sort réservé aux populations indiennes ou noires?
Les Indiens sont très vite mis de côté dans la mesure où ils ne sont pas chrétiens et qu’ils ne sont pas non plus considérés comme des peuplades civilisées. À cela s’ajoute le fait que ce sont des nomades. À l’inverse du fermier ou du cow-boy, qui met en valeur la terre par son travail, l’Indien apparaît comme un parasite qui se sert sur le dos de la nature. Par conséquent, il n’a aucun droit sur la terre promise par Dieu. Cela étant, aux yeux des pères fondateurs, il n’est pas totalement exclu d’intégrer ces populations à la nation. Seulement, ils estiment que cela prendrait beaucoup trop de temps. Partant de là, se dessine très rapidement et de manière très explicite une double alternative : soit on les extermine, soit on les déporte le plus loin possible. Conséquence: alors qu’à la fin du XVIIIe siècle, environ un million d’Indiens étaient présents à l’ouest du Mississippi, les trois quarts auront été exterminés cent ans plus tard.
Qu’en est-il de la population afro-américaine dont les contingents deviennent rapidement très importants en nombre?
Ils sont d’entrée de jeu perçus comme impossibles à intégrer. De fait, ils ne sont donc pas concernés par les campagnes d’américanisation. Cependant, il est impossible de les éliminer dans la mesure où ils représentent une force de travail indispensable, notamment dans les États du sud. Ils resteront donc longtemps des citoyens de seconde zone auxquels le droit de vote ne sera accordé que dans les années 1960 et qui, aujourd’hui encore, comme vient de le rappeler l’actualité, restent victimes de nombreuses discriminations.
Cette conception sélective de la démocratie a-t-elle fait d’autres victimes?
Dans les années 1920, des quotas d’immigration ont en effet été mis en place pour éviter l’arrivée sur le sol américain de ceux qui, pour diverses raisons, étaient jugés non intégrables, comme les ressortissants de l’Europe de l’Est et du Sud, les Chinois ou les Japonais.
Comment dès lors expliquer le succès du fameux «melting-pot»?
Jusqu’en 1914, une partie des élites politiques et intellectuelles états-uniennes est convaincue que l’assimilation des personnes immigrées d’origine européenne se fera de façon naturelle, par fusion progressive dans la population. Ce mythe est cependant démenti par les faits à l’aube du premier conflit mondial. D’une part, parce que les immigrants sont trop nombreux, de l’autre, parce que les différences entre les «races» sont trop importantes pour se dissoudre d’elles-mêmes. Enfin, parce que la neutralité affichée par le pays au début du conflit n’empêche pas les tensions intérieures. Les diverses communautés prennent en effet fait et cause pour leur nation d’origine, ce qui fait craindre à certains responsables le risque d’une seconde guerre civile. À mon sens, on ne prête d’ailleurs pas assez d’attention au fait que l’unité nationale américaine est très fragile. Les autorités doivent donc en rajouter en permanence dans le patriotisme, la vénération de la démocratie, les appels à l’union. Autant d’éléments destinés à réassurer leurs concitoyens sur l’excellence de leur modèle. Parce qu’ils en doutent constamment.
En dépit de ces tensions sociales, les États-Unis vont sortir considérablement grandis du premier conflit mondial, notamment sur le plan économique. Est-ce à ce moment qu’ils acquièrent leur statut de superpuissance?
Les États-Unis ont les moyens de leurs ambitions dès les premières années du XXe siècle. Vers 1900, alors que le taylorisme en est encore à ses débuts, ce pays produit autant que la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne réunis. Le développement du taylorisme, puis du fordisme va permettre dans les années qui suivent de démultiplier cette capacité de production déjà considérable en fabriquant des biens en très grande quantité qui sont amortis sur le marché intérieur avant d’être exportés à moindre coût. Alors que l’Europe sombre dans la barbarie et le chaos, l’Amérique devient donc l’incarnation de la modernité, un statut qu’elle conservera jusque dans les années 1960.
De manière assez paradoxale, vous montrez que l’exportation de ce modèle économique durant l’entre-deux-guerres profitera surtout aux régimes autoritaires qui montent en puissance sur le Vieux-Continent…
D’une certaine façon, l’Allemagne nazie est effectivement le pays européen le plus américanisé qui soit à cette époque. Le IIIe Reich est allé très loin dans l’intégration de la notion de production de masse même si c’est dans une logique qui n’a strictement rien à voir avec celle des États-Unis, puisque pour Hitler, l’objectif premier est de préparer la guerre et non de favoriser une société basée sur la consommation de masse. L’URSS s’est également approprié les principes du fordisme en le dénaturant, puisque dans le cas présent, le travail à la chaîne a pour but de produire suffisamment de tracteurs pour exploiter les kolkhozes et par là même prouver au monde l’excellence du système soviétique.
Cette adaptation des techniques états-uniennes au monde industriel n’est pas une pure imitation, puisque en Europe on ne fabrique pas des pseudo-Cadillac mais des voitures comme la Topolino, la Volkswagen ou encore la 4 CV…
Il y a en effet un processus de réappropriation et d’adaptation aux besoins locaux qui contredit l’idée d’un impérialisme économique pur et dur. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l’Europe souffre d’une pénurie généralisée. Les matières premières manquent et l’essence est rationnée. Plutôt que de copier ce qui se fait aux États-Unis, les constructeurs comme Fiat, VW ou Renault misent donc sur le système D, tout en s’inspirant des méthodes de production développées aux États-Unis. La société de consommation à l’européenne écrit donc sa propre histoire, qui n’a rien à voir avec celle de son voisin d’outre-Atlantique (lire cet article).
Peut-on dire la même chose à propos d’entreprises telles que Coca-Cola ou McDonald?
Coca-Cola a conquis une large partie du monde en s’appuyant sur une stratégie qui devient systématique dès les années 1920 et qui consiste à délocaliser une partie de la production dans les pays à conquérir pour éviter les frais liés à la mise en bouteilles. Basée à Atlanta et conservant un contrôle total sur le produit et sa commercialisation, la maison mère livre uniquement le sirop, puis le concentré de la boisson aux entreprises étrangères franchisées auxquelles il revient de réaliser les investissements nécessaires à la croissance du marché local. La publicité est également adaptée au contexte de chaque pays afin de cibler des catégories précises de la population ou de masquer l’origine américaine de la boisson. Si efficace soit-elle, cette stratégie ne va cependant pas sans susciter des réticences, notamment en France où l’expression « coca-colonisation » fait fortune au moment de la mise en place du Plan Marshall. Autre symbole de l’American Way of Life, McDonald a effectivement misé sur la symbolique états-unienne pour entrer sur les marchés nationaux mais la clé de son succès repose également sur un système de franchise. En 2014, 80% des restaurants de la marque sont ainsi des entreprises locales employant du personnel local et s’approvisionnant auprès d’entreprises locales. Quant aux menus proposés, ils sont également adaptés aux goûts culinaires locaux. En Chine, la viande dominante est le poulet et non le bœuf, tandis que le bol de riz est proposé au même titre que les frites. En Israël, les hamburgers sont servis sans fromage de façon à éviter le mélange entre les produits carnés et laitiers, interdits par le principe de l’alimentation casher. En Inde, des hamburgers végétariens ont été introduits très tôt de manière à respecter les multiples interdits religieux pesant sur la consommation de viande.
Constate-t-on le même genre de stratégie d’adaptation dans le domaine de la culture où l’influence américaine est également très présente?
Hollywood est souvent présenté comme le symbole de l’impérialisme culturel américain. Cette vision n’est pas totalement dénuée de fondement mais elle ne traduit que très partiellement la réalité.
C’est-à-dire?
Si le cinéma américain connaît un tel succès dans le monde, ce n’est pas uniquement parce qu’il est formidable. Son expansion a en effet été largement soutenue par le pouvoir politique, qui a employé très tôt toute une série de méthodes, parfois extrêmement brutales, pour ouvrir de nouveaux marchés à ce secteur. Dans les années 1920, la pénétration de l’industrie du cinéma américain en Europe est ainsi grandement facilitée par différents moyens qui permettent d’écraser les marchés locaux. Les films qui sont exportés sont en effet généralement déjà amortis et peuvent donc être proposés aux diffuseurs locaux à bas prix. Ils sont également souvent vendus par lots et non à l’unité, ce qui permet d’occuper un maximum de salles et donc d’en exclure la concurrence. Après la Deuxième Guerre mondiale, l’aide des États-Unis à la France (soit 650 millions de dollars) est par ailleurs conditionnée à l’ouverture des écrans nationaux aux films américains pendant un certain nombre de semaines. Mais tout cela ne doit pas faire perdre de vue que cette machine à vendre du rêve s’est aussi largement nourrie d’influences extérieures.
Pouvez-vous en donner quelques exemples?
Au moment de leur création, tous les grands studios hollywoodiens sont aux mains d’individus qui, aux yeux des ligues de moralité de l’époque, incarnent ce qu’est la « non-américanité ». Les patrons de la Metro-Goldwyn-Mayer (Samuel Goldwyn, Louis B. Mayer et Marcus Loew) comme ceux de Paramount Pictures (Adolph Zukor et Jesse L. Lasky), de la 20th Century Fox (William Fox) ou d’Universal Pictures (Carl Laemmle) sont en effet tous originaires d’Europe de l’Est et la plupart d’entre eux ont des origines juives. De nombreux réalisateurs ayant contribué au rayonnement du cinéma dit américain sont aussi d’origine étrangère comme Friedrich Wilhelm Murnau, Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock ou, plus récemment Alejandro González Iñárritu. Enfin, il y a de très nombreux emprunts stylistiques notamment à l’expressionnisme allemand, à Cinecittà ou encore au cinéma japonais (lire cet article). Malgré certains aspects très américains, comme le Happy end, la mise en scène de l’American Way of Life ou l’utilisation de starlettes, il y a donc énormément de va-et-vient qui donnent aux productions d’Hollywood un côté beaucoup plus international qu’il n’y paraît.
La science est un autre domaine dans lequel les États-Unis jouissent aujourd’hui d’une position dominante. Comment s’est opérée cette conquête?
Les États-Unis sont entrés sur le marché académique international au lendemain de la Première Guerre mondiale pour se positionner, là encore de manière assez brutale, en son centre. Cette transformation de la circulation du savoir scientifique repose sur la construction d’un système universitaire calqué sur le modèle allemand et rapidement devenu très puissant, au point d’attirer, dès l’entre-deux-guerres, de nombreux scientifiques étrangers de renom. Ces institutions ont notamment pu appuyer leur croissance sur un solide réseau de bailleurs de fonds privés incarnés par de grandes fondations (Rockefeller, Carnegie), qui ont créé d’importants programmes et qui ont financé des laboratoires de recherche de pointe. Ce à quoi s’ajoutent des programmes de bourses individuelles qui ont réorienté des flux scientifiques qui auparavant allaient vers les pays européens, notamment l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, pour faire des États-Unis le nouveau centre de gravité de la recherche scientifique internationale. Cependant, là encore, il ne s’agit pas uniquement d’une visée hégémonique mais d’une question de survie pour les États-Unis.
Que voulez-vous dire?
Le niveau de l’enseignement secondaire est assez médiocre dans ce pays, ce qui fait que, depuis le XIXe siècle, il a une grande difficulté à former des élites. Comme il n’y a pas assez d’étudiants de bonne qualité dans les universités, il est indispensable de trouver de nouveaux cerveaux ailleurs, notamment au travers de ces programmes d’échange destinés à attirer les meilleurs scientifiques étrangers sur le sol américain.
L’Amérique s’est longtemps voulue un parangon de la démocratie. Quel est votre point de vue sur cette question?
Sur le plan intérieur, force est de constater qu’il y a un gouffre entre l’idéal des pères fondateurs – qui pensaient avoir mis sur pied un système politique parfait faisant la synthèse de tous les apports de la philosophie politique européenne – et le fonctionnement actuel de la démocratie américaine qui est basé sur un système d’élection atrocement complexe et dysfonctionnel au point de permettre l’élection d’un candidat minoritaire en termes de voix. C’est devenu encore plus caricatural avec l’élection de Donald Trump, qui est clairement quelqu’un qui se fiche éperdument de l’État de droit.
Et qu’en est-il à l’extérieur des frontières américaines?
Entre la Première Guerre mondiale et la guerre du Golfe, les États-Unis ont vraiment identifié leur destin national à celui du monde entier en faisant de la démocratie un des éléments centraux de cette identification. Cela permettait de montrer à quel point la société américaine fonctionnait bien et de renforcer la croyance des Américains dans la validité du modèle choisi. Dans les faits, l’exportation de modèle a rarement apporté les résultats escomptés. On peut citer quelques succès notables, en particulier la stabilisation politique du Japon et de l’Allemagne après 1945, dans laquelle les États-Unis ont joué un rôle important. Mais si on élimine ces deux exemples, le nombre d’échecs est assez important, des Philippines à la Corée du Sud, en passant par l’Iran, l’Irak et l’Afghanistan. Au final, il me semble donc que l’idée soutenue par un certain nombre de politologues américains consistant à affirmer que les États-Unis ont contribué à l’accroissement de la liberté dans le monde est complètement fantaisiste.
Peut-on pour autant parler d’un déclin de la puissance américaine?
J’évoquerais plutôt une fin de cycle. Les États-Unis demeurent objectivement un pays très puissant qui a la possibilité de se projeter partout, notamment sur le plan militaire. Par ailleurs, son économie reste extrêmement dynamique comme l’illustre le développement récent des technologies numériques. Je pense cependant que c’est un des pays qui vont avoir le plus de mal à s’adapter au nouveau paradigme climatique, parce qu’il s’est construit sur l’idée que les ressources étaient illimitées. La société de consommation a permis de lisser les différences. C’est un des ciments de la société américaine qui traversent toutes les origines et tous les statuts sociaux. Cela parle autant aux Blancs qu’aux Latinos, aux serveuses qu’aux multimilliardaires. Or, on sait aujourd’hui que les ressources de notre monde ne sont pas infinies. Et pour les Américains, il sera sans doute très difficile d’accepter cette idée. Ce qui me fait dire que le XXIe siècle ne sera probablement pas américain.
Cet article est paru dans le magazine Campus n°143.