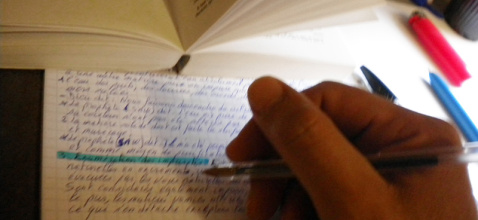Sur la base de ce constat, une coalition de scientifiques a publié, le 19 avril dernier, la «Déclaration de New York sur la conscience animale», un manifeste appelant à repenser la relation entre l’animal et l’homme. Rédigé par une quarantaine d’auteur-es, le message est aujourd’hui porté par environ 200 membres de la communauté scientifique. Mais il est encore loin de faire l’unanimité. «Les auteur-es utilisent une définition de la conscience très limitée dans le sens où elle fait référence à une simple expérience, une sensation, qui, bien que certains puissent la considérer comme un embryon de conscience, serait d’un niveau très bas, explique Ivan Rodriguez, directeur du Département de génétique et évolution et des animaleries de la Faculté des sciences à l’UNIGE. Pour les animaux, cela correspond, par exemple, à capter une odeur, à éviter un lieu donné ou à percevoir une pression sur le corps, mais cela n’implique pas la capacité de penser ces expériences. Compris dans ce sens, le terme de conscience ne correspond pas à son équivalent chez l’humain, qui décrit la faculté de connaître sa propre réalité et de la juger. De fait, en modifiant la définition de la conscience, on peut considérablement élargir le cercle de ceux que l’on veut voir considérés comme conscients.» Dans le milieu scientifique, le terme «conscience» est en effet utilisé à la fois pour décrire la capacité à ressentir, à éprouver des émotions, à intégrer des sensations et des expériences différentes, à développer des états mentaux complexes, à comprendre le ressenti d’autrui. Les études scientifiques se concentrent souvent sur un seul ou une sélection de ces aspects, ce qui rend leur généralisation difficile.
Ce mouvement témoigne cependant d’une évolution de la pensée. Considérés jusqu’à la fin du XIXe siècle comme des êtres insensibles, les animaux sont désormais protégés. La notion de bien-être animal émerge au XXe siècle notamment pour encadrer les conditions d’élevage, une activité qui s’est fortement étendue depuis la révolution industrielle. En Suisse, c’est la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), entrée en vigueur en 2005, qui s’applique. Elle vise à protéger leur bien-être et leur dignité, qu’ils soient sauvages, domestiques, d’élevage ou utilisés dans le cadre de l’expérimentation animale. Cette dernière est strictement réglementée. Tout projet de recherche doit être validé par le service vétérinaire cantonal et un comité d’éthique, et répondre au principe des 3R (remplacer, réduire et raffiner) qui veut que seules les expériences pour lesquelles il n’existe aucune méthode alternative soient autorisées.
Promotion des 3R
Alors que notre compréhension du monde animal évolue, de nouvelles questions quant à notre droit moral à les utiliser émergent. Dans ce contexte, la Direction de l’expérimentation animale de l’UNIGE, avec le soutien du Centre de compétence 3R et du Réseau des animaleries lémaniques, organisait, lundi 13 mai, une conférence intitulée «Conscience animale et perception de la douleur». Accrédité comme une demi-journée de formation continue en expérimentation animale par les cantons de Vaud et de Genève, l’événement a fait salle comble. Il visait à promouvoir le principe des 3R et à encourager les participant-es à considérer les particularités des espèces qu’ils ou elles utilisent dans leurs expériences. Quatre intervenant-es se sont succédé pour dresser un état des lieux des connaissances, évoquer les capacités cognitives de singes macaques, questionner la présence d’une conscience chez les poissons et, enfin, discuter l’usage des animaux dans les métiers de la recherche.
Performances cognitives des animaux
Caractériser la conscience animale n’est pas un exercice simple. Mais cela ne relève pas non plus de l’évidence pour l’humain. «À l’heure actuelle, les scientifiques ne s’accordent pas sur une définition unique de la conscience humaine et plusieurs modèles coexistent», confirme Ivan Rodriguez. En ce qui concerne les animaux, de nombreuses recherches portant sur leurs capacités cognitives ont permis de mettre en évidence les performances qu’ils accomplissent: conscience de soi-même et des autres, apprentissage, jeu, mémorisation, émotions, relations sociales... Patrick Prunet, ancien directeur de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) Bretagne-Normandie, cite l’exemple des relations complexes qui s’installent entre le labre, un petit poisson nettoyeur, et son «client», un gros poisson. Pour se faire déparasiter, ce dernier se rend dans une «station de nettoyage», un site spécifique où «exerce» un labre en particulier. Or, certains nettoyeurs mordent plus que d’autres. Il a été montré que les «clients» pouvaient parcourir de longues distances, faisant ainsi intervenir leur mémoire, pour se rendre dans la station de leur choix, celle en laquelle ils ont confiance. Pour Patrick Prunet, ces observations démontrent l’existence de relations sociales complexes qui dépassent les comportements conditionnés des poissons.
Ces résultats doivent cependant être interprétés avec beaucoup de précaution. «Quand on observe le comportement des macaques, remarque Charlotte Canteloup, éthologue et chercheuse au Centre de primatologie de l’Université de Strasbourg, on a l’impression qu'ils sont capables de comprendre une intention, de prendre en compte la perspective des autres, mais il nous est difficile de nous assurer des mécanismes cognitifs impliqués dans ces comportements et des représentations mentales réellement à l’œuvre.»
Douleur versus souffrance animale
La question de la souffrance animale semble, quant à elle, bien décrite – quoique les espèces auxquelles elle s’applique fassent débat. Les chercheurs et chercheuses distinguent généralement trois niveaux. La nociception, qui est la réaction de récepteurs sensitifs à un stimulus désagréable. La douleur, qui fait appel à la capacité d’associer des émotions à ce stimulus. La souffrance, qui relèverait d’une dimension supérieure et se traduirait par une intériorisation des émotions nécessaires à la prise de conscience.
Du point de vue des neurosciences, la conscience est décrite par les structures anatomiques cérébrales qui l’hébergent. Le néocortex, une zone du cerveau présente chez les mammifères, semble y jouer un rôle prépondérant. Cependant, l’absence de cet organe, comme c’est le cas chez les poissons, ne signifie pas pour autant l’absence de fonction et donc, en l’occurrence, l’absence de conscience. Pour Jacques Servière, neuroscientifique à l’INRA-AgroParisTech, l’évaluation des performances cognitives doit donc également prendre en compte la complexité des connexions nerveuses intra-cérébrales. Cette «connectivité» est représentée par le connectome, un plan complet des connexions neuronales du cerveau, qui est en voie d’être établi chez plusieurs espèces de vertébrés, mais aussi chez la mouche du vinaigre.
Ces considérations nouvelles n’impactent pas seulement la façon dont les animaux sont perçus par l’homme, mais également la façon dont l’homme se perçoit lui-même. «Tout l’enjeu est là», remarque Jacques Servière. Patrick Prunet appelle, quant à lui, «à développer une nouvelle ‘diplomatie avec les animaux’, selon l’expression du philosophe français Baptiste Morizot, pour travailler avec eux, que ce soit en expérimentation animale, en production ou en cohabitation individuelle, en ayant une meilleure connaissance de leur vie propre».