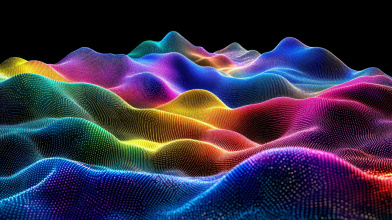«Je ne tenterai pas de sonder la pureté des intentions des un-es ou des autres, prévient l’autrice en préambule. Je ne cherche pas ici à savoir qui ment et qui dit la vérité, qui est de bonne foi et qui ne l’est pas. Mon seul propos est d’illustrer les principes de propagande, unanimement utilisés, et d’en décrire les mécanismes.» L’exposition Résister à la propagande de guerre, produite par le War Heritage Institute de Bruxelles, invite à décoder ces mécanismes. Pour mieux y résister. Du 9 au 18 décembre, l’installation fait escale à Genève, dans le hall d’Uni Dufour. Une conférence de l’historienne Anne Morelli est prévue à l’occasion du vernissage, le lundi 9 décembre (salle U259, 19h). Entretien.
Le Journal: Comment avez-vous établi ces dix commandements?
Anne Morelli: Je me suis appuyée sur les écrits d’Arthur Ponsonby et plus particulièrement sur son livre Les Faussaires à l’œuvre en temps de guerre, paru en 1928, dans lequel il décrit la falsification de l’information pour inciter la population à accepter la guerre. Il avait observé cela de très près, car durant la Première Guerre mondiale, il avait œuvré dans le bureau de la propagande britannique. Il avait notamment participé à la création de fausses nouvelles, en particulier sur les atrocités commises par l’ennemi. J’ai systématisé ses observations en dix principes, les dix «commandements» de la propagande de guerre, et je les ai mis à l’épreuve du temps. J’ai été très étonnée: ils sont utilisés dans toutes les guerres du XXe et du XXIe siècle.
Pouvez-vous nous citer quelques-uns de ces principes?
Ils sont basés sur des règles de psychologie élémentaire. Il faut par exemple toujours se présenter comme ayant été agressé-e par l’ennemi-e. «C’est lui/elle qui a commencé», comme disent les enfants. Cela se vérifie dans tout conflit: chaque camp assure que c’est l’autre qui a ouvert les hostilités et soutient qu’il est pacifique, gentil et ne fait que se défendre. Puisqu’il ne s’agit que de légitime défense, l’opinion publique a alors la certitude d’être dans le juste. Un autre principe très utilisé est celui qui fait du dirigeant du camp adverse un monstre: dans chaque guerre, on trouve un «salaud de service» et on persuade l’opinion publique qu’on ne fait pas la guerre à un peuple ou à un pays, mais à ce monstre. Tous les efforts de la propagande sont dirigés vers ce personnage. Pour la Première Guerre mondiale, c’était le kaiser, mais il peut s’appeler Milosevic, Saddam Hussein, Khadafi ou Poutine.
Observez-vous une évolution depuis les écrits d’Arthur Ponsonby?
Les ressorts sont toujours les mêmes. La grande différence avec la Première Guerre mondiale, c’est qu’aujourd'hui, ce ne sont plus quelques personnes autour d’une table qui essaient d’imaginer des stratégies, mais des agences de communication qui sont spécifiquement mandatées pour le faire. Par exemple, le cabinet Hill & Knowlton a travaillé pour le gouvernement américain lors de la guerre du Golfe. C’est lui qui a inventé cette histoire sordide de bébés koweïtiens arrachés de leur couveuse par les soldats irakiens – parce qu’un autre principe très important, c'est que l’ennemi procède de manière extrêmement cruelle, contrairement à nous. D’ailleurs, quand Colin Powell agite une fiole en déclarant à l’ONU «nous avons la preuve que l’Irak a des armes de destruction massive», on peut imaginer qu’il n’a pas inventé cela tout seul, mais qu’il a été aidé par des conseillers/ères en communication.
Quel est le mandat qui est donné à ces agences de communication?
Sensibiliser l’opinion publique à la nécessité de fournir des efforts militaires. Parce qu’au fond, peu de gens sont agressifs. De manière générale, la population voudrait la paix, mais on la persuade qu’elle est en danger, qu’elle doit réagir, qu’on se bat contre des monstres, pour une cause noble. Et elle finit par accepter la situation de guerre. Une fois celle-ci engagée, il faut encore maintenir l’adhésion du public. Or, à de rares exceptions près, les êtres humains préfèrent adhérer à des causes victorieuses. C’est pourquoi un autre principe récurrent consiste à cacher ses propres pertes et à exagérer celles de l’ennemi.
L’opinion publique croit-elle pour autant à ces informations?
Non, pas forcément, mais il n’est pas facile de les remettre en question. D’autant qu’une technique très répandue – c’est le dernier principe, corollaire de tous les autres – consiste à faire de quiconque douterait de ces allégations un ou une agent-e de l’ennemi. Par exemple, si on pose la question «Quand a commencé le conflit entre la Russie et l’Ukraine, avec l’arrivée des Russes en 2022 ou avec les bombardements de l’Ukraine sur le territoire pro-russe en 2014?» selon que vous optez pour l’une ou l’autre réponse, le positionnement est très différent. Mais, dans les pays occidentaux, si vous n’adoptez pas le point de vue officiel, on vous accusera aussitôt d’être favorable à Poutine. En 2001, refuser les bombardements sur l’Afghanistan, c’était automatiquement être pour Ben Laden. Aujourd’hui, s’opposer à la guerre à Gaza revient à soutenir le Hamas.
Que faire pour résister à cet endoctrinement?
Quand on a compris tout cela, on se dit: «Eh bien, la prochaine fois, je ne me laisserai plus avoir!» Mais quand la prochaine fois arrive, on nous explique que nous sommes attaqué-es par des méchants qui ont à leur tête un sadique, qu’ils commettent des atrocités, etc. Et le même schéma mental s’enclenche. En plein cœur du conflit, face à la déferlante de nouvelles, il est extrêmement difficile d’obtenir la version de chaque camp pour les confronter et se faire une opinion critique. Il ne nous reste alors qu’une possibilité: douter, douter et encore douter. Et pour s’en donner les moyens, c’est-à-dire disposer d’une information impartiale, il est essentiel de soutenir les rares médias indépendants qui existent encore.